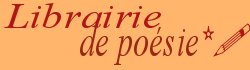CHAPITRE
II
Le
docteur Babitt trace sur son carnet de notes des signes cabalistiques
censés représenter son état d’esprit en
écoutant discourir son patient : des zébrures comme de
violents éclairs sont surchargés de cercles totalement
décentrés : « Voilà deux ans qu’il
pédale dans la choucroute ! », serait la traduction de ses
hiéroglyphes. Il hoche la tête de temps à autre,
d’un air pénétré, mais il n’a nul besoin de
rajouter des commentaires sous forme d’onomatopées comme «
hum…hum… » par exemple, tant la diarrhée verbale de son
interlocuteur le plonge dans un abîme vaseux et obscur, à
chaque fois, plus vaseux et obscur ; depuis deux ans, deux heures par
semaine, son esprit enlisé dans ce magma verbeux, n’arrive plus
à comptabiliser le temps passé près de ce patient
si inhabituel. Voilà un homme qui avait eu une vie normale et
réglée pendant trente-trois ans et qui, brusquement –
parce que sa femme a cessé de parler – à sa demande ! –
voilà cet homme qui devient fou furieux et tue sa compagne
devenue silencieuse ! Mais le pire : c’est que cet homme-là ne
cesse de raconter son histoire et de se demander pourquoi : non pas
pourquoi, il a commis cet acte, mais, pourquoi son épouse s’est
tue.
C’est là que le docteur Babitt doit intervenir pour remettre les
choses dans leur logique, mais il ne peut pas placer le moindre mot, ni
même une onomatopée du style « hum…hum ! »
Le
docteur Babitt ne peut pas parler, alors il dessine sa pensée
! En face de lui, assise derrière le patient, son assistante
prend des notes, ou, peut-être, fait-elle, elle aussi des
hiéroglyphes! Il serait intéressant, après chaque
séance, de comparer leurs graffitis et de les interpréter
à deux voix ! Mais ce ne serait pas professionnel, même si
on peut douter que leur écoute le soit! Ils se quittent
après chaque entretien l’esprit enfoui dans la gangue des
paroles entendues, mais pas écoutées ; ces paroles les
enfoncent comme s’ils devenaient des objets de plus en plus trapus,
petits, écrasés sous le poids du verbe.
Soudain
un rayon lumineux troue l’épaisseur du discours : oui, il y a eu
un blanc ; désemparé, Babitt lève la tête,
l’assistante sursaute : l’homme a changé de posture, il
s’incline vers le bureau et fixe son interlocuteur abasourdi, il
communique cette information : « … Je crois que c’est un signe
qu’Hélène m’envoie… ». Bouleversés,
émus aux larmes, les regards des deux professionnels de
l’âme s’éclairent, leurs oreilles sont aux aguets, leurs
lèvres esquissent réciproquement un sourire
soulagé.
«
Oui, reprend l’homme – qui a étranglé sa femme -, une
jeune infirmière stagiaire est arrivée dans mon service,
elle ressemble beaucoup à Hélène… Je pense
même que c’est Hélène qui est revenue pour m’aider,
elle a enfin eu pitié, elle vient pour m’expliquer et me sortir
de la nasse des questions qui me retiennent prisonnier ici ».
Les regards des
consultants se croisent à nouveau, unis dans la même
stupéfaction intense. Babitt se ressaisit le premier :
- Non ! Ce n’est pas
vrai !... Après deux ans de ressassement le voilà qu’il
délire !
- Elle veut me dire
quelque chose, repend l’homme – qui a étranglé sa femme-,
elle veut m’expliquer, je le sens… Puis le regard de l’homme perd peu
à peu de son acuité, il redevient trouble et son corps
est repris par ses tics nerveux.
Après
la séance, les deux praticiens se consultent brièvement.
Ebranlés par la situation inattendue, ils vont aux
renseignements. Non, il n’y a pas d’infirmière stagiaire en ce
moment ! Dans aucun service ! Ayant irrité et harcelé les
personnels administratifs par leur enquête intempestive, les deux
praticiens ne savent comment interpréter la séance : le
délire va-t-il opérer une amélioration dans
l’état de leur patient ou le faire passer définitivement
de l’autre côté du miroir ?
Les
séances suivantes sont à la fois étranges et
rassurantes. L’infirmière stagiaire – ectoplasme
d’Hélène – que seul le mari peut voir, entretient aux
dires de celui-ci un dialogue muet, fait de mimiques, de sourires et de
longs regards pleins de sens ! En même temps, la parole du
patient se fait plus douce, plus lente, plus hésitante : le flot
verbal est en train de décroitre. « Il va bien finir par
se taire complètement ! », grommelle le docteur Babitt.
En effet chaque
séance devient plus paisible, les silences qui entrecoupent le
récitatif habituel du patient s’allongent. Le docteur Babitt est
saisi par une angoisse soudaine et nouvelle : peut-être
préférait-il la logorrhée criarde des
années précédentes ? C’est trop brutal pour lui,
il faut qu’il s’habitue. Mais son patient ne l’attend pas, chaque jour
est une épreuve nouvelle, chaque jour marque son aggravation
notable de l’état mutique du patient.
Le
docteur Babitt fulmine intérieurement. Il reprend ses graffitis
: maintenant ce sont des cercles qui s’enchevêtrent, on dirait de
gros mollusques qui défilent en rand serré.
Comparativement au langage de son patient, le langage des signes du
docteur Babitt montre une analogie flagrante : pendant les silences,
les mollusques s’arrêtent brutalement et reprennent leur
défilé après un blanc graphique
mathématiquement équivalent à la longueur du
silence verbal. Les séances s’écoulent, les mots de
l’homme – qui a étranglé sa femme parce qu’elle ne
parlait plus – ne se bousculent plus, ils apparaissent ponctuellement
rompant de longs silences. La mécanique s’est inversée :
les graffitis du docteur Babitt ressemblent à un
encéphalogramme plat, brisé de temps à autre, avec
netteté, par des sortes d’extrasystoles, comme des fers de
lances, comme des cris jetés sur le papier, comme des
interrogations furieuses sur le mode exclamatoire, ou l’inverse !
Babitt
enrage car l’autre est en train de se taire, inexorablement comme une
lampe qui s’éteint. Maintenant, c’est lui, Babitt qui parle,
interroge, de plus en plus anxieux ; ses paroles sont comme des fers de
lances, des points d’interrogation, des points d’exclamation qui
crèvent les blancs des séances.
A
l’hôpital, le silence de l’homme – qui a étranglé
sa femme – soulage le service. L’homme est calme et serviable quoique
muet. Tout le monde se sent plus gai, plus tonique ;
l’atmosphère est légère. Même les autres
malades en profitent. Ce constat accable Babitt, le déstabilise
; car il lui semblait avoir plus d’envergure face à un malade
déchaîné. Babitt se secoue pour se raffermir.
Il
devient plus sec avec son malade qui lui répond par un sourire
désarmant, mais muet ; c’est insupportable ! Inacceptable !
Intolérable ! Il a envie, furieusement envie, de le secouer pour
lui faire sortir les mots de la bouche ; alors il s’en va en
gesticulant à travers les couloirs, l’air méchant,
grommelant des phrases inarticulées, le ton de sa voix grimpe
dans les aigus : c’est lui qui fait peur !
La situation se
détériorait au fil du temps, il fallait agir ; on proposa
une mutation à Babitt qui refusa à grands cris,
même le repos suggéré fut rejeté dans une
crise de colère.
SI…
Babitt était
seulement un personnage de papier, le narrateur logiquement l’aurait
poussé, lors d’une crise de rage, à étrangler son
patient en lui hurlant ses propres phrases dites à
Hélène : « PARLE ! Mais tu vas parler ! ». Le
récit aurait ainsi trouvé sa fin naturelle et logique !
Mais…
Le docteur Babitt, est
un scientifique, son patient, objet d’étude et sujet de livre,
ne va pas lui échapper à cause d’une histoire totalement
délirante ! Ainsi, cette idée le poussa à
s’acharner sur son travail, et sur tous ceux qui l’approchent ; ainsi,
au bout de quelques années de souffrance silencieuse, son
épouse épuisée le quitta, retourna à
l’autre bout de la France vivre chez ses parents, ses enfants quoique
jeunes se retrouvèrent en pension, il perdit progressivement
tous ses amis… mais l’homme – qui avait étranglé sa femme
– ne parlait toujours pas !
Amer,
accablé, et sans forces, Babitt accepta une mutation dans un
service lourd : et là, reprenant toute sa carrure, Babitt
redevint le docteur Babitt que tous connaissaient : un homme
maître de lui, légèrement cynique. Le docteur
Babitt ne se construisait que face à la violence !
Cependant, tout au fond de lui-même, Babitt reconnaissait que le
silence l’avait vaincu.
|