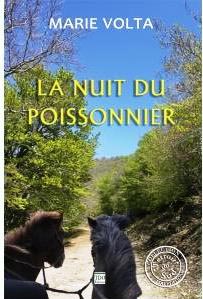Les barques colorées
quittant le petit port, les fêtes du dimanche, le muscat dans le
sang elle disait, la bienveillance d’un peuple franc bercé par
une mer chaude.
Garrotté
pourtant, ce peuple, en 1659, et c’est pour ça qu’on cheminait
cette nuit-là dans la charrette du poissonnier. J’y voyais pas
de mal, ici c’était la France, là-bas pourtant l’Espagne,
le catalan baignait les deux côtés de la frontière…
lien fidèle dont rien ni personne n’avait jamais pu couper le
filet cristallin, pas même les punitions, humiliations,
incitations à délation de l’école
républicaine française. »
La
génération des petites-filles, dont on peut supposer
que c’est bien celle de la mère de l’auteure, ne comprend plus
le catalan
qu’avec cette oreille toute musicale qui perçoit directement le
chant des
terres, du soleil et de la mer... S’instaure alors une autre
sorte de
transmission, celle du ressenti du monde, et l’entre-deux-langues
s’avère,
par-delà la division, un pont autrement subtil, celui de la
mémoire ; une
mémoire qui s’appuie non pas sur des mots mais sur leurs
contenus, sur les sens
dans le double sens du mot, sur le silence comme une force de passage,
d’incurvation du destin, d’obstination à durer.
La
figure de mémé prend alors toute sa
signification dans le mystère qui se joue devant nous. Elle a
avec le temps,
avec l’humain, avec Dieu, un rapport intime et essentiel, qui se
dispense de
gestes et de paroles ; elle lance sans broncher à sa
sœur qui lui
reproche de ne pas aller à la
messe : « Rose, je ne crois pas en
Dieu, je vis avec lui. » Alors, on dirait qu’elle contribue
de manière
indispensable à l’œuvre de Dieu, puisque sans ses prières
muettes, vigilantes, incessantes,
l’univers pourrait sombrer définitivement dans la
malignité…
« On ne prie jamais trop, Nanette, elle
disait, trop c’est encore pas
assez. Le
monde boit la prière comme le sable l’eau, tu crois que tu as
tout donné et il
en manque encore, dans l’autre sens, il tire le monde, sans
arrêt ».
C’est elle qui assure, par-delà toutes les
frontières dressées par les hommes, la persistance du
tissu familial, c’est sa
veillée qui protège de disparition la source d’amour,
c’est sa silhouette frêle
découpée au-dessus de la charrette du poissonnier comme
un signe indicateur,
comme un repère universel, qui garantit la
matérialité du chemin et la réalité
de son but : celui d’une rencontre, d’un renouement, d’un repos,
ne
serait-ce que le prix d’un instant, dans l’unité originelle qui
reprend sa place
au milieu du chaos, telle une
table de pique-nique virtuelle dressée juste sur
le pont entre les deux armées dont mémé abolit
l’opposition avec ses beignets…
« Il
faut le dire au risque de choquer : ma mémé, elle
aurait aussi bien
hébergé un franquiste s’il avait mendié un verre
d’eau, elle aurait hébergé
Hitler, Franco, Monsieur Marie, le diable en personne ! Elle
ouvrait sa
porte, c’est ça qui désarme. »
Une humanité
fondamentale se révèle par le biais de
cette figure mémorable, telle que la narratrice la revoit dans
son souvenir, se
tenant sur ce « pont télescopique » des
temps et des espaces, devant
sa sœur venue de l’autre côté, pour partager ensemble,
entre elles et autour
d’elles, la nourriture de l’âme, sous le regard de leur propre
mère qui en ce bref instant de rencontre, transmet
à
ses arrière-petites-filles et par là, aux descendantes de
celles-ci, « le
flux de sept générations de
frontaliers » :
« Ma
petite mémé venait voir sa sœur.
Inoffensive
plus qu’elle, on trouve pas.
Elle
savait prier juste, étendre la main, calmer un chagrin, gratter
la terre,
vendre au marché. Pas lire, pas écrire, pas mettre en
joue, pas tirer. Sortir
de son sarrou quelques beignets
dorés, un bout de saucisson qu’elle offrait chaque année
aux ennemis des deux
bords. Ils refusaient invariablement, se défiant du regard,
« C’est nous les
mieux ! ».
À la
fin de la fin des temps, ils accepteraient. »
Et un sens plus profond encore se dévoile pour
nous, lecteurs, en comprenant que ce « temps consacré
à tisser sur le
monde la grande et vigilante toile des
mémés », est aussi le temps de
l’écriture… En reprenant le tissu
de
mémé, l’auteure brode sur la page une écriture qui
fait elle-même partie de ce
temps-là, le temps investi à arracher « aux
mâchoires cosmiques »
chaque parcelle de vie, pour la placer dans la durée de
l’esprit. Alors, le
chemin de vie, on le crée, on le recrée à chaque
fois, autrement ; et
voici le livre lui-même qui prend la relève du silence de
mémé, qui en éclot,
dirait-on, tel un pont jeté par-dessous l’abîme, pour
sauver ces instants de
vie, ces lieux d’une « route (qui), sans nous ici,
n’existerait
pas ».
« Jamais
quand on montait, elle n’en parlait, mémé, contenue dans
sa grandissante
taiserie. Parfois je croyais qu’elle ne respirait plus. Elle tissait le
trajet.
Comme si à la moindre inattention, le chemin avait pu
s’arrêter. »
« Depuis,
mémé s'est tue définitivement et j'ai l'impression
de traverser la vie dans la
charrette du poissonnier, papotant à tout rompre, le nez dans
les étoiles, avec
cette femme en noir qui tient ferme l'amarre et ne pipe pas
mot. »
Marie Volta nous donne par ce roman une œuvre
vivante, puissante, brillant de couleurs, de sons, de rires, de
drôles d’idées,
d’exquise poésie qui innerve chaque page comme une eau vive,
sortant généreuse
de cette fertile « nuit du
poissonnier » qu’on traverse à la
lecture, en accompagnant les personnages du livre, avec émotion
et un intense
bonheur ; cette œuvre, comme mémé,
« s’obstine ». C’est l’œuvre de l’amour.
« Avec
les lecteurs... j'aimerais partager tout ce qu'on ne peut se dire au
quotidien
et qui gît, essentiel, au fond de nous.
La
régénérescence d'un regard banalisé.
Et un
amour de la vie profond et curieux. » (
interview
de novembre 2012 )
***
1 Blog de Marie Volta
2 Francopolis, mai 2012, Maria
Volta, poète, compositrice et chanteuse -
|