|
.
Léon Gontran Damas (1912-1978) fut
l’un des trois pères de la Négritude à côté de Léopold Sédar Senghor
(1906-2001) et d’Aimé Césaire (1913-2008)1. Né en Guyane, passé
par le lycée Schœlcher en Martinique, Damas poursuivit à Paris des études
plutôt éclectiques (du droit au japonais en passant par l’ethnologie). Ses
positions anticolonialistes, conformes à celles de ses deux amis, lui
valurent d’être brouillé avec sa famille et de connaître les conditions
d’existence d’un « travailleur précaire ».
Son premier recueil de poèmes, Pigments, parut en 1937 (soit deux
ans avant le Cahier d’un retour au
pays natal de Césaire).
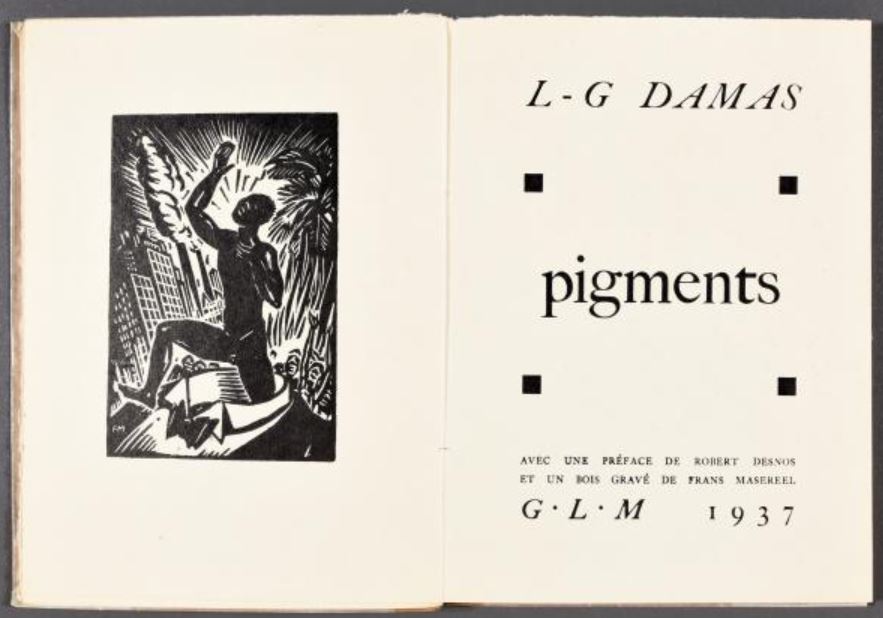
Missionné par le Musée
de l’Homme en Guyane, il en rapporta une étude trop critique pour ne
pas être censurée. En 1943, il publiait un recueil de contes guyanais, Veillées noires. Résistant pendant
la deuxième guerre mondiale, député de la Guyane en 1948-1951, il fut un
adversaire de la départementalisation des quatre « vieilles
colonies » (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) pourtant portée
par Césaire. Après ce bref épisode parlementaire, il remplit diverses
missions d’ordre culturel pour le ministère des Affaires étrangères puis
pour l’UNESCO. En 1970, il s’installa à Washington où il enseigna la
littérature d’abord à l’Université Georgetown puis à l’Université Howard.
Entre temps, deux autres recueils, Black
Label et Névralgies, étaient
parus en 1956 et 1966.
Dans l’étude commanditée par le Musée
de l’Homme publiée sous le titre Retour
de Guyane (1938), Damas fustigeait l’incompétence de l’administration
pénitentiaire (responsable des bagnes de Guyane) comme de l’administration
coloniale en général (« l’imprévoyance y fait des morts dont le
nombre est terrifiant »)… et la laideur des
constructions. On notera que, contrairement à maints Guyanais d’aujourd’hui
qui poussent des cris d’orfraie face à tout projet concernant les gisements
aurifères, il était partisan d’une exploitation « rationnelle ».
Dans un dossier des Dalhousie French Studies
consacré à Damas, Alan Warhaftig rend compte
d’un entretien qu’il eut avec le maître quelques mois avant sa disparition2,
« The Last Interview »
réalisé (en anglais) en 1976. Damas s’y réclame des influences de Poe (via
Baudelaire), de Mallarmé, du Martiniquais Etienne Léro
(bien oublié de nos jours), de l’Américain Langston Hugues. À propos d’Haïti, il prononce un vigoureux
plaidoyer en faveur de la langue française au détriment du créole.
Concernant les conséquences de la traite négrière, il réfute le terme de
« diaspora » qu’il réservait aux juifs qui ont pu, eux, préserver
leur foi, leur identité, à la différence des esclaves transportés de
l’autre côté de l’Atlantique. À propos,
enfin, de la Négritude, il rappelle le mot d’ordre de Senghor :
« assimiler – non être assimilé ».
Les poèmes de Damas expriment sa
difficulté de vivre et d’aimer quand ce n’est pas simplement de la rage
contre tout ce qui l’entoure. Ce qui ne signifie pas que la légèreté y soit
absente, ou l’humour. Certains des poèmes posthumes rassemblés dans le
recueil Mine de rien (2012) laissent
entrevoir des souffrances intimes – enfance abusée, homosexualité latente
–, autant de pistes pour cerner une personnalité bien plus complexe que
celle du dilettante élégant présentée habituellement.
Plus généralement, sa poésie, bien
que rédigée en français, est imprégnée par sa culture guyanaise et par la
langue créole, au point qu’on a pu parler à son égard d’une écriture
« épilinguistique »3 qui
serait due à sa diglossie originelle.
Le poème reproduit à la suite est
tiré de Mine de rien, le recueil dans lequel Damas a pu
se livrer plus librement que dans les textes publiés de son vivant.
Derrière les images surréalistes, certains interprètes repèrent non
seulement la critique de la religion et la dénonciation du prêtre abuseur
mais encore l’évocation de caresses homosexuelles4. La scène est
située dans deux lieux de Cayenne (préfecture de la Guyane), le
Casino-théâtre et le Petit Balcon (« Ti-Balcon »), où les
danseurs (les « Touloulous ») étaient entièrement masqués et
couverts de vêtements les dissimulant entièrement, pratique qui persiste
encore de nos jours en d’autres lieux. Quant aux « vidés » qui
« partaient de Casino et de Ti-Balcon » (voir le texte), ce sont
les défilés à pied des carnavaliers.
Notes
[1] Le terme « négritude » fut introduit
en 1935 par Césaire dans un article de l’Etudiant Noir : « … planter notre
négritude comme un bel arbre jusqu’à ce qu’il porte ses fruits les plus
authentiques… ».
2
« The Last Interview »,
Dalhousie French Studies
(DFS), n. 116, summer 2020.
3
Sandrine Bédouret-Larrabu et David Bédouret à propos de Black Label dans le numéro précité des DFS.
4 Kathleen Gyssels, dans le même numéro. Notons que cette dernière
se trompe en voyant dans « Ti-Balcon » un jeune homme qui aurait
des relations avec Nika, alors qu’il s’agit en réalité, comme précisé plus
haut, d’une salle de bal concurrente du Casino-théâtre.
©Michel
Herland
|
|
POINT
TROP N’EN FAUT
Point
trop n’en faut
n’en
faut point trop
à
l’extrême
à
l’extrême-onction
Point
trop n’en faut
n’en
faut point trop
de
secula
seculorum
sous
peine
pour
l’homme de corvée de ciboire
à
la soutane un rien frangée
effilochée
la
bedaine avancée
la
voix de fausset sucrée
la
mine à la fois réjouie et éplorée
le
regard torve
de
voir
Zotobré
alias
Pétépié
alias
Nika jouer à Lazare au tombeau
que
ressuscite en projection d’un an l’autre
le
grand écran du Ciné-Théâtre-Bouffes
de
Dame Paul-Pierre Endor
Habitant-Propriétaire
de
terrains terres
fonds
achalandage
commerce
étalage
enseigne
montre
magasin
boutique
vitrine
échoppe
devanture
attirail
bazar
barraque (sic)
vivier
resserre
grenier
chai
écurie
grange
dépôts
hangards (sic)
greniers
mansardes
poulaillers
et réduits à cette misère sans
omettre
foncière
meublée
garnie
Casino
Ti-balcon
Casino
Ti-balcon
la
serre
Casino
Ti-balcon
sert-à-tout
Casino
Ti-Balcon
fourre-tout
Casino
Ti-Balcon
fait-tout
Casino
Ti-Balcon
faitout
Casino
Ti-Balcon
dansé-dansé
Casino
Ti-Balcon
souépié
Casino
Ti-Balcon
roumin
Casino
Ti-Balcon
frotté
Casino
Ti-Balcon
contré
Casino
dans
le danser du danser
du
frotté frotté
du
frotté
frotté
sans contree
contré
ké ouéye
nika nikatafia à dilo
Casino
Ti-Balcon
D’où
partaient les vidés
ceux
des haut-parleurs
ceux
des beaux parleurs
ceux
masques du Carnaval de bastringues en rut
de
l’Epihanie (sic) au Boibois
du Mercredi
des
Cendres
Point
trop n’en faut
n’en
faut point trop
à
l’extreme
à
l’extreme-onction
de secula
Seculorhum
sous
peine
de
voir Zotobré alias Petépié
alias Nika se
refusant
à rendre
l’ame
s’en
revenir à contre –
poil
bride abattu
à mi chemin déjà du Grand Bordel de
Ciel-Purgatoire-Enfer-Paradis
dont
il eut trouvé assurément porte close
sans
le pagara marqué
et le quarteau de
bon Vieux Pipi-des-Sœurs
et
le flacon enrubanné
de
sueur de nègre en
sirop
de la batterie
et
le poids et mesures
et
la recette
et
la prière à faire
et
dire avant
et
la prière à faire
et
dire après
seul
viatique
valable
et vrai à même le pagara marqué
à
mettre au pied du connaisseur de Saint-Pierre
flanqué
de Lucifer son Ange Gabriel
beaux
lurrons de larrons en foire
au
boire-sec et cul de même
à
la hussarde
et
la santé
de
tous les Zotobrés de Pétépiés
de Nikassur le qui-vive
que
resuscite
toujours
resucitera (sic)
tout
secula
seculorum
Car
dit rum dit rhum et rhum à boire sans ajout
sans
sirop
rhum
sec
tout
bien considéré
pour
que Dieu bénisse
l’homme
de corvée de ciboire
Extrait de Mine
de rien,
recueil d’inédits
publiés sur le site academia.edu
par Christian Filostrat
|