|
Une Vie, un Poète :
Philippe Jaccottet
par Mireille
Diaz-Florian
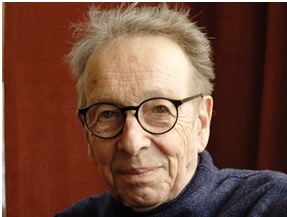
(photo reproduite du
site Alchetron)
Si au moment où il s’est agi de vous
parler d’un poète français contemporain, le nom de Philippe Jaccottet s’est
présenté comme une évidence, m’est apparue aussitôt la difficulté de ce
choix. La fréquentation régulière de ses textes constitue certes un point
d’appui nécessaire, mais reste un enjeu de taille : trouver les termes
justes pour partager l’intimité d’une lecture sans pour autant trahir
l’essentiel de cette œuvre riche et complexe.
J’ai décidé de situer mon propos, non
dans le cadre d’une analyse critique universitaire mais de le circonscrire
dans l’univers de mes lectures, en essayant de rendre compte au mieux de
cet univers poétique. Je tenterai de me dégager de ma posture de lectrice
silencieuse pour tracer un chemin, en m’appuyant sur quelques textes,
notamment Paysages avec Figures absentes qui à mes yeux condense,
sans en épuiser tous les aspects, les traits essentiels de la poésie de
Jaccottet.
Quelques dates associées à des
lieux, des rencontres, des parutions, nous permettront de situer Jaccottet
comme de cerner l’étendue de l’œuvre qui révèle le traducteur, l’essayiste
et le poète. Trois lieux dessinent le trajet de l’écrivain qui naît
à Moudon en Suisse en 1925. Il rencontre à l’âge
de 18 ans, l’écrivain Gustave Roud qui lui fera
notamment découvrir deux œuvres essentielles les poèmes d’Hölderlin et Le
Partage de Midi de Claudel « geste d’un relais presque
initiatique : dans l’une et l’autre œuvre, j’allais goûter à une
saveur spirituelle qui me nourrirait ma vie durant ».
Il fait des études de lettres à Lausanne :
philosophie, philologie grecque et allemande, rédige des notes de lecture
pour des revues. Le 4 juin 1944, son poème versifié « Pour les
Ombres » est lu en public lors d’une réunion de la société de
poésie et signe son entrée en littérature. Puis en 1945 aux éditions
Les Portes de France, il publie un recueil qu’il écartera de sa
bibliographie jugeant « par trop adolescente son écriture pleine
d’emphase » : Trois poèmes aux démons.
Il rencontre en 1946,
l’éditeur prestigieux de Suisse romande : Henri Louis Mermod, qui
publie Ramuz, Roud, Cingria
Michaux, Gide, Claudel, Ponge. Il est chargé de traduire Mort à Venise
qu’il remettra en mains propres à Thomas Mann à Zurich en 1947. Cette même
année, il quitte la Suisse pour Paris où il rencontre Francis Ponge
à une terrasse de St Germain des Prés.
En 1947, il publie Requiem :
dédié à Gustave Roud, recueil en vers libres
inspirés par des photographies de jeunes maquisards abattus dans le
Vercors. Il découvre la même année l’œuvre de Musil, alors
totalement ignorée : L’Homme sans qualités. Il écrit à sa
veuve : « je mettrais à d’éventuelles traductions de l’œuvre
de Monsieur Musil beaucoup plus qu’un simple souci de traducteur : le
respect de son œuvre, le respect et la compréhension de toute parole de
poète. » La traduction, due souvent à des raisons
alimentaires, toujours assumée avec le respect de l’écrivain et la maîtrise
du poète, sera une constante dans la vie de Jaccottet. Il sera notamment le
traducteur de Rilke, Homère, Platon, Gongora. De nombreux prix
récompenseront ce travail. Il signale non sans humour, que sa traduction en
vers de l’Odyssée sera « le seul best-seller auquel (son) nom sera
lié ».
1953 marque le début de sa collaboration à la NRF. Il
propose des poèmes du manuscrit de l’Ignorant, des proses, des
chroniques de poésie, des traductions, des notes de lectures et notamment
des essais sur Claudel, Ponge, Supervielle, Char, Aragon, ses aînés, et sur
ses pairs : Bonnefoy, Dupin, Du Bouchet, Oster
(150 contributions jusqu’en 1991) Il publie l’Effraie chez Gallimard
dans la collection Métamorphoses fondée par Jean Paulhan. C’est enfin cette
même année, que le couple Jaccottet s’installe à Grignan dans la
Drôme. Motivée par le besoin de s’éloigner du milieu littéraire parisien et
par des raisons économiques, cette installation « aura un effet
inattendu mais considérable ». « Le poète se tourne vers la
prose pour interroger le visible, expérience dont témoignera Promenade
sous les arbres » (José-Flore Tappy, Pléiade) :
« je fus saisi, plus violemment et plus continûment surtout
qu’autrefois, par le monde extérieur. Je ne pouvais plus détacher mes yeux
de cette demeure mouvante, changeante, et je trouvais dans sa considération
une joie et une stupeur croissantes ; je puis vraiment parler de
splendeur, bien qu’il se soit toujours agi de paysages très simples,
dépourvus de pittoresque, de lieux plutôt pauvres et d’espaces
mesurés. »
Durant ces années, s’élaborent les
notes qui seront recueillies dans La Semaison dont les divers
recueils paraîtront au cours des années 80/90. Il collabore à la Gazette de
Lausanne, non seulement avec des articles sur la poésie mais aussi sur des
romans dont Jaccottet est grand lecteur. L’aventure de Musil prend forme.
Le Seuil accepte la traduction qui représentera 30 ans de travail.
Diverses parutions chez Gallimard
jalonnent ces années : L’Ignorant publié en 1958
dont deux poèmes évoqueront l’insurrection de Budapest de 1956
qui a suscité de vives réactions dans le monde intellectuel, L’Obscurité
et Éléments d’un songe. En 1960, la lecture de l’anthologie du Haïku
de Blyth représente une découverte fondatrice. Il transcrit de nombreux
haïkus à partir de l’anglais dans les cahiers où s’élabore Airs, qui
paraîtra en 1967.
C’est en avril 1971 que la
collection Poésie/ Gallimard fait paraître un volume anthologie de 1946 à
1967 des œuvres de Jaccottet où « la préface de Jean
Starobinski marque un tournant dans la réception critique »
(José-Flore Tappy. Pléiade) Par des
parutions régulières, Jaccottet désormais reste au cœur de la création
contemporaine, aussi bien dans le domaine des chroniques littéraires que
dans son écriture. Son entrée dans la Pléiade depuis 2014 permet
aujourd’hui de mesurer l’étendue et la portée de l’œuvre et nous incite
naturellement à nous concentrer sur certains aspects pour tenter d’en
cerner la spécificité.
***
« Je n’ai
presque jamais cessé, depuis des années, de revenir à ces paysages qui sont
aussi mon séjour. Je crains que l’on ne finisse par me reprocher, si ce
n’est déjà fait, d’y chercher un asile contre le monde et contre la
douleur, et que les hommes, et leurs peines (plus visibles et plus tenaces
que leur joies) ne comptent pas assez à mes yeux. Il me semble toutefois qu’à
bien lire ces textes, on y trouverait cette objection presque toute
réfutée. Car ils ne parlent jamais que du réel (même si ce n’en est qu’un
fragment), de ce que tout homme peut saisir (jusque dans les villes, au
détour d’une rue, au-dessus d’un toit).
Ces propos liminaires de Paysages
avec figures absentes, texte que je privilégie ici, tant il
représente une sorte d’« art poétique »,
renvoient à l’idée du poète coupé du monde. Son retrait dans la Drôme a pu
encourager cette vision, comme certains commentaires du poète lui-même,
évoquant une création qui laisse agir en lui « les forces
anonymes ». Affirmer qu’au contraire ces textes « ne
parlent jamais que du réel » demande d’en justifier le sens. Le
titre du recueil emprunté au vocabulaire pictural, nous permet d’approcher
ce qu’est dans l’écriture de Jaccottet la relation au paysage. Il
s’agit d’une expérience fondamentale qui confère au texte ce qu’André
Dhôtel caractérise ainsi dans une lettre à l’auteur « ce quelque
chose qui ne se nomme, ni ne peut être saisi - avec une évidence qui
devient ici l’essentiel de la vie et de la poésie. » Vie et
poésie, voici les termes qui s’associent dès l’origine, dans la création de
Jaccottet.
Le poète est ouvert,
disponible, impliqué dans son regard sur le monde et il entraîne le
lecteur, par une sorte de contagion, à s’engager dans le mouvement du
regard et de l’émotion, puis dans le retrait où le texte prend forme, dans
le creuset où la langue s’élabore. Il n’est pas question de supprimer
l’auteur, d’accéder à l’abstraction, de laisser au texte sa propre énergie.
Jaccottet est présent. Il fait entendre sa voix qui, sans excès, sans
lyrisme démesuré, permet de le suivre. Sa voix, dans la retenue, cherche
l’ajustement, l’accord avec les signes perçus dans le paysage.
Le terme de justesse qui
semble particulièrement convenir à sa démarche est ainsi explicité par
Fabio Pusterla, auteur de la préface de la
Pléiade. Il évoque « la dimension éthique de
l’écriture qui peut se résumer d’un mot : justesse. »
Confronté à la difficulté d’une définition de ce terme polysémique, il
déclare : « on peut énoncer les idées qu’il véhicule –
d’abord l’idée d’exactitude, de précision expressive, d’harmonie des
éléments du texte, à la fois entre eux et avec leur objet, dans la
tentative de recréer un ordre sur la page et, un instant, dans le
monde ; l’idée de mesure et de grâce qui éloigne toute velléité
exhibitionniste, toute attitude excessive, l’idée de vérité, bien entendu,
une vérité qui aimerait réunir la beauté et la justice, le beau et le
bon ; l’idée de lumière, enfin, une lumière capable d’éclairer
l’expression et la représentation. »
Il s’agit de partager avec le lecteur
une approche du réel où le poète fait surgir la vérité toujours
fragmentaire du réel : celle du lieu et de l’instant. Il le guide par
les figures privilégiées de l’analogie, de l’oxymore, « ce besoin
de dire comme », sur les chemins mouvants du paysage,
conscient de ses doutes, de la fragilité, exigeant de la forme, qu’elle
assume la disparition, de la lumière, qu’elle transcende l’ombre. La poésie
devient « Feu qu’on allume au-dessous du miroir froid du
ciel : comme cette buée qui assure qu’on est encore vivant. » (Ce
peu de bruit. 2008)
Le poète est investi dans son rôle de
veilleur. Il le formule ainsi dans un poème, dès les années 50, justement
intitulé Le travail du Poète : L’ouvrage d’un
regard d’heure en heure affaibli / n’est pas plus de rêver que de former
des pleurs, / mais de veiller comme un berger et d’appeler / tout ce qui
risque de se perdre s’il s’endort. Il tente, conscient de la limite des
mots, de « garder ce qui scintille et va s’éteindre. » Il
est « comme un homme à genoux qu’on verrait s’efforcer / contre le
vent de rassembler son maigre feu… Son regard qui discerne l’ombre doit
inscrire dans le texte, le fugitif passage de la lumière.
Lectrice, j‘entre dans le paysage du
texte. Familière des lieux de la Drôme, terre de calcaires durs et de
combes herbeuses, je suis le rythme de la marche, je saisis la force d’un
instant que m’octroie, sur la page, la halte. Une des proses du recueil,
lue, relue, intitulée Travaux au lieu-dit l’Étang, m’absorbe toute entière. Je suis au cœur de la fabrique poétique
où Jaccottet révèle dans une mise en abyme, le patient travail du poète,
assumant pleinement l’étymologie du mot. Si dans un premier temps, il
« laisse aller les images », ose la figure baroque de
l’étang « miroir que l’on aurait tiré, au petit jour, des
armoires de l’herbe », si la silhouette sensuelle d’une femme
dévêtue au bord de l’étang pourrait suggérer le madrigal, c’est pour
dénoncer la facilité de l’image, » Le texte alors, « cherchant
à dépouiller le signe de tout ce qui ne serait pas rigoureusement
intérieur ; mais craignant aussi qu’une fois dépouillé de la sorte, il
ne se retranche que mieux dans son secret ».se déploie, se dérobe
dans les tâtonnements et l’exigence de l’écriture.
Nous voici, me semble-t-il dans le
secret de la poésie de Philippe Jaccottet. Les lieux, les moments, saisis,
filtrés, transformés dans la langue, ouvrent « la magique
profondeur du Temps ». Soutenus par le rythme des vers comme de la
prose, arrêtés parfois dans le blanc de la page pour capter un souffle,
marcheurs immobiles dans l’espace poétique, nous sommes conduits à
regarder, fût-ce dans « l’interminable ténèbre », l’éclat
du jour. Nous saurons « qu’en fin de compte, la meilleure réponse
qui ait été donnée à toutes les espèces de questions que nous ne cessons de
nous poser, est l’absence de réponse du poème (…) Parce que dans le poème
la question est devenue chant et s’est enveloppée dans un ordre sans cesser
d’être posée. »
©Mireille
Diaz-Florian,
Conférence donnée
en espagnol
au festival Letras en la mar
au Mexique, mai 2017

Grignan
(d’après le site de tourisme
de la Drôme)
Voir
l’interview avec le poète de Grignan sur dailymotion.
J’ai deviné dans le ralenti du train
les hautes terres de Grignan. J’ai su qu’il était là-bas, un instant arrêté
sur la terrasse. Il a suffi de regarder le paysage perdu dans le glissement
de la vitesse pour que je devine sa présence, pour que je reconnaisse ses
gestes et la voussure des épaules que les deuils ont accentuée.
C’est le matin. Les rues sont
désertes. En contrebas du château, les pierres des maisons agrippées à
flanc de falaise ont la froideur de l’aube. Il aura regagné lentement son
bureau. D’avoir si longuement traversé les combes et les bois, il garde en
lui les brouillards et l’ombre portée des arbres dans le jour.
Il a longuement côtoyé les strophes
de l’épopée dans le moule compact des mots à traduire. Il peut désormais,
dans l’encadrement de la fenêtre, arracher au réel son masque, nommer
chaque fantôme qui glisse entre les lavandes et le buis. Il n’a plus besoin
de lire les poèmes du solitaire de Muzot dont il
entend le souffle des élégies.
Il écoute les poèmes inscrits en lui.
Il est là debout, au moment où le train laisse une traînée de lumière vite
effacée.
Je porte en moi cet effacement à
proportion du désir d’en arrêter la fuite. Je quitte le solitaire de
Grignan. Il a posé ses mains sur la table de travail. J’aime ce mouvement
puisque j’ouvre les pages qui sont siennes, pour aborder les miennes,
toutes les pages à écrire, à relire, à corriger. J’interroge son regard de
poète pour me placer dans le jour et la nuit des mots.
Le TGV fuit à grande allure dans ses
éclats de métal. Les terres de Grignan se sont éloignées. Je me suis
glissée dans une faille de vitesse pour en déjouer les lignes
trompeuses. Je sens la vibration du passage et la certitude de
l’arrêt.
Il est rentré. Il est assis. Je peux
deviner le lieu, sa façon d’y installer le silence qui initie la plongée en
écriture, le hiatus du temps où se meut le geste. Il franchit de ses
regards lucides, de ses mots simplement ajustés, les seuils successifs de
la vieillesse. Il a lutté pied à pied avec le monstre dont aucune
mythologie n’a incarné la sournoise violence. Il a assisté à la lutte qui
rendait soudain l’aube et la nuit semblablement grises.
Il devine les traces de l’absente en
lui et dans la maison qui fut sienne. Il est depuis plus sombre. Lorsque le
soleil au zénith arrache à la terre un ultime souffle, il se réfugie dans
l’ombre verte de la terrasse. Il lui faut encore un peu de temps pour accepter
de regarder le bleu intense du ciel et l’éclat des pierres.
Il a choisi de dépouiller les mots,
d’être seulement le garant de la présence des êtres disparus dans les
syncopes du temps. Peut-être ne sait-il plus rien de l’œuvre en amont où je
puise ma force d’écrire.
Le chant des mots est une offrande
dévorée.
Il accomplit en lui l’exigence
souveraine de vivre.
©Mireille Diaz-Florian (inédit)
|