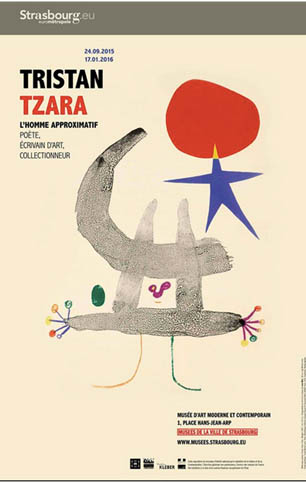|
Une
Vie, un Poète
Tristan
Tzara, l’antiphilosophe
par Dana Shishmanian
|

Marcel Janco, Portrait de Tzara,1919, assemblage de papier, carton,
toile de jute, encre et gouache, 55 x 25 x 7 cm, Paris, Centre Pompidou.
«
S’il y a un système dans le manque de
système – celui de mes propositions – je ne l’applique jamais.
» C’est ainsi que s’exprime Monsieur AA Antiphilosophe, alias
Tristan Tzara, l’inventeur du DADA et de l’« aaisme », dans
son troisième manifeste, lu le 26 mai 1920 à la Salle
Gaveau. Le texte a suscité lors de ce « Festival Dada
» une telle agitation dans le public, que Tzara raconte,
amusé, à quel point les « dadaistes » se
tenant sur la scène étaient devenus les témoins
d’un spectacle se déroulant plutôt dans la salle… Or,
à regarder de près ce jeune homme qui à ce
moment-là, avait depuis quatre ans déjà
embrasé l’Europe intellectuelle et artistique, en créant
ce mouvement d’avant-garde à 20 ans à peine, et alors
qu’il sortait de nulle part, on ne comprend guère ce qu’il avait
de « révolutionnaire »… Le visage doux et
mélancolique d’un ancien enfant sage nous fixe de
derrière un monocle bourgeois qu’accompagnent la canne, le nœud
papillon et le costume redingote, rappelant le désuet XIXe
finissant plutôt qu’illustrant le tumultueux «
après-guerre » 1920… et rien ne permet de supposer que je
jeune Tzara «posait» avec un masque !… Au contraire, bien
qu’entièrement conscient de son angélique apparence, il
se livre en toute sincérité : c’est lui, au cœur enfantin
et à l’âme délicate, qui assume bien cette
rébellion à toute philosophie, à toute
idéologie, à toute politique, lui qui est l’inventeur du
sens dessus-dessous, lui qui nous interpelle, avec constance et une
sorte de gravité d’outre-monde, à travers ces photos et
ces nombreux portraits que lui ont dédiés tant d’artistes
frappés par l’expressivité paradoxale de son visage
(Marcel Janco, mais aussi Francis Picabia, Robert Delaunay, Man Ray,
André Kertész et bien d’autres).
 Man Ray : « Le groupe
Dada », 1921.
Man Ray : « Le groupe
Dada », 1921.
Au premier plan, de gauche à droite : Paul Eluard, Jacques
Rigaut, Mic (Suzanne) Soupault, Georges Ribemont-Dessaignes. Au second
plan, de gauche à droite : Paul Chadourne, Tristan Tzara,
Philippe Soupault, Serge Charchoune.
© MAN RAY TRUST/ADAGP PARIS, 2015
Il
venait de cette Roumanie de toutes les contradictions, qui,
dirigée par un roi de souche prussienne, s’accrochait
néanmoins, en pleine guerre et avec les Allemands et les
Austro-hongrois à ses portes, à son option francophone et
francophile et allait en payer le prix fort. Mais à l’automne
1915, quand le jeune Samuel Rosenstock (pas encore 19 ans) quitte
définitivement le pays pour un vague projet d’études
universitaires à Zürich, le royaume de Ferdinand I, fils de
Charles I de Hohenzollern-Sigmaringen, le premier roi des Roumains,
n’est pas encore en guerre ; il allait y entrer, du côté
de l’Entente, en 1916, l’année de l’invention du DADA… Or
l’avant-garde poétique s’y préparait déjà
depuis 1912, avec les revues Simbolul (Le Symbole) et trois ans plus
tard, Chemarea
(L’Appel), créées et investies par des adolescents
délurés comme le futur Tristan Tzara, qui signait S.
Samyro, Marcel Iancu, futur Janco, et le grand Ion Vinea, de son vrai
nom Ion Eugen Iovanaki, le seul de la bande qui resta confiné
jusqu’à sa mort dans son pays d’origine, et que l’Occident
devait découvrir bien plus tard, au travers d’une très
récente traduction de son œuvre poétique de jeunesse
(signalée dans Francopolis d’avril 2015).
Ce n’était en
fait que la première vague ; la deuxième devait arriver
à partir de la première moitié des années
20, avec les revues Contimporanul, Punct, Urmuz, Unu, Integral, 75 HP,
Alge (Algues), et les poètes et artistes Saşa Pană, Stephan
Roll, Jules Perahim, Victor Brauner, Gherasim Luca, Ilarie Voronca,
B. Fundoianu (futur Benjamin Fondane), ainsi que, encore et
toujours, Ion Vinea… La France allait en récupérer le
plus grand nombre, à l’exception, dans cette nouvelle
génération, de Saşa Pană, celui qui honora son
prédécesseur, l’inventeur du DADA, en publiant, en 1934,
les poèmes roumains de Tzara. Ainsi les deux
générations, reliées, scellèrent-elles
l’alliance entre les avant-gardes qui essaimèrent en Europe…
Revenons au point de départ. Voici le jeune Tzara, une fois
installé à Zürich pour des études de
philosophie qu’il ne finira jamais, qui, depuis ce Cabaret Voltaire
suisse qu’avec Hugo Ball, Hans Arp et Marcel Janco, il érige
dès février 1915 en quartier général de la
neutralité anarchique, vient déclarer la guerre de
l’inconvenance à cette vieille Europe qui se déchirait en
proie à une folie meurtrière, à coups de canons et
de slogans patriotiques dans tous les sens :
« DADA reste dans le cadre européen des faiblesses,
c'est tout de même de la merde, mais nous voulons
dorénavant chier en couleurs diverses pour orner le jardin
zoologique de l'art de tous les drapeaux des consulats. »
Se moquer du politiquement correct, est depuis le début un
levier essentiel pour l’artiste Tzara et sa mouvance. Il n’y a pas
d’art dans, avec, pour la convention, aussi bonne,
bénéfique, sympathique, humaniste qu’elle aime se vanter
d’être, et quelle que soit son domaine d’exercice – national,
social, idéologique, politique, artistique, scientifique,
religieux. Tous ces ministres des bons sentiments bien pensants
bêlés en chœur sont renvoyés dos à dos, avec
un sain coup de balai :
« Puis vinrent les grands ambassadeurs du sentiment qui
s'écrièrent historiquement en chœur :
Psychologie Psychologie hihi
Science Science Science
Vive la France
Nous ne sommes pas naïfs
Nous sommes successifs
Nous sommes exclusifs
Nous ne sommes pas simples
et nous savons bien discuter l'intelligence.
Mais nous, DADA, nous ne sommes pas de leur avis, car l'art n'est pas
sérieux, je vous assure, et si nous montrons le crime pour dire
doctement ventilateur, c'est pour vous faire du plaisir, bons
auditeurs, je vous aime tant, je vous assure et je vous adore.
»
(Extrait du premier manifeste DADA lu le 14 juillet 1915 au Cabaret
Voltaire, d’après Tristan Tzara: Œuvres complètes,
Flammarion, 1975, pp.357-358).
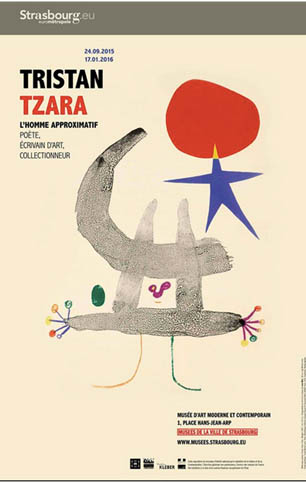
Le dessin qui domine l’affiche de l’exposition « Tristan
Tzara. L’homme approximatif » (Musée d’Art Moderne et
Contemporain de Strasbourg, 24 septembre 2015 - 17 janvier 2016) est
extrait du livre Parler seul, poèmes de Tristan Tzara
illustrés des lithographies en noir et en couleur de Joan
Miró, Paris, Maeght, 1950 (117 p.)
Une exposition exceptionnelle, la première qui lui soit
dédiée, s’est ouverte à l’automne 2015, comme pour
honorer le centenaire du début de son aventure, dans une des
capitales européennes, Strasbourg… L’extraordinaire Musée
d’Art Moderne et Contemporain de cette ville, qui recèle nombre
de trésors de l’avant-garde roumaine et européenne, nous
révèle un Tristan Tzara non seulement père du DADA
mais au centre de tous les courants artistiques et culturels pendant
plusieurs générations, étant intimement
impliqué dans tout, lié d’amitié avec tous, de Arp
à Chagall, de Miró à Picasso, d’Éluard et
Aragon à André Breton, de Pierre Reverdy à
René Char, de Max Jacob à René Nelli ; critique
averti et grand collectionneur d’art, y compris d’art africain qu’il
est parmi les premiers à découvrir, dramaturge,
poète, revuiste, animateur, résistant,
révolutionnaire… Il s’enrôle en Espagne pour combattre la
dictature de Franco l’arme à la main, mais refuse de s’encarter
dans le surréalisme… Il appelle de ses vœux l’arrivée des
Soviétiques (la plaquette acrostiche Une Route Seul Soleil le
prouve) pour faire reculer l’Allemagne nazie, mais dénonce, le
premier, le régime stalinien et scandalise son entourage de
gauche, qui refuse de publier son témoignage issu d’une visite
à Budapest à la veille de l’insurrection hongroise de
1956… Et il brave encore les consignes de son milieu littéraire
affilié au parti communiste, en adhérant, au risque de se
faire traduire en justice pour trahison, au Manifeste dit des 121, ou
Déclaration sur le droit à l’insoumission et
l’appel à la désertion, en pleine guerre
d’Algérie… Il s’engage, et il rejette la « poésie
engagée » ! Il crée des courants, et il combat les
écoles… Il déconstruit, fait du bruit, provoque,
scandalise, tout en se vouant au silence et à l’absence,
souriant comme un sage chinois à la parole avare,
consignée uniquement dans ses recueils.
Le comprendre ? Pas si difficile que cela… si on sait percevoir
l’intention intacte derrière ces apparents paradoxes.
Donnons-lui la parole, une fois de plus, en citant sa réponse
à Jean-Paul Sartre qui ouvrit, au lendemain de la
Libération, un débat sur la littérature
engagée : « Le terme de “poésie engagée”
dont il a souvent été question, n’a de sens que si
l’engagement du sujet-poète à
l’objet-événement dépasse la discipline morale et
spirituelle pour devenir l’engagement total du poète envers la
vie, son identification avec la poésie. C’est seulement à
ce prix que la poésie peut prétendre à devenir
moyen de connaissance et ne pas rester, ce qu’elle est trop souvent,
une vague occupation d’ordre esthétique, un plaisir des sens.
C’est le poète qui a une signification dans l’échelle
des valeurs humaines, le poème écrit n’étant
qu’une de ses manifestations occasionnelles, un témoignage, un
jalon. » (extrait du Surréalisme et l’après-guerre,
cité d’après la préface de Henri Béhar,
Tristan Tzara. Poésies complètes, Flammarion 2011, p. 29).
En fait, c’est que la poésie qui compte. « Je
considère que la poésie est le seul état de
vérité immédiate. La prose par contre est le
prototype du compromis envers la logique et la matière.
Reconnaitre le matérialisme de l’histoire, dire en phrases
claires même dans un but révolutionnaire, ceci ne peut
être que la profession de foi d’un habile politicien : un acte de
trahison envers la Révolution perpétuelle, la
révolution de l’esprit, la seule que je préconise, la
seule pour laquelle je serais capable de donner ma vie, parce qu’elle
n’exclut pas la sainteté du moi, parce qu’elle est ma
Révolution, et parce que pour la réaliser je n’aurai pas
besoin de la souiller à l’aide d’une lamentable mentalité
et mesquinerie de marchand de tableaux. » (lettre de 1927
à Ilarie Voronca, citée d’après la préface
de Henri Béhar à l’ouvrage susmentionné, p. 25 ;
mon soulignement).
Sinon, « Il fait si noir que seules les paroles sont
lumière », comme je jeune Samuel le savait
déjà, en 1915… (voir ici même mon « coup
de cœur »). Et à revisiter son œuvre, on acquiert la
conviction que Tristan Tzara, le poète, est l’un des plus grands
illuminateurs du XXe siècle.
***
Tristan Tzara - Bibliographie sélective de
l’œuvre poétique
Vingt-cinq poèmes, Zürich, coll. Dada,
1918 (52 p.)
De nos oiseaux, Paris, éd. Kra, 1923 (120 p.)
h
Mouchoir des nuages, Paris, éd. de la Galerie
Simon, 1925 (80 p.)
Indicateur des chemins de cœur, Paris, éd.
Jeanne Bucher, 1928 (36 p.)
L’Arbre des voyageurs, Paris, éd. de la
Montagne, 1930 (102 p.)
L’Homme approximatif, Paris, éd. Fourcade,
1931 (166 p.)
Où boivent les loups, Paris, éd. des
Cahiers libres, 1932 (178 p.)
L’Antitête, Paris, éd. des Cahiers
libres, 1933 (194 p.)
Grains et issues, Paris, éd.
Dénoël et Steele, 1933 (322 p.)
Midis gagnés, Paris, éd.
Dénoël, 1939 (136 p.)
Une Route Seul Soleil, Toulouse, Comité
National des écrivains 1944 (16 p.)
Vingt-cinq et un poèmes, Paris, éd. de
la Revue Fontaine, 1946 (70 p.)
Le Cœur à gaz, Paris, éd. G.L.M, 1946
(44 p.)
Entre-temps, Paris, coll. Calligrammes, éd.
du Pomt du iour 1946 (64 p.)
Le Signe de vie, Paris, éd. Bordas, 1946 (64
p.)
Terre sur terre, Genève, éd. des Trois
Collines, 1946 (82 p.)
La Fuite, Poème dramatique en quatre actes et
un épìlogue, Paris éd Callimard, 1947 (104 p.)
Sans coup férir, Paris, éd. jean
Aubier 1949, (40 p.)
Parler seul, Paris, éd. Maeght, 1948-1950
(120 p.)
De mémoire d’homme, Paris, éd. Bordas,
1950 (128 p.)
La Face intérieure, éd. Pierre
Seghers, 1953 (64 p.)
À haute flamme, Paris, Imprimerie Jacquet,
1955 (48 p.)
Miennes, Paris, Caractères, 1955 (46 p.)
Le Fruit permis, poèmes, Paris,
Caractères, 1956 (60 p.)
Juste Présent, Paris, La Rose des vents, 1961.
Vigies, Paris, A. Loewy, 1963 (36 p.)
Lampisteries, précédées des Sept
Manifestes Dada, Paris éd Jean-Jacques Pauvert, 1963 (156 p.)
Les Premiers Poèmes de Tristan Tzara, suivis
de cinq poèmes oubliés, présentés et
traduits du roumain par Claude Sernet Paris Seghers 1965 (88 p.)
Quarante chansons et déchansons,
préface de Claude Sernet, Montpellier, Fata Morgana, 1972 (46 p.)
Henri Béhar, Tristan Tzara. Poésies
complètes, Flammarion 2011 (1741 p.)
Dana Shishmanian
***
|
Tristan Tzara, Roumanie/France
décembre 2015
Dana Shishmanian
|