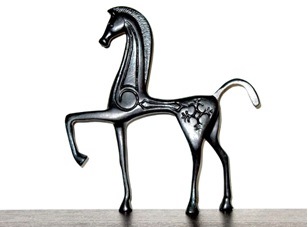|
LECTURE - CHRONIQUE
Revues papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |
|
LECTURES – CHRONIQUES
– ESSAIS
Essai de Dominique
Zinenberg :
Les chevaux littéraires
Les chevaux en littérature ne manquent pas.
Les poètes et les romanciers depuis l’Antiquité les ont chantés et célébrés
et mon entreprise, il va sans dire, reste à la fois modeste et très limitée. Il ne
sera question ici que de quatre romanciers contemporains : Le Cheval de Claude Simon (Les
éditions du Chemin de fer, 2015) ; La
vérité sur Marie de Jean-Philippe Toussaint (Les Editions de minuit,
2009/2013) ; Les désarçonnés de
Pascal Quignard (Grasset, 2012) ; Tiens
ferme ta couronne de Yannick Haenel (Gallimard 2017). Et Henri Michaux pour exergue : Lointain intérieur, entre centre et
absence : Un tout petit
cheval J’ai
élevé chez moi un petit cheval. Il galope dans ma chambre. C’est ma
distraction. Au
début, j’avais des inquiétudes. Je me demandais s’il grandirait. Mais ma
patience a été récompensée. Il a maintenant plus de cinquante-trois
centimètres et mange et digère une nourriture d’adulte. La
vraie difficulté vint du côté d’Hélène. Les femmes ne sont pas simples. Un
rien de crottin les indispose. Ça les
déséquilibre. Elles ne sont plus elles-mêmes.
« D’un si petit derrière, lui disais-je, bien peu de crottin peut
sortir », mais elle… Enfin, tant pis, il n’est plus question d’elle à
présent. Ce
qui m’inquiète, c’est autre chose, ce sont tout d’un coup, certains jours,
les changements étranges de mon petit cheval. En moins d’une heure, voilà que
sa tête enfle, enfle, son dos s’incurve, se gondole, s’effiloche et claque au
vent qui entre par la fenêtre.
Oh ! Oh ! Je
me demande s’il ne me trompe pas à se donner pour cheval ; car même
petit, un cheval ne se déploie pas comme un pavillon, ne claque pas au vent
fût-ce pour quelques instants seulement. Je
ne voudrais pas avoir été dupe, après tant de soins, après tant de nuits que
j’ai passées à le veiller, le défendant des rats, des dangers toujours
proches, et des fièvres du jeune âge.
Parfois, il se trouble de se voir si nain. Il s’effare. Ou en proie au
rut, il fait par-dessus les chaises des bonds énormes et il se met à hennir,
à hennir désespérément. Les
animaux femelles du voisinage dardent leur attention, les chiennes, les
poules, les juments, les souris. Mais, c’est tout. « Non,
décident-elles, chacune pour soi, collée à son instinct. Non, ce n’est pas à
moi de répondre. » Et jusqu’à présent aucune femelle n’a répondu. Mon
petit cheval me regarde avec de la détresse, avec de la fureur dans ses deux
yeux.
Mais, qui est en faute ? Est-ce moi ? Dans ce poème en prose, Henri Michaux
invente un cheval proche du cheval à bascule de l’enfance, mais proche aussi
du cheval de Troie, ne serait-ce qu’à cause d’Hélène. Il est à la fois
ludique et lubrique ; à la fois réaliste et fantastique ; il évolue
comme le monde imaginaire d’où il provient. Il est projection poétique et du
poète, central comme un démon, absent comme un fantasme. Ses proportions lui
donnent la valeur infinie du jouet ou du bibelot, il déploie toutes les
aptitudes contradictoires de son créateur aussi bien son galop de détresse que
son galop de fureur. Il est la force instinctive, primitive, animale qui gît
en chacun de nous ! Et voilà maintenant le cheval qui galope
dans la nuit, noir comme elle, c’est Zahir le
pur-sang sans pareil de La vérité sur
Marie de Jean-Philippe Toussaint. Sa beauté le rend d’emblée mythique et incomparable ;
sa musculature et sa puissance hors du commun. Il est quasiment divinisé par
le narrateur et sa robe noire fait de lui un des coursiers d’Érèbe. Le
pur-sang s’était échappé, il s’était enfui dans la nuit […] Zahir fuyait au galop dans la nuit, libre et furieux,
déjà loin et à peine visible. Il avait pris instinctivement la direction des
zones les plus enténébrées de l’aéroport, quittant les profondeurs du parking
et traversant la route d’accès peu éclairée pour s’élancer vers les pistes. […] Zahir, en arabe, veut dire visible, le nom vient de
Borges, et de plus loin encore, du mythe, de l’Orient, où la légende veut
qu’Allah créa les pur-sang d’une poignée de vent. Et, dans la
nouvelle éponyme de Borges, le Zahir est cet
être qui a la terrible vertu de ne jamais pouvoir être oublié dès lors qu’on
l’a aperçu une seule fois. Il n’y avait plus trace de Zahir
dans le parking, il s’était dissous dans la nuit, il s’était évaporé, il
s’était fondu, noir sur noir, dans les ténèbres. La nuit présentait son
obscurité habituelle, comme si le pur-sang était parvenu à s’introduire dans
sa matière et qu’elle l’eût instantanément englouti et digéré. […] Au bout de
la route, ils contournèrent une barrière fermée et s’engagèrent lentement sur
une piste, toujours au ralenti, toujours silencieux, sondant la nuit autour
d’eux, scrutant l’obscurité de leurs regards aigus, quand, soudain, surgi de
nulle part, avec la même soudaineté qu’il avait disparu, le corps puissant et
noir de Zahir s’incarna dans la lumière des phares,
à la fois en plein galop et arrêté, affolé, les yeux terrorisés, le pelage
noir et mouillé, comme s’il ressortait à l’instant de la nuit où il s’était
dissous. Avec le galop magique de Zahir dans la nuit, on atteint d’emblée le mythe et l’épique.
Sa robe noire permet cette apparition/disparition puisqu’il se confond avec
« la matière » nuit qu’il incarne et rejoint. La signification de
son nom, soigneusement précisée par le narrateur, le range du côté de
l’épiphanie : « le visible », mais la légende liée à sa
qualité de pur-sang le place du côté de l’invisible comme l’est le vent et
comme le vent l’est aussi, vif et rapide. Cependant son nom est aussi lié à
la littérature par Borgès qui affirme que « Zahir est cet être qui a la terrible vertu de ne jamais
pouvoir être oublié dès lors qu’on l’a aperçu une seule fois. » Tout se
tient dans ce vaste réseau jouant de la présence/absence, de la lumière et de
la nuit, du mouvement et de l’immobilité « à la fois en plein galop et
arrêté » tel un cheval peint saisi dans l’action et cependant arrêté par
le cadre qui l’emprisonne. Jean-Philippe Toussaint s’inscrit dans cette
lignée d’écrivains qui délibérément s’éloigne de la dimension réaliste et
fait sien l’emportement poétique, le sens littéraire qui ose et revendique
l’intertextualité, le saut périlleux dans le vif des mots, des images, des
visions. Quelle chance, en effet, d’avoir aperçu Zahir
noir sur blanc dans les pages de La
vérité sur Marie car effectivement, rien ne nous le fera oublier
désormais ! Cependant pour bien comprendre à quel point
ce cheval des ténèbres qu’est Zahir transcende l’incarnation
d’un simple cheval de courses, fût-il, comme il est
présenté, un pur-sang d’exception, il faut découvrir (ou relire) cet autre
passage qui devrait devenir si ce n’est déjà le cas, un morceau d’anthologie
car il permet de mieux cerner le dessein artistique de l’auteur : Car
Zahir était autant dans la réalité que dans
l’imaginaire, dans cet avion en vol que dans les brumes d’une conscience, ou
d’un rêve, inconnu, sombre, agité, où les turbulences du ciel sont des
fulgurances de la langue et, si dans la réalité, les chevaux ne vomissent
pas, ne peuvent pas vomir (il leur est physiquement impossible de vomir, leur
organisme ne le leur permet pas, même quand ils ont mal au cœur, même quand
leur estomac est surchargé de substances toxiques), Zahir,
cette nuit, à bout de forces, titubant dans sa stalle, tombant à genoux dans
la paille, la crinière plaquée sur la tête, les poils emmêlés, torsadés,
enduits d’une mauvaise sueur sèche, les mâchoires molles, la langue pâteuse,
mastiquant dans le vide, sécrétant une salive aigre, transpirant, se sentant
mal, essayant de se redresser dans sa stalle, faisant un pas de côté sur ses
jambes flageolantes et perdant de nouveau l’équilibre, à deux doigts de
s’effondrer sans connaissance dans le box, retombant, lentement, au ralenti,
sur ses genoux, s’affaissant, les antérieurs ployés, l’estomac lourd,
distendu par les fermentations, sentant les aliments lui monter le long du
ventre, des sueurs froides lui noyant maintenant les tempes et éprouvant
soudain cette proximité concrète, physique, avec la mort, que l’on éprouve
quand on va vomir, cette affreuse salive qui remonte dans la bouche et
annonce l’imminence des vomissements, quand les viscères se contractent et
que les aliments affluent dans la gorge et commencent à remonter dans la
bouche, Zahir, cette nuit, indifférent à sa nature,
traître de son espèce, se mit à vomir dans le ciel dans les soutes du Boeing 747 cargo qui volait dans la nuit. En une seule phrase immense qui se déploie
en ondes successives mimant la nausée du cheval, relancée treize fois, comme
autant de haut-le-cœur, par des participes présents activant le malaise de
l’animal, Jean-Philippe Toussaint affirme une impossibilité physiologique
chevaline celle de vomir, tout en décrivant avec minutie et réalisme le
vomissement de Zahir, assumant la contradiction
parce qu’elle permet de dépasser le pur académisme de la traduction fidèle de
la réalité et qu’elle s’émancipe ainsi du carcan du faire vrai pour suggérer
autre chose qui serait par exemple la liberté du narrateur à adopter le point
de vue de l’animal, de revendiquer le sublime de l’imaginaire et du pas de
côté par rapport aux codes littéraires bornées. Le texte décolle, il s’envole,
il s’affranchit des frontières entre rêve et réalité, il chamboule la
narration en se plaçant du point de vue du cheval, dans les arcanes de sa
conscience et de son ressenti, et dans le même temps il se sert de son
travail de documentation et s’en libère, créant un personnage fabuleux né de
son imagination, aussi improbable que Pégase mais de ce fait à jamais
inoubliable, pur objet littéraire, à la manière de Flaubert décrivant la
casquette de Charles Bovary qui est devenue la « Casquette » que personne
ne pourrait jamais porter car elle ne correspond à rien, qu’elle est d’encre,
de papier, de fantaisie et de beauté et non de tissu et couture. Et voilà que surgit maintenant Le Cheval de Claude Simon. Il l’a
écrit en 1958, soit deux ans avant La
Route des Flandres et comme l’exprime si finement Mireille Calle-Gruber
dans sa postface des éditions du Chemin de Fer où il a été réédité en 2015,
ce récit est « un pur cristal taillé, facetté avec art ». Ce récit de Claude Simon se situe pendant
la débâcle de 1940. Voici le commentaire de Mireille Calle-Gruber sur le
cheval : « CE QUI NOUS REGARDE » : Le
centre du texte est marqué par l’œil du cheval. Non pas les yeux (notation
naturaliste) mais l’œil, unique, tel un élément fabuleux : cyclopéen,
divin, surmoïque. L’œil du cheval malade fait ainsi clef de voûte de la
construction, symbole et prophétie. Le motif vient trois fois, de plus en
plus longuement ; disposant, au fond de l’infernal labyrinthe tracé par
la chevauchée des soldats dans le noir, un effet de miroir initiatique. Où la
surface oculaire qui réfléchit la silhouette des hommes révèle à chacun sa
rencontre avec l’image de la propre mort annoncée. Révélation d’autant plus
forte que, dès la première occurrence, l’agonie de l’animal est associée au
juif malade : « Le
cheval semblait me fixer de son œil globuleux et doux aux longs cils noirs.
Comme un douloureux reproche, une douloureuse et passive protestation […] En
haut, dans le foin, Maurice était toujours couché […] Il me regarda. Un peu
avec la même expression que le cheval malade. Plus un cafard d’homme. »
Avec la deuxième occurrence, c’est eux-mêmes que les hommes voient, ou
plutôt ce n’est que l’ombre d’eux-mêmes. Veillant le cheval mourant, c’est à
leur propre veillée funèbre qu’ils sont – déjà. « Seul
l’œil semblait vivre encore, énorme, douloureux, terrible, et reflétés par la
surface luisante et bombée, je pouvais nous voir, nos trois silhouettes
déformées en demi-cercle, se détachant sur le fond lumineux de la porte de la
grange dans une sorte de brouillard légèrement bleuté, comme un voile. » L’amplitude
de la phrase, avec la troisième occurrence, donne au récit une ampleur
méditative quant à l’éphémère et vaine humanité : le cristal de l’œil lit
l’avenir à coup sûr, et la sentence prend les accents du Livre de
l’Ecclésiaste « vanité des vanités, tout est vanité » « […]
c’était comme si maintenant il regardait à travers nous quelque chose que
nous ne pouvions pas voir, nous dont les images réduites continuaient
toujours à se refléter en ombres chinoises sur le globe humide […] comme s’il
avait déjà abandonné le spectacle de cet univers pour retourner son regard,
se concentrer sur une vision intérieure, une réalité plus réelle que le réel,
plus paisible que l’harassante agitation des humains. » […]
Le cheval est ainsi l’emblème de la souffrance humaine. Sublimée d’être
portée par une figure non-humaine, c’est l’image de l’endurance, de
l’indicible et impartageable solitude de mortel. « Le cheval mourut dans la nuit et
nous l’enterrâmes au matin dans un coin du verger dont les arbres aux
branches noires, presque dépouillées de leurs feuilles, s’égouttaient dans
l’air humide. nous hissâmes le corps sur un charreton et le fîmes basculer
dans la fosse, et tandis que les pelletées de terre l’ensevelissaient peu à
peu je le regardai, osseux, lugubre, plus insecte, plus mante religieuse que
jamais avec ses pattes repliées, son énorme tête douloureuse et résignée qui
peu à peu disparut, emportant sous la lente et noire marée montante l’amer et
cassandresque ricanement de ses longues dents
découvertes comme si par-delà la mort il nous narguait, prophétique, fort
d’une connaissance, d’une expérience que nous ne possédions pas, du décevant
et burlesque secret qu’est la certitude de l’absence de tout secret et de
tout mystère. » Dans
Les désarçonnés de Pascal Quignard,
le cheval est le personnage le plus présent qui soit. Il est, à travers le
temps et l’espace, celui par qui le destin frappe, soit par la mort, soit par
la folie, soit par un changement de vie. Innombrables chevaux tous
magnifiques et mythiques, tous imbus de sauvagerie, de force ou d’humilité,
tous en lien vivace avec les hommes. Tomber de cheval, manquer mourir,
survivre, renaître et garder la trace indélébile de l’accident, bifurquer,
écrire, penser, créer avec ce goût âcre de mort dans la bouche. C’est ainsi
que l’écriture des Essais commence
dans l’extase mortelle. Elle reproduit sans cesse, chaque chapitre étant une
nouvelle renaissance, une perte de connaissance suivie d’un sentiment de pure
joie de survivre. (p.56) Monter le cheval de Sejus,
c’est mourir : « Il se trouva
que le cheval qui appartenait à Sejus porta malheur
à tous ceux qui l’avaient monté » (p. 108). Le
plaisir de Pascal Quignard c’est de raconter ces récits, ces légendes, ces
faits puisés dans un fond savant, souvent peu connu, parfois célèbre, sans
souci de chronologie, sans cohérence apparente serrée, mais pour frapper
l’imagination du lecteur et le heurter à ce qui dans ces histoires a de
fascinant, originel, répétitif et cependant toujours autre, comme si les
mille facettes retraçant l’intervention fatidique du cheval dans la destinée
des individus ne pouvait jamais combler la fascination qu’une telle
coïncidence crée. « Pour Lancelot, pour Abélard, pour Paul,
pour Pétrarque, pour Montaigne, pour Brantôme, pour d’Aubigné etc. ils
tombèrent de cheval, ils eurent le sentiment d’avoir glissé dans la mort –
mais soudain ils se sentent revenir de l’autre monde. Ils sont revenus dans
ce monde. Leurs mains serrent quelque chose. Les écrivains sont les deux fois
vivants. » Le
cheval est trace furtive du destin. Son intervention dans la vie des
multiples personnages est brève et bouleversante, d’où le titre si puissant
qui doit être pris de façon concomitante au sens propre et figuré. À cause de ce qui reste en lui de sauvage ou
d’archaïque, le cheval tient du chamane par sa triple capacité à la transe, à
la tétanie, à l’hystérie. « Disposition passive qui ouvre la chair et
l’offre à la pénétration. Il n’est pas sûr que la position qui se dédie à
l’effraction ne soit pas engendrée par un retournement réflexe loin en amont
de l’humanité. On voit soudain les chevaux dans le pré qui se renversent de
la sorte et s’offrir. S’offrir à quoi ? À rien. Au soleil au-dessus d’eux, au vent qui passe,
frottant leur dos dans l’herbe ou dans le sable, les chardons, les cailloux » (p.142). Dans
le dernier chapitre de son livre autrement appelé « Dernier royaume
VII », Pascal Quignard raconte un récit dans lequel une femme chante à
voix basse un « chant d’une
tristesse indicible ». Plus tard arrive un homme qui l’écoute. Il eut froid. Il se leva en faisant le
moins de bruit possible, il se dirigea vers la porte-fenêtre ouverte, il
allait fermer les deux battants quand il vit, tout près de lui, la tête d’un
cheval. Le cheval était venu du fond de la prairie jusque-là et dansait
doucement. Ses jambes dansaient plus lentement que la mesure, sans marquer la
mesure, mais dansaient. Le cheval leva la tête, se tourna vers lui, le
regarda avec ses grands yeux tristes. Ils se regardèrent en silence. Alors
l’homme laissa ouverte la porte-fenêtre. Il s’adossa au chambranle et tous
deux, le cheval, l’homme, côte à côte, ils écoutèrent le chant. Tous deux
regardaient la femme penchée, le chignon pris dans la minuscule lumière de la
lampe, au-dessus de la partition qu’elle déchiffrait, qu’elle chantait (p.332-333). Ce
passage orphique qui clôt le texte de Pascal Quignard scelle l’accord tacite,
par le lien de l’art, entre le cheval et les humains. La voix humaine fascine
l’animal, comme l’animal avec ses grands yeux tristes, fascine les humains.
La douceur harmonieuse de cette fin est un absolu moment de grâce qui
rapproche les deux règnes comme si le monde pouvait enfin s’apaiser. Et
c’est avec un autre moment de grâce comparable à celui écrit par l’auteur de Tous les matins du monde que
j’achèverai cet aperçu sur les chevaux littéraires et légendaires. Il s’agit
du chapitre intitulé « Le cheval Visconti » dans l’œuvre de Yannick
Haenel Tiens ferme ta couronne. Le
narrateur a, depuis un moment déjà, fait parler Isabelle Huppert qui raconte
son séjour quarante ans plus tôt en Amérique avec Michael Cimino
pour le tournage d’un film (La porte du
paradis / Heaven’s Gate,
1980). Je
me souviens d’une légende, je ne sais plus si elle est indienne : un
cheval cache sa tête sous terre pendant un an et devient un arbre. Si l’on
approche son oreille du tronc, si l’on possède assez de mélodie en soi pour
écouter un arbre, on peut l’entendre galoper. Je pense que ce pommier avait
de sacrées choses à raconter, il galopait sous terre, avec ses racines qui
approfondissaient l’histoire de la prairie. Et c’est drôle, on aurait dit que
le cheval cherchait à se rapprocher du pommier parce qu’il était toujours là,
près de nous, la tête penchée au-dessus de la clôture : peut-être
écoutait-il le galop intérieur de l’arbre. Ce
cheval s’appelait Visconti. […] J’ai raconté ça tout de suite aux filles, elles
ont éclaté de rire. Ce soir-là, Anna a dansé pieds nus sous le pommier avec
une petite robe noire, comme Marilyn Monroe dans The Misfits
, et puis nous l’avons rejointe ; et tandis que nous dansions, des
chevaux se sont approchés le long de la clôture ; il n’y avait plus
seulement Visconti et son crin fauve, mais un petit troupeau qui l’entourait,
noir, crème, champagne, six ou sept chevaux qui passaient leur tête
par-dessus la clôture : peut-être entendaient-ils le galop du pommier,
comme nous l’entendions ce soir-là à travers notre ivresse et notre joie ;
toujours est-il que, d’un coup, sans même nous être concertées ni avoir
prononcé aucun mot, nous nous sommes baissées l’une après l’autre pour passer
sous la clôture, nous avons sauté chacune sur un cheval et, dans la nuit,
nous avons galopé, d’abord dans la prairie, puis loin, très loin, vers les
montagnes qui ne finissent jamais. L’arbre-cheval
qui galope, la nuit, la prairie, la musique, l’attraction des chevaux vers
les danseuses évoluant sous le pommier, l’accord tacite et la chevauchée
« fantastique » dans la nuit américaine, tout cela qui se déroule
comme un rêve, s’auréole de beauté et de poésie. Ivresse et joie du partage
et galop littéraire et cinématographique comme la dernière séquence
énigmatique d’un western qui s’achèverait sur un infini. Et n’est-il pas vrai que nos rêves sont
pleins de chevaux fougueux qui traversent nos nuits imposant leur cadence,
leur folie, leur liberté, loin du carcan diurne qui nous restreint ? Et
n’est-il pas vrai que ces chevaux qui passent dans les œuvres, qui les
traversent, crinières au vent, augmentent notre désir de créer, de
transcender le temps, de frôler de près le mystère et l’ouvert ? ©Dominique Zinenberg |
Essai de
Dominique
Zinenberg
Francopolis, mai-juin
2019