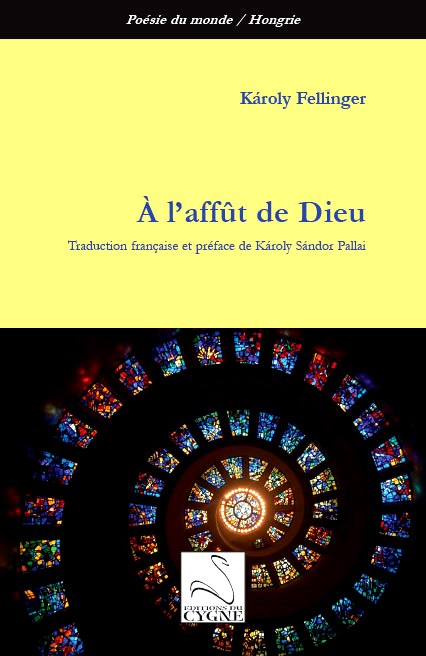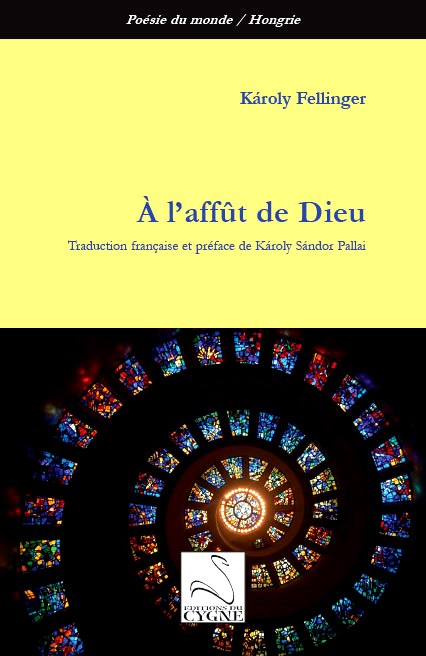
À l’affût de Dieu est un recueil
qui quête un sens, qui guette un/des signes, qui voudrait de façon claire
ne rien cacher mais qu’on ne cachât rien non plus et qui niche au sein du
texte, le poème qui donne son titre au recueil, comme un secret que l’on
divulgue, soudain, au détour d’une page et dont le rayonnement éclaire
chacun des micro-récits-poèmes du recueil.
À
l’affût de Dieu
Les
yeux de Janos se sont emplis
d’obscurité, il se sent
comme Juli
qui est à l’affût de Dieu en ce
moment même
et quand elle revient, comme un
ange,
elle ne partagera pas la proie,
elle la redonnera plutôt à la pureté,
à l’inconnu lavable
qui se dilatera ou se rétrécira par
là
ou attendra presque à l’oisiveté
comme les nuages
d’orage timides qui
arrivent brusquement
faisant reculer les
bornes de l’existence
tandis qu’ils marquent
de leurs éclairs
le sort immuable. (p.83)
À
quel moment déterminant est-on à « l’affût de Dieu » ?
Peut-être essentiellement quand les yeux d’un être cher se remplissent d’obscurité,
qu’il se meurt. À ce moment
précisément commence la quête pour comprendre et pour atteindre quelque
chose qui serait possiblement Dieu : une empreinte, un souffle, un
fétu qui ferait signe. Cela coïncide avec le deuil qui est ressassement,
besoin d’intimité, d’où ces poèmes qui ressemblent à un journal intime, qui
évoquent le plus quotidien auréolé, cependant, de sacré. Devant le mystère
de la mort, il y a un instant où le mort comme le vivant sont « à
l’affût » de ce qui advient, l’un meurt, l’autre revient « comme
un ange » et « le sort immuable » s’impose dans la
temporalité incarnée par les nuages, les orages, les éclairs et la dilution
du secret dans la « pureté » insaisissable du jour.
Le chamboulement que le deuil provoque
est sensible dans la disposition peu chronologique des poèmes du recueil.
Peut-être aussi, dans le cas particulier du père du poète, la mort a-t-elle
été anticipée par l’état dégradé du père atteint d’Alzheimer quelques
années avant sa mort, parce qu’avec la maladie s’était glissée, sournoise,
l’absence.
Carburant
Si mon père était vivant,
je ne pourrais pas
visiter sa tombe chaque
jour
avec ma mère
car l’un de nous
deux
devrait rester auprès de
lui,
comme toujours,
veillant
à ce qu’il n’ouvre
le gaz,
qu’il ne tourne le
robinet,
qu’il ne fasse une
chute
et se casse le col
du fémur
c’est à cela qu’il a
succombé
il y a cent un
jours. (p.53)
Tout le recueil tourne autour de la
présence/absence du père ; autour de la vie que le père a menée, de la
relation du père au fils, et à sa femme. Le quotidien est imprégné du
souvenir du père qui traverse les pages des jours et celles de l’écriture
comme une grande ombre qui s’immisce, l’enveloppe, le porte et l’atterre. Mon père est mort, le temps s’en est
allé avec lui […] Si j’entre dans la chambre de mon père, je laisse la
porte/grande ouverte, je ne l’oublie jamais, j’en suis sûr, / la paix
s’habille par couches, elle ne connaît /rien d’autre que l’hiver rigoureux,
son cœur bat/ avec intransigeance sous son sommet enneigé. / Mon père
demeure silencieux, ses réponses / frapperaient mes questions de droit de
sortie.
Le quotidien est simple, voire trivial :
il semble manger les jours de sa routine ingrate et le poète n’évacue ni
les poubelles qu’il a la corvée de sortir (Testament, p.15), ni la mouche
qu’il a tuée en contrepoids de larmes qui ne venaient pas (p. 28), ni l’évocation
du poisson congelé que le père aimait (p. 82) et tant d’autres choses que
les poèmes ne contiennent pas souvent dont des allusions à la modernité
médicale par exemple (p. 79). On pourrait en faire toute une liste ou un
inventaire à la Prévert ! Mais
voici « Un autre quatrain » comme illustration :
Tandis que l’âme règle son compte à la
matière,
la douleur prépare
un lit à la délivrance,
la mémoire fait une
transplantation de passé
et le donneur est
la paix même.
La tristesse et la douleur du manque que
le nombre écoulé de jours sans le père suggère bien n’empêchent pas
l’humour, la dérision et un sens de la fantaisie qui se déploie souvent
dans les comparaisons et analogies qui foisonnent dans le recueil. Oui, les
comparaisons foisonnent ouvrant des espaces parfois métaphysiques, parfois
insolites, créant à chaque fois un léger déraillement entre le comparant et
le comparé : j’ai toujours le
dernier mot/comme la brique de lait vide… (p.15) ; Je porte à terme mes souvenirs comme ma
mère // a porté mes deux frères/dans son sein profond comme les astres. (p.21) ;
son absence tourne en rond au-dessus
de moi comme le charognard élevé au zoo… (p.22) ; ma peur a un jaune et un blanc / comme
l’œuf si ma mère le casse pour une omelette. (p.
23) ; deux pins d’un mètre
cinquante / scrutent le ciel / comme deux chérubins oisifs. (p.57) Tout comme Dieu, / les morts non plus ne
seront jamais / des civils. (« ça commence maintenant, p. 61) etc.
Un sens de la dérision, de l’absurde en
étroite corrélation avec l’humour distancé du poète se dégagent des vers à
travers tout le volume. Karoly Fellinger dans ses annotations quotidiennes (ou qui le
semblent) ne donne pas de lui une image particulièrement flatteuse, il ne
craint pas de faire tenir à son père à propos de sa poésie des propos peu
élogieux :
Perle
À tous mes amis
De la douzaine de mes poèmes
que mon père a lue,
tu peux choisir
celui que tu aimes le
plus
et tu peux le
réciter à ma mort
au chemin de la
Croix le plus proche,
le reste ne vaut
pas un clou.
Cependant dans son recueil, les
questionnements sur la poésie, l’allusion à son écriture, à ses éditeurs,
aux mots, à la langue, à la traduction ne manquent pas. Et le ton est
toujours plus ou moins grave et empreint d’auto-dérision :
En cachette
Dieu me tourne le dos
comme s’il traduisait
mes poèmes en une
langue
que ne parle aucun
de nous deux.
Il se fait vacciner
avant notre rencontre,
nous sommes si
proches,
il pourrait
facilement attraper
de moi une maladie
quelconque.
Il me serre la main avec des gants. (p. 71)
Retour
En se lisant, le poète encourt
une grande
responsabilité,
en pareilles
occasions,
il en finit avec
son âge
et si on traduit
ses poèmes
et que le
traducteur lui pose
au moins cinquante
questions
concernant
l’interprétation,
rien de surprenant à
ce que le poète ne croie
non seulement en
Dieu mais en l’existence non plus.
Sa langue y passe. (p.72)
Ces deux poèmes m’amènent à la dernière
piste pour lire ce poète si vibrant de justesse et de talent,
provisoirement dernière, cela va de soi, car cette étude lâche par
nécessité des pans entiers d’analyses possibles. Cette piste concerne le
rapport du poète à Dieu, aux textes bibliques et aux allusions aux mythes
grecs, en particulier, à Homère et à Troie. Le Dieu du poète a beau être
« atténué » (comme l’a si bien dit Supervielle dans La Fable du monde), il n’empêche qu’il hante le mental
de Fellinger bien que cette obsession soit
presque toujours à mettre en relation avec la mort du père ou d’amis.
Quatrain
À la mémoire d’Agnès Nemes
Nagy
Absorbée dans ses pensées
comme dans la grasse
terre nourricière
elle n’avait pas
beaucoup de choix,
Dieu lui a mis un parapluie dans la main.
(p. 85)
Ce qui nourrit, en revanche, de façon naturelle
la poésie de Fellinger c’est la Bible dont les
références sont légion de part en part du recueil comme s’il y avait une
imprégnation culturelle et cultuelle si évidente que les références dans
ses poèmes coulent de source, presque pourrait-on dire étourdiment, par
inadvertance.
Mais il y a aussi Troie qui revient à
plusieurs reprises et à chaque fois de façon très imagée :
Installation
Toute femme
enceinte est au fond
un cheval de Troie.
(p. 63)
« Mon passé est aussi vide que le
cheval de Troie/ que les couleurs ont déserté en se glissant/ dehors comme
des soldats gris. » (p. 26).
Le questionnement est inépuisable. Épingler les frémissements et émois
des jours, les prémonitions, les signes de présence (dès l’absence), faire
le compte des jours depuis … c’est aussi, de façon détournée, sans
arrogance, dessiner un art poétique que l’on pourrait résumer en citant ce monostiche intitulé « Ombre séchée » :
Le
poème est le test-surprise du silence. *
*C’est moi qui cite en caractères gras.
©Dominique
Zinenberg