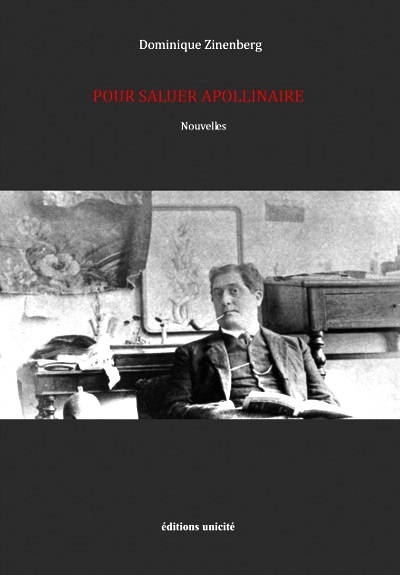|
LECTURE - CHRONIQUE
Revues papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |
|
LECTURES –CHRONIQUES
Dominique Zinenberg,
Pour saluer
Apollinaire
(Éditions Unicité,
2019)
dans la lecture de Nicole
Goujon
Je
voudrais saluer Dominique Zinenberg pour son livre Pour saluer Apollinaire, paru aux éditions unicité, 2019. Des
saluts en chaîne, des ponts entre les auteurs… Elle erra dans les rues de la ville. L’automne l’embrasait ;
Apollinaire soudain devenait si proche malgré l’océan du temps et de l’espace,
p. 79 « Thomas Hansen ». Des
saluts comme des ponts : le Pont Mirabeau… ou comme dans
« Zone » où Dominique ferme le rideau sur la scène des amis et des
grands noms inspirants : Nicolas de Staël, Picasso, du Bellay, Villon,
Hitchcock etc. Après un
enthousiasme de lecture, je me sens bien petite pour rendre compte de cet
ouvrage. Je ne connais pas Dominique Zinenberg et bien peu Apollinaire !
Mais, ce que j’aime c’est le parti pris de ce livre, son audace d’écriture.
Au premier abord, elle semble se protéger derrière un nom – Apollinaire -,
mais non ! En fait, elle s’affirme dans ce salut à la fois proche et
distant. Cette position me semble juste. Un
exercice magnifique ! A priori ce n’était pas gagné ! À l’arrivée,
oui ! L’essai est transformé et c’est un beau livre. Il s’agit
de dix courtes nouvelles (de 3 à 16 pages) dont les titres sont presque tous
originaux, à l’exception de « Zone » directement emprunté à
Apollinaire (premier poème d’Alcools),
du vers « Devant la douce mer d’azur et de sinople » (Lettre à Lou,
Nîmes le 11 mars 1915, p.200, L’imaginaire Gallimard) et un bout de vers de
« Les Colchiques » pour « Et ma vie pour tes yeux ». À propos
d’Apollinaire, Paul Léautaud écrivait : Il a fait une œuvre si personnelle, si neuve, qu’on retrouve son
influence jusqu’à des vers qui pourraient être de ses vers, chez bien des
poètes dont beaucoup ne l’avoueraient pas. » Eh bien Dominique avoue
tout et fait une œuvre si personnelle qu’elle ne copie, ni n’imite
Apollinaire, et, finalement, elle le cite peu … Alors que fait – elle ? Elle le
« salue ». Je ne vais pas pointer l’art subtil des références à
Apollinaire (la variété des formes que prend ce salut). Elle fait référence
et révérence. Elle salue un maître, un mage, une étoile, un guide, un
inspirateur, un ami, un initiateur certes, mais surtout un embrayeur
d’écriture ! (Le terme n’est pas très joli, mais je n’ai pas trouvé
mieux). Elle ose écrire ! Et pas comme lui ! Elle écrit justement
dans « Retournement » p. 19 :
jamais ne s’arrêtait pour
s’installer dans son espace à lui. Elle est
traversée, bouleversée, émue, habitée par la langue d’Apollinaire et déclare
dès le début du livre un ardent désir
des mots dans « Je dis nécessité », p.9. et
elle relève le défi d’écrire à sa façon à elle ! Elle écrit dans le
sillage, certes, sur la trace oui, dans l’alchimie de filiations secrètes,
mais elle écrit ses propres histoires en écho. Bien sûr,
elle convoque ouvertement Apollinaire dont les thématiques sont
présentes : amour, jalousie, solitude, abandon, femmes, amis, brûlures,
eaux de vie … elles sont là mais transformées, reconnaissables et
méconnaissables tout à la fois. Dominique
écrit de l’intérieur de la littérature, de l’intérieur de ses lectures, de
ses émois de lectrice. Ainsi dans « Thomas Hansen », p. 81 : (Le recours à la poésie de Guillaume
Apollinaire était de l’ordre du réflexe inconscient pour elle, à chaque
moment important de sa vie les vers du poète l’accompagnaient, elle en
connaissait beaucoup par cœur, ils étaient parapet, garde-fou, trésor dans
lequel puiser pour toutes les émotions, toutes les peines, toutes les
saisons.) Avec ce
« Salut à Apollinaire », Dominique tient son alibi d’écriture, son
prétexte, elle saute le parapet, dépasse le garde-fou … elle s’enhardit, elle
paye son dû à la littérature, sa dette à l’écriture, son émancipation … car
elle répond sur un autre terrain d’écriture en effet. On peut parler tout
autant d’un salut d’éloignement. Son travail a la double qualité de la
distance (observation, attente, retrait, discrétion, mélancolie) et de
proximité (perméabilité, sursaut) ; qualité de la distance si bien posée
dans « Et ma vie pour tes yeux » p.16 : C’était comme pendant l’enfance, quand elle se tenait silencieuse
dans l’embrasure des portes à observer les gens et le monde. Et qualité
de l’engagement, de la vie comme dans « Devant la douce mer d’azur et de
sinople », p.37 : Elle savait
vivre comme personne. Avec passion, avec emportement… Son avidité avait
quelque chose d’animal. Des
histoires donc, presque toujours des femmes. Des portraits dont celui d’une
jeune fille « Sarah Dinberg » p.29 :
Comme si elle était plutôt paysage que
personnage ». Des scènes. Des mises en scène. Les scènes sont de
nature, d’inspiration très différentes, faites d’approches difficiles, de
rencontres inabouties, de décalages, d’attente, de séparation, de guerre et
de poésie. Dans « Fugue » p.51 l’étudiante est bouleversée à la
lecture d’un vers et se rend compte que son professeur l’avait piégée dans ce poème mieux qu’il eût fait dans ses bras. Des
histoires bien menées, bien conduites, dans une économie du dire, épurées,
travaillées, ciselées. Je ne
peux pas et ne veux pas raconter plus car, si ce n’est déjà fait, vous lirez
les histoires de Dominique ! Pour
finir j’aimerais simplement citer quelques passages et souligner que les
premières lignes de chaque nouvelle sont souvent très belles. J’aime tout
particulièrement le début de « Voler » p. 41 : Le bruit familier, les odeurs familières,
les murmures, la gorgée de liqueur noire, amère, sur les lèvres d’abord, ce
deuil qu’on ingurgite, filtré par la rétine, comme si un café pouvait être un
Soulage et un sésame pour la plongée dans l’interdit. S’en suivent des
considérations sur l’écriture, la matérialité, la physique de l’écriture des hirondelles sur un fil électrique, le
blanc de la page. Et
poursuivre avec le drame, la Guerre 14-18 évoquée dans « Le
manque », p. 65 où plutôt que voir les hommes au front, on voit les
femmes aux champs : … Le travail
occupait toutes les sueurs. Tout était bataille pour la moisson, le soin des
bêtes, la répartition des tâches. Les femmes s’organisaient, ne se
ménageaient pas afin que tout ait l’air de fonctionner comme si de rien
n’était. Un mot
encore, le dernier sur « Zone » qui clôt le recueil et dans lequel
on suit Guillaume et son compère qui s’avancent dans un territoire sans
frontière et où Dominique esquisse un état du monde comme le paragraphe final
le suggère p. 90 : Des éclaboussures d’alcool s’égayent comme
autant de kaléidoscopes, de lumières psychédéliques et machines
électroniques, d’inventions foudroyantes, affolantes, de tableaux de bord aux
manettes magiques, de sésame ouvre-toi dans tous les lieux, des poèmes
fantasques court-circuitent les chemins battus, abolissent les rigidités de
la grammaire et du même coup déstabilisent les mentalités et créent de
nouvelles pépites. Dans notre monde déboussolé, nous marchons tous en
titubant, intoxiqués dans nos cellules étroites ou étrécies. C’est dans ces
lieux malades que nous faisons nos promenades quotidiennes… Zone de rave ou
de rêve, no man’s land abolissant les limites, c’est surprise de zone où tout
pourrait danser, se libérer, art poétique à vivre, sans le carcan des
forteresses et possessions. Voici donc tracé
un beau parcours littéraire, j’oserais dire… de A à Z,
d’Apollinaire à Zinenberg ! Présentation du
recueil de Dominique par Nicole Goujon, au Buffet
littéraire de février 2019 |
Créé le 1 mars 2002A visionner avec Internet Explorer
Note de lecture de
Nicole Goujon
Francopolis,
janvier-février 2019