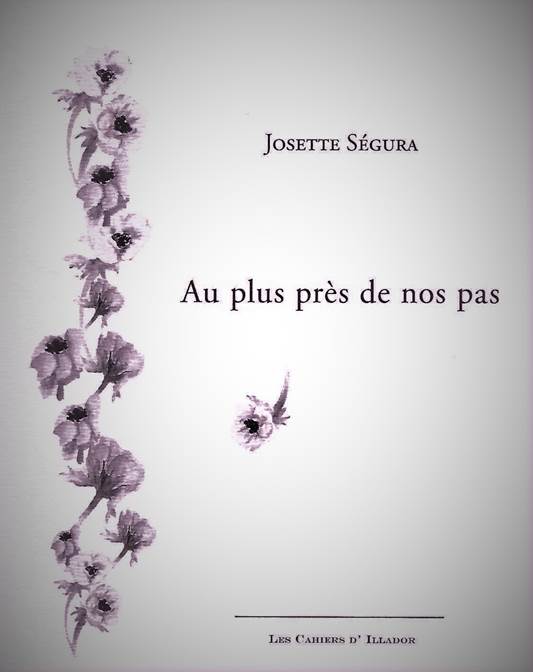|
LECTURE - CHRONIQUE
Revues papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |
|
LECTURES –CHRONIQUES
Note de lecture de Dominique Zinenberg :
Josette Ségura, Au plus près de nos pas
(Les Cahiers d’Illador,
2019, 54 p., 15 €)
Catherine Sourdillon pour le dessin de la couverture et le
frontispice
Peut-être que Au plus près de nos pas de
Josette Ségura pourrait passer inaperçu car le recueil chuchote des mots
familiers, souvent doux, feutrés, qui secrètent modestie des propos,
simplicité des mots, des situations décrites, une sorte de credo du quotidien
sans faste, sans prétention, sans lyrisme ostentatoire. Des pas, des promenades, des conversations,
des visites, des impressions frugales, légères et cependant, en filigrane, un
art de vivre, un art poétique, un souffle et un désir de spiritualité. Le recueil est accueil. C’est pour le
lecteur une invite au lâcher prise, à la douceur de la confiance en l’autre
comme si, devenus aveugles, nous tenions la main amie de la poète et que nous
nous laissions guider dans le parcours qu’elle a choisi pour nous, parcours
qu’elle aime et connaît bien ou qui même si elle en découvre une partie pour
la première fois, se relie secrètement à elle par une odeur, une lumière, un
charme, un « je ne sais quoi » qui lui permet de se l’approprier
comme s’il devenait déjà souvenir. Les prénoms d’inconnus qu’elle connaît,
fréquente, associe à de grandes tablées festives ou plus intimes, viennent
dans ses poèmes comme s’il allait de soi de les nommer pour nous qui n’avons
aucune idée d’eux. Et loin de nous agacer, cette énumération singulière crée
une fraîcheur narrative qui tient de l’enfance. Il n’y a que les enfants pour
penser que les adultes savent forcément de qui ils parlent quand ils nomment
des personnes. C’est curieux
comme le ton guide, il y est ou il
n’y est pas, comme une voix
dans la voix, sinon tout
tombe à plat, « Il y a une petite
musique, on ne sait pas
ce que c’est » disait Gaston.
(p.10)
Gaston, Annette, Anne-Marie, Marie-Madeleine, Bernadette lovés dans le
recueil au même titre que « mon père », une jeune fille, un anonyme
qui perd un peu la mémoire (Il se penche, / nous parle de la pente d’eau,
/ il ne sait plus où elle se trouve, / « ah ! c’est ma tête » etc.)
(p.24), tous participent du poème, de son élaboration, de sa possibilité.
En les nommant, Josette Ségura les intègre à ce qui est le plus
précieux : la trame de sa vie et de la poésie. Elle donne à entendre la
polyphonie sacrée de l’amitié ou de l’humanité croisée au hasard des
rencontres, des lieux visités (qui eux aussi sont nommés avec délectation,
comme en écho aux noms des personnes : Rocamadour, Rodez, Albi, Veilhes,
le Tarn, Montauban, Aveyron, le Valais, Martigny etc.
Donner la parole à, rendre la posture ou la gestuelle de quelqu’un,
faire affleurer les fantômes depuis le rêve, saisir une odeur, une sensualité
de tarte ou d’œufs à la tomate, s’émerveiller du cri des premières cigales de
mai, de la beauté apprivoisée d’un jour que l’on a cru simplement
« banal », voilà ce que la poète fait en écrivant avec l’exigence
du « ton » qui « guide », le réflexe de la rature (Tout
écrire/barrer ensuite/ cette chute/ avait besoin de cette rature pour
apparaître,/ tout sert, / les mots en trop, les vers loupés, très mauvais
même, / met en chemin.) (p. 30), le désir, non pas d’emprisonner la vie
dans un poème, mais tout au contraire lui insuffler la vie par la vie
même : On
soupèse, on sent comme un livre déjà au bout des doigts, on a le titre mais peut-être en
faudra-t-il un autre, la neige est annoncée, j’aurais voulu garder quelques flocons
dans un poème, comme si, notant, je voulais faire entrer de la vie. (p. 40)
Les poèmes du recueil sont courts. Ils sont élagués, épurés,
concentrés. Ils forment des tableaux qui concrétisent une impression, un souvenir,
une couleur, une senteur, un chant d’oiseau. L’encadrement peut-être une
fenêtre à travers laquelle l’on voit un paysage, on suggère une saison, mais
c’est aussi la page blanche ou déjà écrite. Quelque chose que l’on peut
appeler « coïncidence » entre le dehors et l’intériorité de la
poète doit palpiter pour qu’il y ait éclosion poétique, naissance d’un poème.
Je
gratte le givre de la vitre, je dessine une petite fenêtre à rayures, un jour, ces trois enfants qui rient, ne me verront plus que comme ça, derrière la fenêtre de la coïncidence. (p.
27)
Une autre coïncidence se dessine à travers le recueil et qui se susurre
ou se suggère plus qu’il ne s’explicite : c’est la coïncidence entre la
vie banale, légère ou grave, flâneuse, visiteuse, rêveuse et le lien ténu,
peut-être espéré, peut-être ressuscité avec une certaine foi chrétienne. Et
cette impression ne naît pas seulement de l’attention portée aux abbayes,
mais de l’irruption soudaine dans les derniers poèmes du recueil de la figure
de Marie-Madeleine ou de celle de Bernadette qui ne sont plus tout à coup de
simples prénoms d’amies dont on épingle un comportement, mais les
contemporaines du Christ. Ainsi Josette Ségura suggère-t-elle que certains
êtres vivent de façon séculaire l’expérience du temps de la vie de Jésus
comme si la chronologie et le passé s’abolissaient dans la foi du présent. […] Marie-Madeleine
se met à courir vers les apôtres, essayant de
ne pas trébucher sur les pierres du chemin dans les
parfums d’herbes du matin, Bernadette dit des mots qu’elle
ne comprend pas, comme
lorsqu’on se lance dans un poème qui
finalement en sait plus que nous, ce qu’il
cache
sautera aux yeux
plus tard, comme si
souvent après coup tout nous
atteignait encore davantage. (p.43)
Le dessin de couverture et le frontispice de Catherine Sourdillon sertissent avec délicatesse le recueil-bijou
que Josette Ségura nous livre pudiquement comme on donne un sourire : J’aurais dû d’ailleurs leur parler, laisser monter un sourire (p.31)
Mais chère poète, c’est ce que vous avez fait ! Dominique Zinenberg |
Note de lecture
de
Dominique
Zinenberg
Francopolis,
septembre-octobre 2019