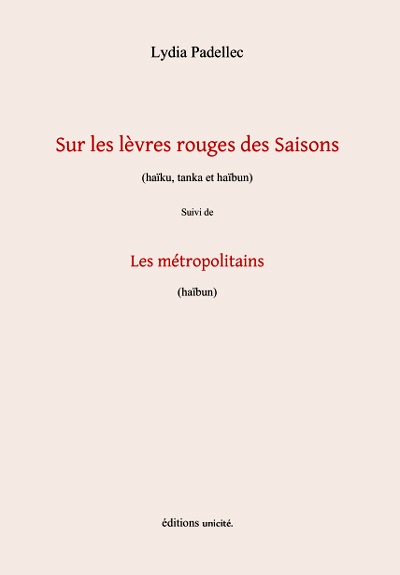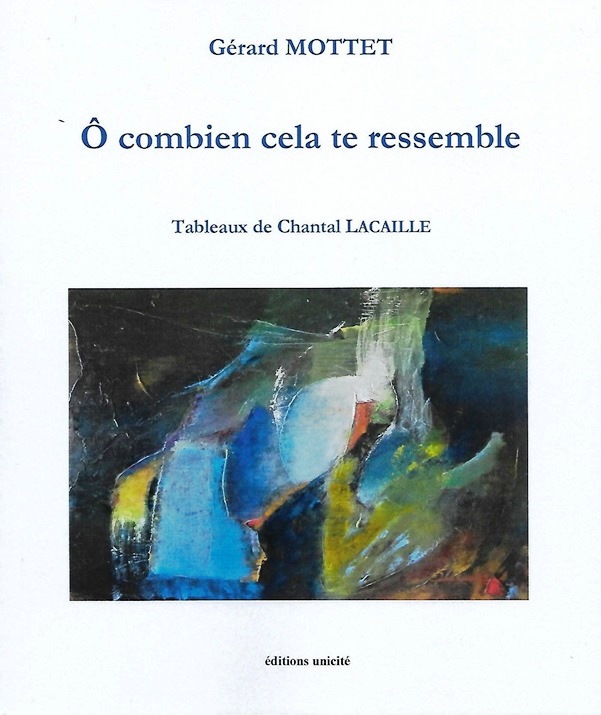|
LECTURE - CHRONIQUE
Revues papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |
|
LECTURES –CHRONIQUES
Petites études de Dominique Zinenberg
1. Lydia
Padellec, Sur les lèvres rouges des
Saisons, suivi de Les
métropolitains, Éditions Unicité, 2019
(13 €) C’est à partir de trois formes poétiques
japonaises – le haïku, le tanka et le haïbun – que
s’élabore le recueil de poèmes de Lydia Padellec. L’influence de la tradition
nippone croise l’influence bretonne ou parisienne. L’exotisme formel permet
le regard renouvelé, candide et de fine observation du quotidien français. La
poésie naît de cet écart subtil entre deux cultures et la sensibilité
singulière de la jeune femme fait le reste. Dans Sur les lèvres rouges des Saisons, l’année commence en automne et
se termine en été. Tout vibre et vit d’une vie concrète et cependant
imprégnée d’une ambiance musicale, d’une culture littéraire, nichée dans
l’ombre, et tapie sous la tempe créant un dehors de feuilles qui tombent du
fait de l’automne, de pages que l’on pourrait tourner, feuilles murmurant les
secrets des livres réunis dans un désordre anachronique qui relie des
affinités secrètes et mystérieuses de poètes dispersés dans l’espace et le
temps, et aimant de la feuille blanche de la narratrice qui cherche les mots
d’encre de la nuit. Je tourne en rond autour de ma page blanche.
L’âme comme anesthésiée. Amnésique. Les pulsations du cœur et de la pensée
ralentissent. Le sommeil guette la moindre faiblesse. On écoute dans le
clair-obscur. Les branches de l’érable frappent doucement à la fenêtre. Au
loin, un chat miaule en regardant la lune. On voudrait remplir le vide avec
de l’encre. L’opacité des mots. La nuit toujours la nuit. Et la voix de
Billie si proche de mourir. (p. 18) Les haïkus naissent du tâtonnement de la
prose, à partir d’une pénombre, d’un murmure et d’une musique écoutée en boucle,
il surgit comme un fantôme – produit insolite, inattendu, improbable –
arraché des mille riens fugitifs du moment, du passé breton qui rejoint
l’instant de tous les métissages et strates culturels issus de la nuit
d’automne : Sur mes lèvres un goût brûlé de crêpe au blé
noir (p. 18) Ainsi le chant de l’automne est fait de
feuilles et d’or, de pluie, de châtaignes, de tartes aux pommes, de présence
du chat et d’absence et solitude comme le tanka suivant le suggère : Trois jours
Que les feuilles du magnolia Tombent Trois jours
Que j’attends ton texto (p. 25) L’hiver est pèlerinage et neige. Pour Lydia
Padellec comme pour René Char, l’hiver est hypnose. La blancheur est un
passage, une traversée vers le rêve et le rapt du silence à même les mots. La
morsure du froid, la cruauté de la vie ou sa douceur se disent en tercets
fulgurants : Paris blanc de
neige dans la cabine téléphonique un SDF dort (p.36) Dans la nuit
d’hiver un flocon sur mes lèvres pour tout baiser (p. 37) L’expérience de neige d’aujourd’hui est de
même nature que celle des neiges d’antan, qu’elle rappelle lointainement
Villon ou les poètes-pèlerins du Japon, qu’importe, ce sont des strates de
neiges qui superposent les temps ou les lieux, et produisent la même émotion,
le même ressenti si humblement humain : Aujourd’hui, je marche seule dans la
neige. Je pense aux haïjins, à Bashô, à Santôka, qui partent seuls en pèlerinage à travers le
Japon. Les flocons sur mon visage. Les mêmes sur leur visage. (p. 31) Comme dans les romans courtois, l’amour
vient avec le renouveau. La musique le précède, mais la fleur de pissenlit
annonce l’émoi du printemps ! Le prélude haïbun,
cette fois-ci, célèbre la guitare ou le guitariste, qui sait… Les haïkus
peuvent éclore dans Paris amoureux. Pensant à toi des akènes de pissenlits dans le vent (p. 47) Le printemps n’est que fleurs : un
chapelet de fleurs au fil des haïkus et tankas : glycine, azalée,
pétales, pâquerettes, rose, coquelicots … et pourtant nous sommes à Paris. Des frémissements sensuels traversent ce
temps printanier. Seul le chat semble
traverser les saisons dans une permanence rassurante : Déclin du soleil se
faufile entre les fleurs l’ombre
d’un chat noir (p. 50) Le printemps n’est qu’oiseaux, papillons,
langueur de l’attente ou bonheur des présences : Pluie battant le
volet – ton
souffle chaud sur
mon cou (p.50) Les lèvres, comme la présence du chat,
continuent d’être rouges ! Et la jeune femme, poète, étrenne un nouveau
carnet, pense à ses manuscrits :
Pensant à demain des
manuscrits en attente –
envolées de pétales (p.51) L’intimité amoureuse, rêveuse, primesautière
envahit les pages comme un baume. L’été est éblouissement et souvenir. Retour
à l’air marin et à l’enfance. A ce qui n’est plus
et pourtant ressurgit. A ce qui sépare : des
jours passés, révolus, de l’amoureux ailleurs qu’avec elle, de la grand-mère
disparue. L’été claque : c’est un ressac temporel sans tristesse, mais
sans émoi non plus. Heureusement, le chat continue son esquisse fidèle.
Le chat noir sursaute
près de lui
l’ombre d’une mouette ! (p.61)
Tanka
Séparation estivale – Dans
ma chambre Fermée
à double tour Je
relis la carte Que tu
m’as envoyée (p. 66)
Avec Les métropolitains qui
suivent Sur les lèvres rouges des
Saisons, Lydia Padellec nous fait voyager dans le métro parisien et grâce
à lui, dans bien des contrées du monde. Dans la première partie, ce sont,
dans des poèmes assez courts livrés en italique, ce qu’elle appelle des
« Fragments de vie » ; dans la seconde, des haïbun c’est-à-dire de courtes proses après lesquelles
l’on trouve un haïku. Dans
« Fragments de vie », nous sommes déjà avec elle dans le métro, nous
l’accompagnons de ligne en ligne, voyageant doublement dans Paris et dans les
pays que le nom des stations fait surgir. Chaque poème ressemble à une chanson
rythmée, assonancée. C’est une rêverie éveillée charmeuse et rappelant la
cadence du métro : Sur
la ligne six la « Place d’Italie » me
ramène à mes dix-sept ans la dolce vita
et la chapelle Sixtine. Je lisais Baudelaire et son
Invitation au voyage rêvant d’un pays qui nous
ressemble … À « Bir-Hakeim » s’ouvrent les portes du désert le souvenir de batailles d’hier et les cris de liberté d’aujourd’hui. On
dit aussi que là-bas au cœur des palmeraies natales l’arbre s’incline pour
écouter le chant clair des poètes. (p. 77) Dix textes
forment « Les métropolitains » et tout un monde croqué,
cosmopolite, surgit. Des gens du monde entier. Des enfants, des vieillards.
Des Africains, des Asiatiques. Destins fugitifs que le regard de la poète fixe
un instant. Fragilité, densité. Scènes instantanées au milieu des trajets
dans la capitale. Lydia Padellec est essentiellement un regard, une
cinéaste qui saisit l’instant magique improbable que son acuité capte. Assises côte
à côte mère et petite fille portant le sari (p. 86) À cette acuité du regard s’adjoint un
élan humain sans mièvrerie, juste, clair et saisissant. Je donnerai pour
finir l’exemple du neuvième haïbun, page 91 : En descendant à la station Montparnasse de
la ligne 6, à toute heure de la journée, on découvre, assise sur les marches
des escaliers, une petite vieille, maigre et pâle, vêtue d’un T-shirt
pailleté. (…) Les gens passent sans la voir. Sauf les enfants qui la
regardent, intrigués. Le poète aussi la regarde. On dirait une fée, une fée
déchue de ses pouvoirs, invisible et silencieuse. Son visage semble chanter
une mélodie triste et muette. D’où vient-elle ? Quelle est son histoire ?
Les gens passent sans la voir. Sera-t-elle encore là demain ? Sur
ses mains ridées entrelacs de veines bleues encre indélébile |
|
2. Gérard
Mottet, Ô combien cela te ressemble,
tableaux de Chantal Lacaille, Éditions Unicité,
2019 (18 €) Ce recueil de poèmes et tableaux se divise
en deux parties : la première « Jeux de miroirs » contient 21
poèmes inédits entrecoupés de neuf tableaux ; la seconde
« Portraits sans visages », sous-titrée « Petite
anthologie » est un choix de 21 poèmes personnels de Gérard Mottet
extraits d’autres œuvres déjà publiées, eux aussi rythmés par douze tableaux
de Chantal Lacaille. Tableaux non figuratifs définis comme « abstraction
lyrique », ayant en commun la couleur bleue qui se décline de façon
nuancée, façon kaléidoscope permettant de recevoir ces abstractions comme
autant de possibilités d’évolutions du vivant. Toutefois son dernier tableau,
hors champ, en quelque sorte, est le seul ayant un titre « La guitare
amoureuse » et sa couleur dominante est le rouge. Il suggère dans la
peinture même la dimension musicale des couleurs et le rappel que la poésie
est aussi musique. Le thème majeur des poèmes du recueil est
la quête de soi. Avec la poésie de Gérard Mottet, on n’est jamais très loin
de la philosophie, ni non plus de la chanson, mais c’est une philosophie qui
s’incarne dans les paysages, dans l’attention toujours renouvelée aux quatre
éléments comme à la condition humaine fragile, à la fois enchanteresse et
dérisoire. Un va-et-vient constant s’effectue entre le soi, intime, questionneur,
qui jette un regard indulgent et mélancolique sur la vie et tout ce qui
cerne, entoure, embrasse et sépare l’homme des autres. Mais l’intime et
l’extérieur ne sont qu’un leurre car il suffit de bien regarder, d’être du
côté de la vision pour reconnaître le rapport secret entre l’extérieur et
l’intime. Voir et écrire, c’est saisir la porosité entre dedans et dehors,
c’est capter les images de soi à travers le miroir des choses, des êtres, des
paysages et des nuances des jours. Quelque chose d’une très grande fragilité
se dégage de ces textes doux et mélancoliques. La vie défaillante, le
sentiment de la brièveté de l’existence parent toute chose d’un voile de
tendresse d’où l’impression d’une volonté de déceler la moindre étincelle de
vie dans chaque chose et d’éveiller le prochain à la modestie de son expérience
forcément parcellaire et limitée. Tu
ne verras jamais que l’infinie variété des ombres et des reflets jamais le flot pur et limpide de la rivière (p. 29)
Le besoin de transparence rejoint la quête d’identité. Il faut savoir
qui on est et on approche de ce savoir faillible et incomplet en observant la
nature, comme si, en scrutant son mystère, on ravivait ou faisait naître des
paraboles guidant l’existence. Qu’es-tu
d’autre ? Comme
d’autres des
pépites d’or dans le sable tu te cherches dans le mouvement de la vague tu
écoutes le
cri de la nuit qui t’appelle qu’es-tu
d’autre qu’un ancien écho de toi-même ? (p. 18)
Le travail poétique consiste, parallèlement à l’évocation de la mer,
comme ci-dessus, de mimer le rythme de la vague, de le rappeler pour faire surgir
au cœur de l’interrogation existentielle la vague concrète comme si on
l’avait devant soi.
Avec Gérard Mottet le questionnement philosophique est concomitant à
la contemplation : l’un s’aimante de l’autre ou se nourrit de l’autre. Et voici pour clore cette ébauche d’analyse,
deux exemples dans la partie « Portraits sans visages » : Transparente
la nuit Transparente
la nuit les disques traversent l’aurore des paupières l’amour
l’espace noyés les rêves les torrents étoilés. Crevasses
du temps l’espoir gercé de sang écrira sur nos lèvres les paraboles fleurs astrales fluorescence des neiges nous deviendrons transparents dans la
nuit. Ardente
sur nos corps d’exil passera l’avalanche des lunes échevelées cris révolus d’insomnieuses blessures les mers les récifs la mouvance est en nous. Corail
d’oiseaux presqu’île blanche à travers les algues du ciel et les métamorphoses
rougeoie l’éclat des soleils triangulaires.
(p. 69) Certitude
d’être soi-même Certitude
d’être soi-même ici en
son enclos ou
bien errance au gré des vents
de nulle part pourquoi te faudrait-il choisir ici là-bas dans cette quête de
toi-même entre même
et autre toujours te guette l’exténuement
de l’être maison que tu croyais refuge
de ton âme fragile
hutte aux murs de paille au toit d’écume n’entends-tu pas ce vent d’autan qui cogne à ta fenêtre et quand ton âme à marée
basse barque en
latence aux voiles repliées sera comme enlisée dans les sables du temps gisante abandonnée alors comme
un sursaut que tu n’attendais
plus te reprendront bientôt les vagues de la mer.
(p.76) |
Créé le 1 mars 2002A visionner avec Internet Explorer
Petites études
de
Dominique
Zinenberg
Francopolis, janvier-février
2019