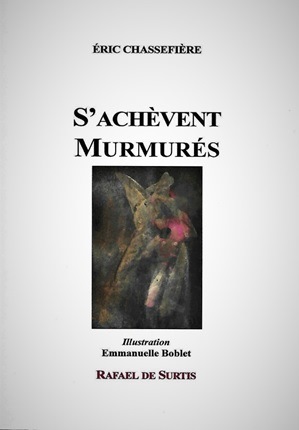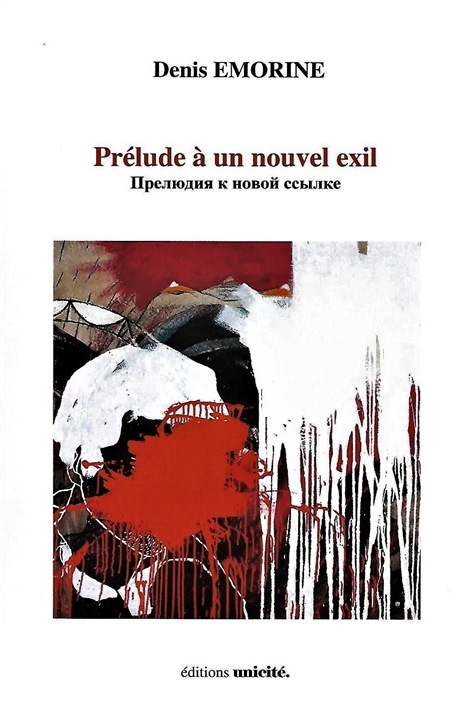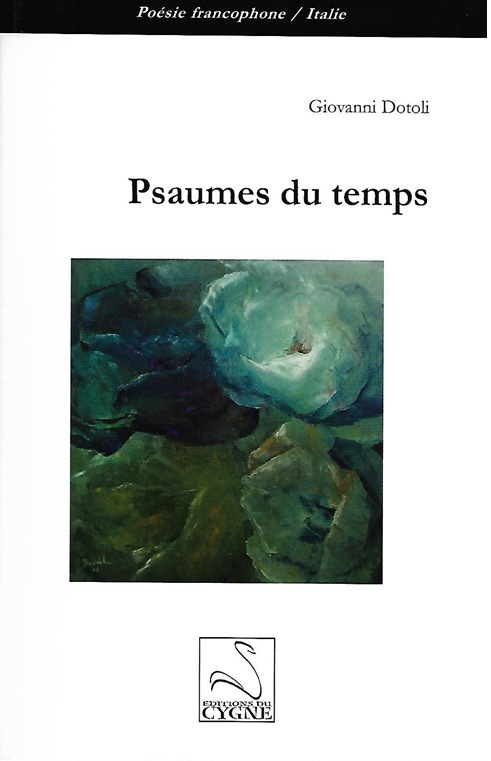|
LECTURE - CHRONIQUE
Revues papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |
|
LECTURES –CHRONIQUES
Notes de lectures de
Dominique Zinenberg
1. S’achèvent
murmurés d’Éric Chassefière, éd. Rafael de Surtis, 2017 S’achèvent murmurés est composé en trois parties. La
première porte le titre même du recueil, la deuxième s’appelle
« Cantique », la troisième « Lumière d’août ». Ces trois
parties ont pour point commun l’absence de ponctuation. La première et la
troisième ne comportent que des poèmes d’un nombre de vers sensiblement égaux
et tenant chacun sur une page. Pour « Cantique », comme dans la
Bible, parfois, chaque page contient deux colonnes. Le
poète épingle des riens, des choses murmurantes et murmurées. Ce sont de
fines et imperceptibles impressions sensibles, une sorte de pointillisme
littéraire qui capte des nuances : bruissements, jeux de lumière,
variations des couleurs, du vent. Que des frémissements dans l’air et en soi.
Ce qui passe. Ce qui frappe un instant ou émeut. Il faut pour cela peu de
mots, l’art consumé de la litote, du presque rien qui se tient au bord des
lèvres, que l’on contient, retient pour que soit saisi la ténuité du frisson,
le reflet du jour, de la nuit, la musicalité des voix, des sons, la grâce des
mouvements (du chat par exemple). Dans la première partie, dire le monde des
jardins, de l’air, des émotions, du poudroiement de la vie quotidienne,
privée ou impersonnelle, n’est possible que si l’on utilise essentiellement
les phrases nominales, comme pour constituer une mosaïque d’émotions mises
bout à bout et formant finalement sens et dessin. Dans
« Cantique », l’omniprésence du « je » et donc de la
phrase verbale constitue une vraie rupture. Le « je » se
démultiplie, quitte à se contredire, car la vie, le rythme, les sentiments
varient comme l’air et le vent. Le poème est un long kaléidoscope de moi
distincts, de métamorphoses lumineuses et comme endiablées qui crée, malgré
le cadre sage, une impression tourbillonnante, comme s’il nous était donné la
possibilité de s’ouvrir au cosmique par le biais magique de la langue. Car
c’est la langue qui nous transforme sans cesse, c’est elle qui élargit les
bornes, crée les vertiges du microcosme comme du macrocosme. Elle est la
magicienne inaltérable, inépuisable qui nous ouvre au chant et nous propulse
dans le domaine du Cantique qui est mystique et danse amoureuse. Car, comment
ne pas entendre dans ce chant, un nouveau Cantique des Cantiques, comment ne
pas ouïr cette vaste musique à la fois primitive, primordiale et
mystique ? Lumière grappe Des chants Dans les arbres Nouveau jour Ancienne nuit Je suis le miroir Je suis les lèvres Mots réverbérés Corde pincée Du silence Je suis la page La partition Je m’écris musique Sous l’âge des mots Je suis le silence Je suis la voix Je suis présent À la présence J’écoute Je ressens Je vis Je suis mort Et je vis Terre lourde Yeux ensommeillés Je suis paupière (p.43) Avec « Lumière d’août », le descriptif des
atmosphères de nouveau se déploie, subjectif et éphémère, d’une exactitude
frappante pour saisir les jours d’août écrasant ou lumineux, orageux et
lourds. Mais les poèmes sont plus narratifs dans cette dernière partie. Il y
a de l’événementiel, même infime, quelques gestes, quelques actions dans le
paysage marin (la vision d’un cheval/et de son cavalier/ pénétrant lentement/
dans la mer d’huile/guidés par un autre/qui très doucement/amène la bête/ par
courbes successives/ à l’immersion complète/ tête de la monture/ buste du
cavalier/émergeant seul des flots/ dans le vide paisible de la lumière, p.
61). Et peu à peu la pesanteur et la touffeur d’août sature les poèmes, la
présence de la lumière se fait plus forte et dense et « la vie en
arrêt » murmure des pensées existentielles sans pathos « la vie
s’écoule » « échos sans nom/ de la même unique voix /qui dit le
silence de vivre/ la douceur caressée du soleil/ multiple profond aux tamis/
des arbres des jardins, p. 69) Quand on referme le recueil, une certaine paix mêlée de
quelque frisson d’âme, d’un rien d’inquiétude latente, et d’un rythme musical
très sûr, envahit le lecteur, songeur et admiratif pour ce travail ciselé et
minutieux restituant si bien paysages, sensations et états d’âme. |
|
2. Prélude à un nouvel exil de
Denis Emorine, éditions Unicité, 2018 La poésie me tient
lieu d’épitaphe dit
le poète dans « Lettre du poète assassiné » (p. 65) et il est vrai qu’en
lisant la poésie de Denis Emorine, on ressent avec force le lien des mots
avec la mort, comme si chaque poème était une stèle pour les nombreux
disparus auxquels le poète rend hommage dans ce recueil. La tragédie se joue dès l’enfance et se
scelle dans le regard de l’enfant sur son père qui, entre deux sanglots, [dit] :
« J’adore la Russie ! Je hais l’URSS ! ». (p.22) La douleur de l’exil a fixé des images
traumatiques qui reviennent de façon lancinante tout au long des pages. La
neige, le sang, la séparation, l’amour, le deuil, l’interdit de l’art et la
mort des artistes, tout cela est ressassé avec violence et force comme si
chaque poème était le récit d’un cauchemar qui se nuance à chaque fois de
composantes différentes mais dont l’effet produit, en définitive, est le
même. La superposition des destins de ces résistants au régime implacable et
inique de l’Union soviétique crée toute une chaîne de gens martyrisés qui se
rejoignent dans le désespoir et la mort. Le temps semble s’être figé à cette
époque sinistre séparant l’Est de l’Ouest. Le texte tout entier matérialise
des frontières innombrables : À ce
moment-là/la frontière s’est refermée devant moi (p.30). Des frontières physiques bien réelles qui
ont marqué le fils observant le père, exilé, nostalgique d’un pays
méconnaissable, aimé comme pays, haï comme régime. Exil d’autant plus violent
qu’il a conduit au ravage morbide du narrateur enfermé dans son deuil et dans
son attirance fascinée pour le pays originaire idéalisé du père. Des frontières mentales aussi qui opposent
deux mondes : celui du passé par rapport au présent, du rêve par rapport
à l’état de veille, de la vie par rapport à l’amoncellement de morts. Les frontières pourraient être étanches et
elles le sont parfois de façon tragique : Chaque
soir sous la mitraille tu vérifies la solidité du fil tendu entre l’Est et l’Ouest il fait si froid dans le cœur des hommes. Vivre
est un blasphème (p.38) Mais il
y a aussi une porosité des frontières dans le sens où la pensée du malheur
qui se joue à l’Est envahit et contamine les exilés qui endossent cette
douleur et ne font plus qu’en être chavirés ou, à l’inverse, il y a ceux
comme Sacha, qui de retour à Moscou gardent Paris dans un coin de leur
tête : Sacha
nous avons parcouru un même chemin de douleur à Tcheriomouchki parfois les cailloux de l’Histoire nous empêchaient de passer tu les retirais pour moi avec douceur tu n’avais pas quitté Paris dans un couloir de ta tête. Tu
m’entraînais avec toi sur des bateaux usés par les guerres j’avais parfois peur de monter à bord de ta poésie mais tu savais me persuader de te suivre Sacha Sacha
assassiné une étoile rouge gravée au milieu du
front nous n’avons pas su comment faire douter la mort ni apprivoiser les rossignols en leur lisant tes poèmes. Dans
ma tête je peine à te retrouver un merisier n’en finit pas de pourrir dans mon cœur. (p.39-40) L’impossible
deuil de tous les poètes assassinés, de tous les pianistes tués, c’est cela la
porosité, celle qui ne permet plus d’être délivré du poids du passé, qui fait
barrage au présent, qui installe dans un deuil indéfini et infini. D’où ces
visions hallucinées qui jaillissent de poème en poème, lacérant les vers de
descriptions brutales, sans merci, qui créent des arrêts sur image sanglants,
désespérés, comme si on tenait au creux des mots non seulement la vie
arrachée et le mal absolu qui se manifeste, mais le vol d’œuvres à jamais
lacérées, inachevées, sacrifiées. Le
sang du compositeur coulait sur sa musique/éparpillée sur le sol/ quelques
notes s’échappaient de ses blessures/ elles se cognaient aux murs / de la
chambre/avant d’expirer (p.48) De
l’autre côté de la frontière ils me dévisagent en m’apostrophant dans une langue inconnue (les soldats ne me quittent pas des yeux le doigt sur la détente) j’ai envie de crier : « Mon cœur est à l’Est ! » mais ils ne comprendraient pas mes bras sont chargés des poèmes que nous avions fait sécher au soleil pourquoi prennent-ils feu tout à coup ? De
l’autre côté de la frontière la neige de Marina a tout recouvert
(p.29) Le
poète est si vulnérable à cette tragédie de l’Est qu’il en est imprégné au
point de s’identifier complétement à ses martyrs. Une confusion existentielle
le happe aussi bien quant à l’amour (son absolu ou ses roueries, séduction et
trahison/dénonciation) qu’à la mort. Et cette imprégnation est aussi d’ordre
littéraire et artistique. Il nomme poètes et musiciens. Il dit, au détour
d’un vers, qu’il n’est pas dupe et qu’il sait l’idéalisation des mots des
romanciers, des écrivains évoquant les paysages de l’Est : …
j’ai eu envie de tourner les talons/ pour repartir dans la forêt de
bouleaux/qui n’existe pas/ sauf dans la Russie de mes livres. (p.30) mais
« le grand pays glacé » n’en finit pas de l’obséder comme un point fixe,
invariable, énorme, crevant l’écran de ses nuits, de ses jours en un Prélude à un exil intérieur qui ne peut que se renouveler sans fin. |
|
3. Psaumes du temps de Giovanni Dotoli, Éditions du cygne,
2017 Psaumes
du temps
comporte trois parties : « Fils de la vie », « Levure des
jours » et « Le cortège du temps ». Le recueil tout entier se blottit dans le
cocon de l’imparfait de l’indicatif à deux ou trois exceptions près. Ce temps
fonctionne (comme on le sait) comme le temps de la durée indéfinie, comme ce
qui fait arrière-plan, une sorte de continuum qui baigne littéralement les
mots dans l’amniotique des récits bibliques, homériques, dans les contes, (Les Mille et une Nuits), les jeux de
l’enfance. La poésie vient de l’enfance, raconte
l’enfance, permet de la prolonger, promet son ancrage dans un temps qui est
celui de la vie tout entière. Giovanni Dotoli rend donc tout naturellement un
éloge vibrant aux mots qui sont le vrai trésor du poète : Je
cherchais mon langage Il
était sur une grande pierre Je l’ai
soulevée de mes bras Le
langage apparut Après
quelques minutes il devint dictionnaire De mon cœur et de ma vie Il
contenait tous les mots de la terre Contre
mes folles incertitudes Le
dictionnaire dans la poche je suis parti (p.69) Tel un autre Thésée, le poète conquiert le monde et les
expériences en dénichant sous la pierre, non pas les symboles phalliques du
père, mais le langage qui crée le même élan de départ que celui du héros
mythologique. Et tout est départ, mouvement, voyage dans ces temps
des commencements et de la formation. Ce qui se déploie, pas à pas, poème après poème, c’est
la genèse du monde pour l’enfant, sa joie pure à simplement être (et l’on
pense cette fois-ci bien qu’aucune allusion directe à Baudelaire ne soit
faite aux deux quatrains de « Bénédiction », poème liminaire des Fleurs du Mal, comme si G. Dotoli ne
faisait que déployer ces vers :
Pourtant, sous la tutelle invisible d’un Ange,
L’Enfant déshérité s’enivre de soleil, Et dans
tout ce qu’il boit et dans tout ce qu’il mange
Retrouve l’ambroisie et le nectar vermeil. Il joue
avec le vent, cause avec le nuage, Et
s’enivre en chantant du chemin de la croix ; Et
l’Esprit qui le suit dans son pèlerinage Pleure de le
voir gai comme un oiseau des bois.) Oui il déploie ces vers de Baudelaire, reprenant les
mêmes thématiques : « Je notais la musique de l’air »
(p.12) ; « Les arbres l’herbe les pierres/Le sable les toits les escaliers/Les
routes les sillons les maisons/Avaient-ils une voix ? (p.20) ;
« Des gouttes de miel tombaient du ciel » (p.27) ; « Sur
mon front souriant/ Nostalgie de la vie qui sera// Les arbres faisaient
l’amour/ Les branches dansaient en la// Tes voiles tentaient ma pureté/ Dieu
se promenait par profondeurs // La terre fleurissait de gaieté/ J’étais
l’errant de la fortune » (p. 42) À cet espace baudelairien latent
s’ajoute l’espace rimbaldien conscient qui s’égraine
par poussée de poème en poème, allusivement, puis par le nom même du poète
page 53 : « Au fond apparaissait Arthur Rimbaud / Avec sa bande à
musique ». Dès le premier poème du recueil, il est question de
l’ «Alchimie du ciel », puis page 26, le premier vers nous met la puce à
l’oreille « Les mains dans les poches trouées » et un peu plus loin
« Par les voyances des couleurs » et au poème 19 de la première
partie, « L’éclat de la confiance/ Illuminait le chant de la
nature » nous installe déjà dans Les
Illuminations comme le premier vers de J’allumais le feu « À l’ aube face au soleil rouge »
( page 39) ravive « L’aube » de même que le dernier vers de
« Chemin de flammes » rappelle le dernier vers de ce même poème de
Rimbaud « Il était midi sur le clocher » (Au réveil il était midi) . L’éveil à la nature et à la beauté du monde est
concomitant à celui de l’éveil spirituel et culturel, d’où la présence
méditerranéenne biblique, latine et grecque des oliviers, des amandiers, de
tant de soleil et lumière et de la soif aussi.
J’habitais la poésie
du soleil
J’enchantais la parole de soupirs
Les oliviers se mariaient avec la vigne Les figuiers avec les amandiers
Racines de rayons d’enfance
J’avais la fièvre du poème La
grande cloche parlait
La voix de la pluie et du vent
Je faisais les noces avec la nature Le temps s’étire tout au long de l’enfance, la
rappelle, la décrit, d’abord circonscrite à un dehors restreint, au chant et
paroles de la mère et du père et en tant qu’infans, le narrateur-poète déclare J’étais au lieu du silence. Un peu plus loin, poème 9 de la première
partie, l’enfance se révèle par la maladresse gestuelle « mes pas
trébuchaient dans la ruelle/ Que d’escaliers à monter ! Que de cieux à
explorer ! », puis peu à peu les pas vont plus loin, l’œil voit
s’étendre l’horizon et tout un champ lexical traduit l’idée de la route, du
chemin (fil, sillon, parcours, route,
chemin, trajet, ligne, trace, exode), de l’exploration du monde, de sa
dangerosité exponentielle comme le poème-parabole de la page 23 le laisse
entendre : À
cinq heures du matin
Dieu s’asseyait sur le bord de ma fenêtre
Il contemplait l’azur et les êtres humains « Quel chaos – disait-il –
Chacun ne pense qu’à son jardin »
Il lançait des signes de dialogue
Mais le monde suivait ses choix
« Le jeu ne durera pas » - murmurait-il –
Puis ça et là des guerres
Des
fumerolles derrière l’horizon
Il revenait le matin suivant
Plus de feu que le jour avant « Ces hommes-là sont
difficiles à corriger » Ainsi le « je » imprégné de culture biblique
restitue et continue les « Psaumes » nourri qu’il est d’épisodes de
l’Ancien comme du Nouveau Testament. Le chant qu’il entendait fredonner par
sa mère, berceuse peut-être, le verbe des luttes du père et les versets de la
Genèse ou des Évangiles, la lecture de l’Odyssée,
celle d’Apollinaire et de tant d’autres qui le constituent vont essaimer dans
sa poésie, centre de sa vie amicale, mystique, engagée. Il y aura les rouges
innombrables d’élans révolutionnaires (Le
ciel était un livre rouge, p. 20 ; L’éternité rouge les attendait, p.19 ; Les pierres de la route étaient rouges/ Aux veinures flamboyantes, p.
43, etc.) le bleu azur de la Vierge ou du ciel, l’or, le feu, le sang et la
lumière. Ce qui est dit, crié, hurlé c’est la force du verbe,
l’éblouissement de la Poésie, la recherche de cette errance-là, qui est ligne
de vie, fortune (dans le sens de richesse comme de destin) et
ensorcellement : Mon programme Je dévalais la
colline dorée Je suivais le
cortège des cigales Mon programme Charmer l’azur J’étais en
terre d’eau Je me
désaltérais de poésie Orphée
m’accompagnait Avec sa
trompette rouge (p. 52) Beau programme
en vérité d’un « je » énergique, nietzschéen tempéré par cet
imparfait lancinant, Nostalgie de la
vie qui sera. |
Créé le 1 mars 2002
A visionner avec Internet Explorer
Notes de lecture
Dominique
Zinenberg
Francopolis, mai-juin
2018