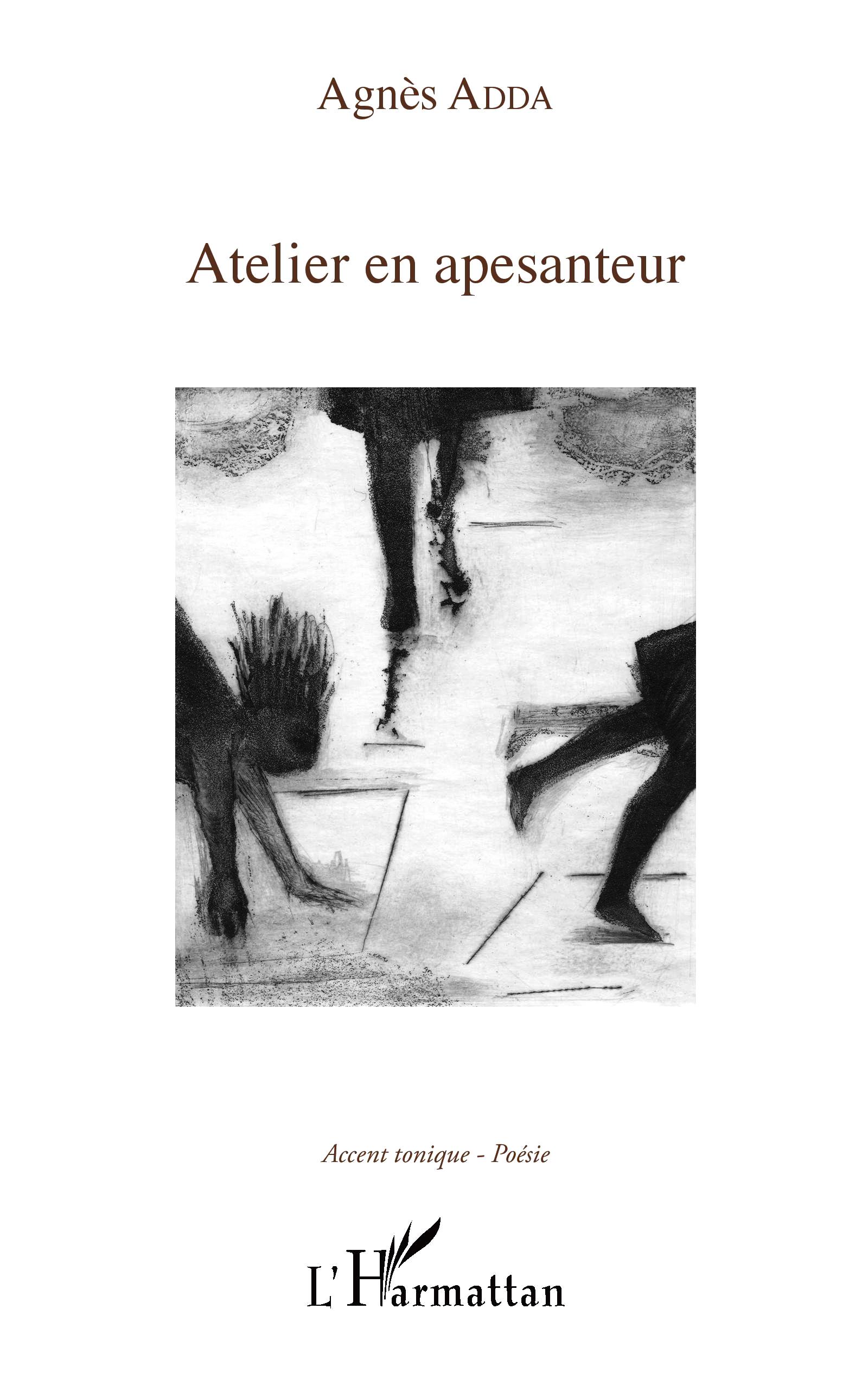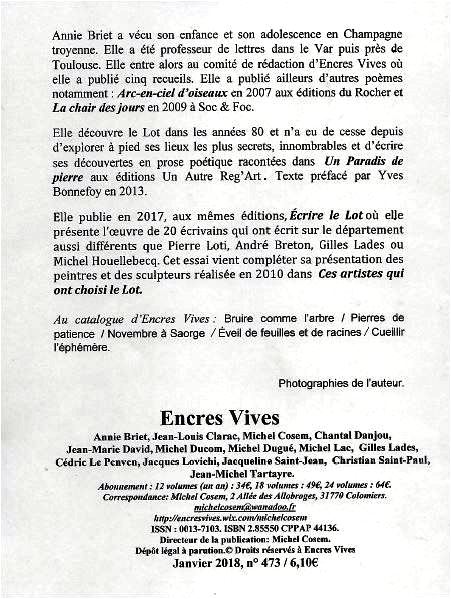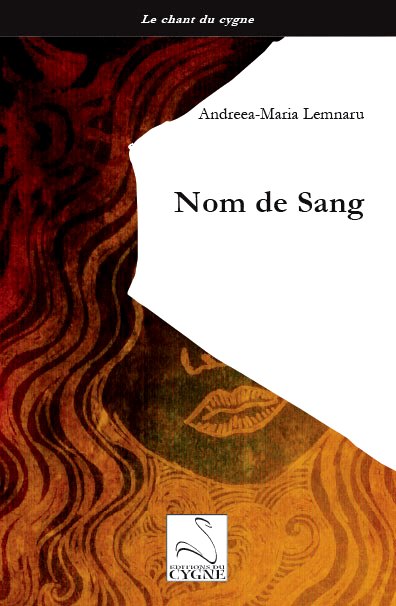|
LECTURE - CHRONIQUE
Revues papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |
|
LECTURES –CHRONIQUES
Notes de lectures de
Dominique Zinenberg
1. L’Atelier
en apesanteur d’Agnès Adda, L’Harmattan 2017. À
la difficulté à saisir à quoi l’apesanteur nous soumet, correspond, en
poésie, le vertige de l’insaisissable qui est expérience vitale dans
l’atelier de la langue. Il faut au lecteur comme à l’astronaute une
discipline bien rigoureuse pour se préparer à l’espace … poétique dans lequel
Agnès Adda nous fait pénétrer. Échappées
temporelles, spatiales, mentales et envols baroques, précieux, érudits que
ces poèmes aériens qui s’offrent comme un coffret de bijoux ciselés que l’on
découvre dans l’émerveillement et une certaine perplexité comme si à peine
vus/lus on n’était plus très sûr de leur existence de telle sorte que l’on se
demande si on ne les a pas plutôt rêvés. Atelier pour peintres, comédiens,
écrivains, tous artisans du beau, polissant, symbolisant, innovant avec
patience et détermination. Quinze ouvertures qui sont autant de récits
de voyage synthétisés par ces poèmes précis et déroutants, de mini
expériences du quotidien, de rencontres d’une rare acuité avec des œuvres
d’art (tableaux, danse, architecture), de deuils intimes, d’émotions devant
des paysages. Chaque partie comprend trois poèmes sur le
même thème et chaque poème est titré, parfois certains poèmes contiennent des
sous-titres suggérant un climat, une humeur, presque une didascalie comme au
théâtre. D’ailleurs, le théâtre avec un sourd dialogue implicite, des
indications scéniques, des masques, un décor, n’est jamais totalement absent,
mais on pourrait remplacer le mot théâtre par celui plus global de spectacle.
On aurait ainsi tout aussi bien la vision grandiose des momies et le panorama
en arrière-plan des pyramides et de l’Égypte
ancienne recréée ; des danses classiques ou modernes, le flamenco, le passo doble ; l’opéra ; le musée ou les églises
italiennes (en particulier) dans lesquelles on regarde les Vierges
peintes ; les rues de villes étrangères, Berlin par exemple, qui se fait
ville masquée (Une foule de masques/
Plus vive que ses couleurs pures/ Déclamait en avançant/ Quelque féroce
comédie. P. 15) ; ou comme dans le poème page 31 intitulé
« Machinerie urbaine » la suggestion dès le titre des manipulations
et jeux théâtraux que donne à voir la ville et de personnages imprécis que
l’on entend parler, s’interroger à la manière de Cyrano dans la tirade du
nez : -
Vois-tu
nos arpents d’asphalte Le rail de nos wagons qui glissent Sur le théâtre enfoui des
nécropoles ? Et notre avenir de fer La course effrénée De nos cœurs scellés Qui abîme les carrières de notre
mémoire ? -
Perplexe. Peut-être. -
Les
affluents du passé Exténués sous nos ziggourats ? -
Rêveur. Leur sillage, sans doute. […] Agnès Adda dit rarement
« je » ; elle dit « nous » comme si chacune des
expériences qu’elle épingle par un poème délicat, n’était possible qu’à
travers l’approbation d’un autre, témoin et complice ou peut-être d’un renvoi
à un humain universel, un « Nous » les êtres humains. Qui
cherches-tu, furet, de notre charpente ? …
Sous mon front ? Au ciel de notre toit ? (Les visiteurs, p.
47) […] Nos ponts visitaient, dit-on nos
horizons ? Quand notre firmament s’étoile de
rutilances d’acier Et que d’invisibles présences
prolongent de leurs reflets notre
panorama Le nomadisme des perspectives
illimite les hors-champs. (Les
voyageurs, page 93) Nous entrâmes sous le signe de la
Vierge Et du virginal. … Dans la nuit du chœur Nous fixions encore la trace de
l’Assomption. (Début
et fin de « Assunzione », page 85) Bien
d’autres exemples pourraient être donnés, bien sûr, mais ce
« nous » très fréquent s’allie au « tu » qui renvoie aux
bêtes (furet), à une personne le plus souvent (soit un « je » extériorisé,
soit un autre, non clairement désigné, ami, lecteur, tout autre.) Mais dans
le poème « Papagenas », page 61, un
« vous » se glisse accentuant doublement le mystère car ce
« vous » soudain et insistant renvoie-t-il à un vouvoiement ou à un
pluriel ? Tu t’avançais vers le
sommeil Escortée d’une
silhouette de brume Palpable et
bienveillante. De très loin vous
parvenait l’écho De contes à veiller Antiennes de verdicts
et de commotions ; Vous en souriiez. Quand vous arriveriez
les treizièmes Ne vous convierait-on
pas D’un geste
d’hirondelle ? L’empire du demi-rêve Vous ménageait toutes sortes d’escales De courte et lointaine
mémoire. Telles étoiles filent
et croisent D’une insouciance de
plume Le tour scrupuleux des
astres. Vous réjouissait Le halo de cette
avancée Comme le chant
prochain d’une crypte invisible Le battement d’un cœur
entre les paumes. Allaient bon train vos
susurrements et silences Jeu de marelle sans
cesse recommencé -Équilibres, suspens,
cloche-mots. La pudeur des cases
blanches stimulait votre feu. Échappées de la cage
des veilles Pépiaient jeunes et
vieilles heures. Dans ton équipage de
brume Tu devinais sans
crainte L’entrée du mirage. Avec
cette partition poétique, nous sommes au plein cœur de l’opéra de Mozart La Flûte enchantée et son décor
nocturne planté dès les premiers vers et essaimé jusqu’aux dernières
strophes. La musique elle-même est centrale, par le champ lexical qui
traverse le poème « écho », « antiennes », « chant
lointain » « battement » « susurrements et
silences », « cloche-mots », « pépiaient » ;
mais aussi par le souci essentiellement musical des vers qui allient les
allitérations en « v » et « p » tout au long du poème
comme une tresse de notes feutrées d’un côté, sonores de l’autre, rappelant
ainsi la fantaisie de la présence dans l’opéra des « Papagenas »
et le mystère initiatique qui prédomine dans l’œuvre de Mozart. Les oiseaux
survolent l’espace de façon légère, gracieuse mais leur passage renvoie un
son cristallin : geste d’hirondelle,
insouciance de plume, échappées de la cage des veilles, pépiaient, d’un vol
vif, l’aile propice. Entendez la truculence joyeuse des allitérations en
« p » : palpable,
parvenait, empirait, crypte, paumes, pudeur, échappées, pépiaient, équipage,
propice. Mais écoutez aussi le frisson vaporeux des allitérations en
« v » que l’utilisation du « vous » a soit convoqué, soit
impulsé : avançais, vers, vous
parvenait, à veiller, verdicts, vous, vous arriveriez, ne vous convierait,
vous, avancée, invisible, votre feu, vieilles, devinais, vol vif convia. Bien
d’autres combinaisons vocales pourraient être mentionnées, le travail des
assonances en « on » ou en « a » par exemple, mais cela
mènerait trop loin. Néanmoins ce qui frappe dans ce poème, comme dans bien
d’autres de ce recueil, c’est que comme en musique, ce n’est pas une
signification déterminée qui est donnée, mais des impressions, des fragments
de sens, une atmosphère. Une
aura, un halo, des faux-semblants, des langues incompréhensibles et des
miroitements sans fin sertissent les vers de Atelier en apesanteur. On ne cerne que des reflets, des mouvements
imperceptibles, ou des visions extraordinaires mais prises dans une gangue
obscure ou dans un faisceau lumineux éblouissant. Et l’on sent une culture
immense qui se diffracte dans tout ce qui est observé, circonscrit, une toile
de fond faisant remuer les strates de la mémoire, de passés mythologiques ou
fabuleux, de rappels historiques tragiques et de perspectives d’avenir
spéculatives. Aussi
la préciosité et la délicatesse de la poésie d’Agnès Adda n’atténuent-elles
jamais la cruauté des faits, la violence du monde, le sentiment de perte et
de malheur. Mais la tenue du vers, l’élégance de l’expression, le travail
minutieux d’orfèvre qu’elle fait vers après vers, poème après poème, crée une
profondeur de champ qui laisse à l’imaginaire de chacun une liberté
d’interprétation généreuse et renouvelable.
Le passage On
s’en absente. La
scène est au-delà. Ni
vu ni connu. Une utilité Cette
allée de préludes ? * Sans
cœur, l’ouvroir des grandes entrées Jonché
de bribes et brouillons. L’oubli
filtre par la verrière Sur
le couloir des attentes, des préparations. * Et
puis s’envole la paille sèche Et
si légère des répétitions. L’issue
lumineuse, de l’autre côté À la nuit livre notre passage. (page 79) |
|
2. Mieux habiter la
terre d’Annie Briet, éditions Encres vives (n° 473), janvier 2018. Voici un poème de
12 pages, d’un seul tenant, bien qu’il y ait des espaces entre les strophes
et des photos de paysages en noir et blanc, faisant corps avec le texte et
n’en distrayant pas, comme si le grain des mots, de la voix et des prises de
vue ne faisait qu’un. Mieux habiter la terre est une invite ou
une prière plutôt qu’une injonction. La recette semble simple et Annie Briet n’en fait pas mystère mais l’énonce d’emblée :
« Écrire/Pour mieux
habiter la terre/Pour accorder notre souffle à son souffle… », mais
cette simplicité à son revers, c’est d’apprendre à écouter sa langue, la
comprendre et la restituer, intacte, profonde : « Terre, ta langue
est encore toute intérieure/ Tu remontes peu à peu les âges les
saisons… » et c’est aussi apprendre à voir, à sentir, à fouler son sol,
à traverser ses saisons. Ce long poème est
un hymne à la nature. Il est lyrique et inspiré. Il commence avec les neiges
de l’hiver, se poursuit avec l’éveil du printemps, l’ardeur de l’été et
s’achève avec l’automne « pourrissant » et les premières
gelées : un cycle complet, une révolution, un éternel retour. Et un seul
paysage : celui des Causses qui est décrit comme une caresse du regard
et du cœur. Voici en guise de
conclusion et dans l’attente de l’été, une stance évoquant les
coquelicots : Dans les prés et les
champs, sur
les talus et les chemins, monte
le chant frêle des coquelicots, petits
papillons rouges du sang de la terre Connaissent-ils comme
leurs frères errants sur
les chemins de l’air ce
grand besoin de ciel ? Est-ce que vivre,
c’est bouger ? Et mourir est-il autre
chose que
devenir statue de marbre cendre
ou poussière ? |
|
3. Arcanes (2014) et Nom
de sang (2018) d’Andreea-Maria Lemnaru, aux éditions du Cygne. Je n’écris aujourd’hui que pour ceux qui
aiment le mystère, l’ésotérisme, les mythes anciens, l’évocation des démons,
des stryges, de sorcières et autres sirènes. Je n’écris que pour ceux qui
aiment être perdus dans la fascination des oracles, des mondes souterrains et
chaotiques, de mots et noms abscons. Ils seront charmés par cette langue
difficile, par les hardiesses archaïques qu’Andreea-Maria Lemnaru fait
surgir. Quant à moi, je me sens incapable de me
frayer un chemin dans cette jungle de mondes parallèles, je me sens dans un
malaise constant, dans un abîme de mots insaisissables et dont le sens à tout
instant m’échappe. Même insensible à ces puissantes énigmes, à
cette immersion dans le monde de goules, des reines de la nuit, de recherche
de pierre philosophale, je sens quand même la beauté des vers et le travail
sur la langue et c’est la raison pour laquelle je vous signale ces deux
recueils érudits aux seuils desquels, hélas, je reste interdite. Mais la voix
de cette poète est originale et imprégnée de ces études religieuses très
spécialisées. Elle cherche sans doute à reprendre, à sa manière, le sillage
de Gérard de Nerval et à
faire renaître ou perpétuer les syncrétismes religieux, les
divinités grecques et latines comme les traditions monothéistes. C’est sans
aucun doute une voix singulière, en tout cas. Voici pour que vous vous fassiez une idée,
un poème d’Arcanes, puis un autre
de Nom de sang. Onirologos Sous une pluie de comètes Aux frontières du monde jauni Tu invoques le pays où les rêves
s’enflamment Et où l’astre du jour cède sous
l’arche des nuits Dans l’antre des vieilles choses La peur veille sur l’enfant endormi Mais comment embrasser en même temps et la terre et le ciel ? Pour dissiper ce mystère L’Homme et son Ombre Parvenant à un accord Décident de s’épouser enfin Sous le citronnier fleuri Apocatastase Poussière céleste sur le chemin de Gadara Le maître chemine Piétine le désert Le maître psalmodie pour les fils de la nuit noire Ses ombres recueillent Chaque regard Offerts aux tournesols Aux os calcinés du sable. Des sources de Gadara Surgissent deux miracles Deux génies des eaux L’un et l’autre amoureux De leurs essences Puisées dans le puits Du temple d’Apamée Dans la mémoire des oracles Et l’œil pourpre du volcan Des vapeurs du vin Aux vertus du souffle Le premier choisit la droite Et le second la gauche Éros
le fruit Anteros la racine |
Créé le 1 mars 2002
A visionner avec Internet Explorer
Notes de lecture
Dominique
Zinenberg
Francopolis,
mars-avril 2018