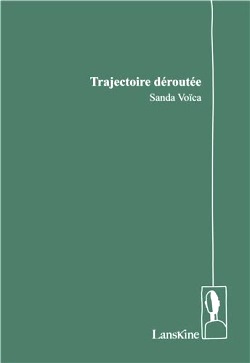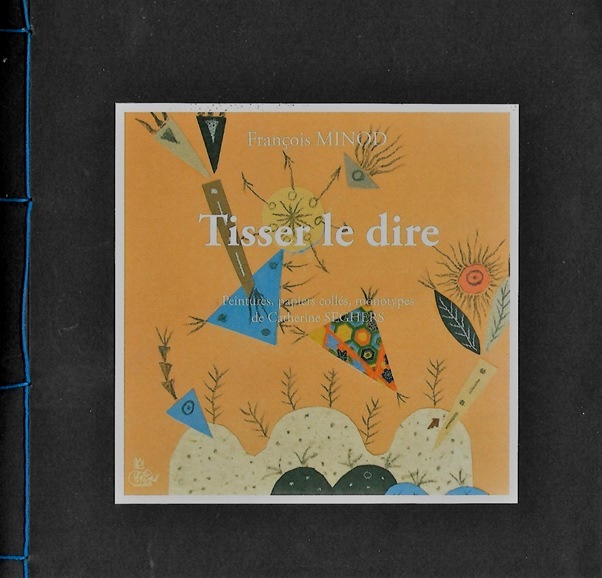|
LECTURE - CHRONIQUE
Revues papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |
|
LECTURES –CHRONIQUES
Notes de lectures de
Dominique Zinenberg
1. Sanda
Voïca, Trajectoire
déroutée, Éditions Lanskine, 2018 (14 €) Le titre, la dédicace,
le lexique, les pensées, tout dans le recueil rappelle le chamboulement du
deuil. Oui la trajectoire de vie ne
peut qu’être déroutée quand la
disparition de son propre enfant frappe une mère. Tout est sans dessous
dessus et la mort pénètre le vivant comme le ver dans le fruit. Et il faudra
longtemps à la poète pour pouvoir dire « ma fille » est morte,
presque tout un recueil en fait car pour la tenir à distance, la rendre
irréelle ou abstraite, voire pour la nier, les mots se neutralisent et Sanda Voïca dit je mets
la fille disparue/dans mon échine (p.17) ou Les souvenirs de la fille disparue (p.23) La fille disparue jeta une cordelette/blanche éclatante/flottant à
portée de main/ inatteignable (p.39) Ma
mort est celle de la jeune fille. (p.45)
Que faire de la fille partie ?
Je la mets-ci,
Je la mets-là,
Jamais à la bonne place.
Je rogne les cases, les jours et les nuits, je grave son nom mais il ne reste pas.
Je la repose sans fin dans des lieux très différents sans qu’elle y reste. Sans place
Sans endroit.
Elle flotte
Je flotte Nous
traversons les airs les terres les chemins battus et inconnus.
Nous ne serons jamais à notre place. (P. 46) Sans l’adjectif possessif
« ma » la cruauté de la disparition ne se dissipe pas, mais
s’atténue, illusoirement, comme si le lien charnel d’appartenance n’était pas
aussi fort et que la douleur pouvait ainsi être extériorisée, tenue à
distance, rejetée. Cependant, excepté ce mot tabou,
tout est marqué par l’absente et l’absence. La chair maternelle a logé son
enfant mort en elle : « Mon squelette récent », c’est celui
qui est sien désormais, qui inclut la fille en allée, sa « tombe
blanche/ ovale dans mon corps ». Le corps de la mère est envahi par
celui de la fille, elle la sent dans son « échine », dans ses os
(« les os ne crèveront jamais. / A quoi bon la chair, / à part pour faisander,
vivante. ») Parallèlement à la décomposition du corps de sa fille, la
mère se sent elle-même en décomposition, vivant la mort de l’enfant comme la
sienne propre et emprise à des images obsessionnelles du travail de la mort. Plus aucune place où respirer, se
tenir car l’espace est à la fois trop étroit (comme celui d’une tombe) et
trop vaste, et où qu’elle soit, le manque est prégnant et ne permet d’être
bien nulle part. Chaque poème décrit ce manque en
s’accrochant aux mots comme à une véritable bouée de sauvetage. C’est une
peine autre qui se fait jour à travers le poème : L’écriture
sainte de la joie. Troquer une
souffrance pour
une autre. Ma tête
pousse et les talons traînent. La main
s’accroche à l’air scintillant
ou au brouillard. Je monte. La joie est
dite. (P.25) Quelque chose est atteint à travers le
verbe qui n’est pas une parenthèse à la douleur, mais une joie à être au plus
près de l’absente par l’expression. Concentrée à escalader la paroi escarpée
qui est celle du deuil, la poète connaît le répit momentané par l’absorption
mentale qui libère de toute distraction. (Je
fais le tour de moi-même, / je me vois de dos. / La trajectoire devient/ligne
côtière d’une baie étroite. / La ligne monte/ jusqu’aux parois abruptes. / Je
suis l’eau claire et froide/ d’une baie bleu royal.) (P.65) La bascule des jours à la mort de la
fille fait surgir serpents, insectes, corps intrusifs dans la chair. Tout
corps est détruit, celui de l’enfant, celui de la mère : Je cherche l’insecte/ dans les mottes de
terre/ que je retourne dans mon jardin. / La fille n’est plus ici/ n’est pas
assez dans mes lignes. / Elle s’est réfugiée dans cet insecte qui traverse
les mottes/ pendant que je jardine. (…) (P.63) Rites mécaniques, gestes répétitifs
et hagards, tentative de vivre quand bien même et impasse et murets qui
surgissent, raréfiant l’air et rendant vaine la démarche car la peine saute
au visage, est ravage à chaque fois ravivé : Je sors dans mon
jardin et dès la porte d’entrée l’air, le soleil, les fleurs m’attaquent : mur qui me pousse et m’empêche de le traverser, de faire des pas, de sortir. Pétrifiée et tremblante devant cette tombe ad hoc, celle de la fille, venue jusqu’ici. Si je voulais me
jeter par terre je
ne tomberais pas : l’air du jardin devenu solide m’en empêcherait. (P.51) Nulle place où se sentir bien, nul
espace où respirer, tout est devenu pierre tombale, intérieurement (pétrifiée) et extérieurement (l’air… devenu solide). Un double emmurement :
horizontal pour la fille, vertical pour la mère. Aucune échappatoire dans
l’enceinte monstrueuse de la mort. C’est l’image d’un piège qui se répète
inlassablement qui est donnée comme dans le poème page 67 : Dans la nasse du
jour je jette une nouvelle nasse et j’y retrouve les nasses des autres jours. Dans chacune il y a encore des nasses – celles des jours anciens. A la pêche, je n’attrape que des nasses. C’est la tragédie de la survie après
la disparition de la fille, dite et cependant toujours à dire, sans espoir
que les mots suffisent, qu’ils s’impriment en italique ou en gras (P.58),
qu’ils traduisent la dévoration, l’invasion, le temps arrêté, le cauchemar,
la suffocation ou l’immolation, qu’ils la fassent revenir, soudain, dans le
« bleu royal » ou qu’au contraire, ils traduisent le vide, le
poids, la terreur, ils ne peuvent que toucher tant ils sont vrais et forts,
tant ils résonnent en profondeur dans les entrailles, sensibles comme des
couperets. (…) Ma chair brûle sans se consommer. Sur un plancher
froid mon immolation est à la fois ajournée et permanente. (…) (P.56) Aucune grandiloquence, pas vraiment
de lyrisme, mais des termes concrets, des images concrètes du corps,
d’objets. Peu de recours aux mythes, sauf fugacement ou à la prière, sans
effet. Quelques rares notations d’un autrefois vivant, ressuscité de façon
fragmentée, de même que des bribes de paysages qui ne sont pas
divertissement, mais aide à la restitution des quatre éléments : la
terre, l’air, l’eau, le feu qui traversent les poèmes comme des
manifestations incessantes, pénétrantes de la disparue. Dans un des derniers poèmes du
recueil, Sanda Voïca évoque le récit du talon
d’Achille. Cette reprise du mythe avait été préparée par le mot
« talon » apparu antérieurement et par toutes les expressions de
déséquilibre, d’impression de vertige que certains poèmes contenaient. Avec
ce poème de la page 75, la poète condense de façon magistrale ce qu’est la
vulnérabilité, le point sensible, létal pour elle : « Ma fille –
elle mon talon. » Il ne faudrait pas que la tristesse
générale qui se dégage du recueil – et pour cause ! – rebute ou en
empêche la lecture, car il se passe dans ce texte de deuil, ce qui se passe
avec toute œuvre véritable : par-delà le poids de la perte, les poèmes
longs ou courts sont traversés par un état de grâce qui contient en quelque
sorte le mal et le remède, la plaie et son baume. |
|
2. François
Minod, Tisser
le dire, avec des peintures,
papiers collés, monotypes de Catherine Seghers, Éditions du Petit
Véhicule, 2018, 129 pages (25€) (Galerie de l’or du temps N° 120, 25 €) La collection dans laquelle les textes de François
Minod et les peintures de Catherine Seghers sont réunis s’appelle « La
galerie de l’or du temps ». Et de fait ce bel ouvrage habillé de noir
recèle le trésor d’un florilège de la plupart des œuvres de notre cher membre
du comité auquel s’ajoutent quelques inédits (les poèmes de la première
partie et quelques textes épars dans les différents chapitres correspondant
aux œuvres déjà publiées chez Hesse). Le lyrisme du poète est plein de retenue. L’amour pour
les mots lui interdit de les utiliser de façon débordante. Tout est une
question de dosage, de précision comme s’il tendait au rien. Dire le peu,
entretenir l’art de la litote, suggérer, suspendre, ciseler, raboter, surprendre
et toucher par ce cheminement difficile, voire escarpé, le cœur sensible,
inaltérable de la poésie, quitte à en passer par l’absurde ou ce qu’on
appelle abusivement ainsi, dans la claire conscience qu’il appartient à la
famille littéraire de Samuel Beckett, quoi qu’il s’en détache par des traits
singuliers, des interrogations parfois autres, une allégeance plus large à la
quotidienneté qui ouvre les portes aux expressions de tous les jours, aux
intermittences sentimentales ou sensorielles, aux affects en général.
On ne va pas faire de détour
Pas l’envie
Pas le temps
Juste dire
L’essentiel
En quelques mots
Un seul peut-être Le
trouver
… Et puis fermer (P.17) De façon discrète, décalée, les papiers collés,
monotypes et autres peintures de Catherine Seghers, tous rassemblés presque
en fin d’ouvrage, éclairent d’un jour tendre, coloré, naïf aussi les textes
de François. On saisit au vol, tant les collages sont aériens, les pensées
graves et enfantines (n’est-ce pas la même chose ?) qui traversent
l’esprit du peintre et celui du poète. Des demi-teintes, de la fantaisie, de
l’humour. C’est une aire de douceur et d’interrogation planante qui tantôt
s’ancre dans l’onirique, tantôt dans le japonisme, tantôt rappelle le monde
ambré, fossilisé des minéraux. Il faut prendre le temps de lire ces textes, souvent
courts, qui peuvent être interprétés de façon diverse, qui font tour à tour
rire ou réfléchir, qui interpellent le lecteur, l’auditeur, comme si le poète
instaurait secrètement un dialogue avec chacun de nous, ou plutôt en chacun
de nous. On ne peut qu’être saisi, en effet, par l’art de convoquer l’autre
doucement, en susurrant du fait du rythme répétitif, de la scansion presque
hypnotique des mots qu’il agence, notre moi endormi pour un éveil plus grand,
plus lumineux, pour représenter la brèche, l’écart qui se creusent dans la
langue même dès qu’on l’interroge, la triture, la met à distance. Même quand les textes ne sont pas des dialogues, la
façon de jeter les mots de n’importe quel de ses poèmes est une adresse à
l’autre. Soit parce que les mots du « dire » se trouvent dans le
poème, soit parce qu’il y a un « je » et un « tu » ou
bien un « on », soit parce qu’il y a une interruption, un suspens,
un point brusque qui fait surgir l’altérité. Le dialogue toutefois reste le fonctionnement le plus
fréquent. Rien d’étonnant à cela quand on sait combien François Minod est
attaché au théâtre, à la mise en voix des textes, à la théâtralisation
minimaliste de ses dialogues. Tisser le
dire c’est peut-être avant tout partager le dire avec d’autres comédiens,
complices, et avec un public qui réagit. François Minod nous plonge dans le dialogue, à même la
trivialité des conversations du quotidien, dans un bain de langue connu, qui
nous parle, dont on n’a pas manqué de surprendre quelques bribes, ici ou là,
dans notre vie ordinaire. Les mots sont usés, éculés, les propos anodins ou
bêtes (de cette bêtise que détectait Flaubert avec délectation et
fureur !) mais il y a du jeu (comme on le dit pour un mécanisme) et
c’est grâce à cette mise à distance, par le travail de la langue,
allitérations, assonances, rythme des stichomythies, ponctuation,
distanciation quasi brechtienne, et tourbillon des redites qui grignotent le
sens, dissèquent l’expression jusqu’à la rendre inaudible ou inouïe que le
texte opère cette mue salutaire, attirant le rire, le sourire, le
dérangement. On pense immanquablement à l’utilisation du dialogue
chez Diderot qui s’en servait lui aussi avec drôlerie, naturel et mordant.
François Minod, tissant le dire, le
fait dans le partage généreux, mais sobre et pour aider efficacement à nous
tenir en éveil ou à nous réveiller !
Partez ! -
Partez !
Partez de mon champ ! -
Mais
… -
Y a pas
de mais, partez ! -
J’ai
toujours été là. -
Non,
avant vous n’étiez pas ici. -
Comment
le savez-vous ? -
Ça se voit,
non ? -
Comment ?
-
Regardez-vous
et vous verrez. -
Mais
j’ai toujours été là, je vous dis. -
Oui
mais vous n’êtes pas d’ici. -
Vous
voulez dire que … -
Exactement,
vous avez compris. -
Mais
ce n’est tout de même pas à cause de … -
Si,
c’est à cause de ça. -
Mais
j’ai toujours été là, je vous dis. -
Ça ne veut rien dire, vous avez
toujours été là sans être d’ici, c’est tout. -
Et
où voulez-vous que j’aille ? -
Eh
bien chez vous, pardi. -
Mais
c’est là, j’vous dis. -
Mais
regardez-vous, nom de Dieu, et vous verrez que vous n’êtes pas d’ici. -
Je
n’ai pas de miroir. -
Prenez
le mien, regardez-vous et disparaissez ! Que je ne vous voie plus !
Jamais ! Eh ! Attendez ! Mon miroir ! Rendez-moi mon
miroir ! (p. 95) Je ne me lasse
donc pas de dire et répéter, merci et bravo l’artiste ! |
Créé le 1 mars 2002A visionner avec Internet Explorer
Notes de lecture
de
Dominique
Zinenberg
Francopolis,
novembre-décembre 2018