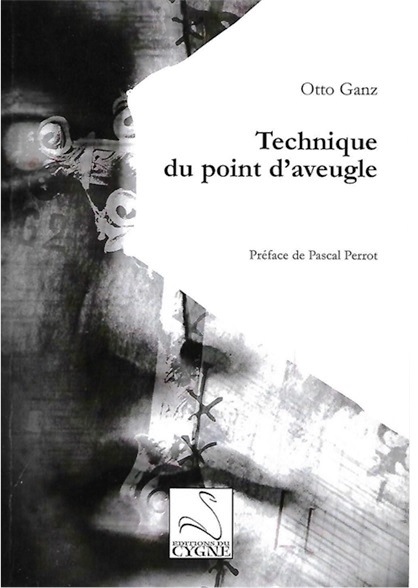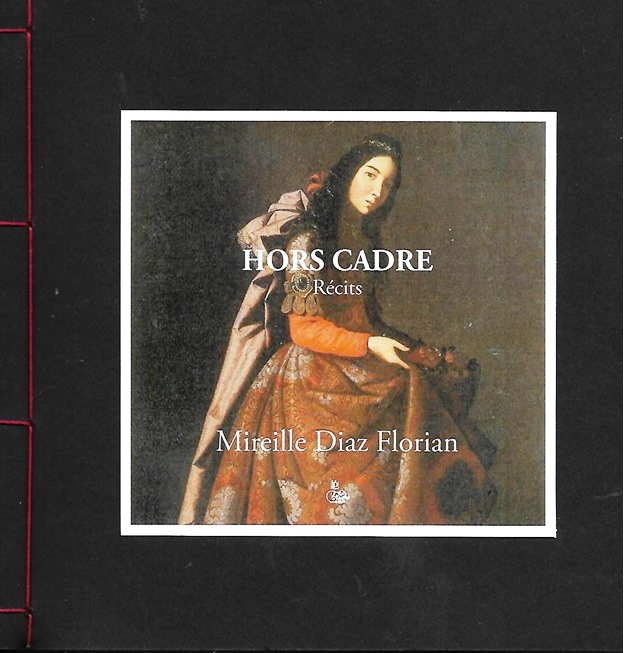|
LECTURE - CHRONIQUE
Revues papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |
|
LECTURES –CHRONIQUES
Notes de lectures de
Dominique Zinenberg
1. France
Burghelle Rey, L’aventure,
édition Unicité, 2018
(13€) Le
mot « Roman », sous le titre rouge, L’Aventure, tient du pléonasme, mais en contradiction avec les
deux, l’épaisseur du livre ferait d’abord penser que l’on va lire un récit.
Un roman d’aventures suggère quelque chose de volumineux, parce que l’on
s’attend à du romanesque, à des rebondissements, à des péripéties, et donc à
des développements longs et non un texte de 77 pages ! Qu’est-ce donc
que cette singulière « aventure » (au singulier) qui tiendrait du
roman, mais à quel titre ? Ce mot aventure
se retrouve à plusieurs reprises sous la plume de Claire, la deuxième
narratrice du texte. Il pourrait, si l’on devait être réducteur, signifier
« liaison » tout simplement, mais le terme choisi par France Burghelle Rey implique une dimension plus existentielle,
voire mystique ou mentale. À l’ouverture du roman, une
première voix nous accueille, transcrite en italique, celle de la narratrice
sans identité précise, mais que l’on pressent un peu plus loin dans le texte
être la cousine du personnage appelé « Claire ». En deux
paragraphes, quatre des cinq protagonistes du récit apparaissent : la
narratrice-cousine, Claire (absente), Rose (morte) et Stan (ressurgi du passé
de la narratrice-cousine). Très vite la narratrice de départ cède la place à
une deuxième narratrice qui est Claire, par le biais d’un journal intime
qu’elle découvre dans le grenier de cette dernière, dans un fameux
« grand cahier rouge ». À partir de ce moment nous
découvrons en même temps que sa cousine les secrets de l’été 90 vécus par
Claire, en l’absence de sa cousine, mais qui se trouve en compagnie d’une
certaine Paule, une amie qui « aimait vivre par procuration ».
Néanmoins, le récit de Claire sera régulièrement interrompu par les
réflexions de la narratrice du texte en italique qui corrigera, infirmera,
niera ou confirmera les dires de Claire : Il s’agirait donc d’un récit autobiographique mais ce garage, elle
l’inventait. » Les
interventions de la première narratrice commentant les propos de Claire et
même sa graphie complexe révélant l’instabilité
de sa personnalité vont continuellement déstabiliser le lecteur qui est
obligé de prendre en compte les points de vue qui diffèrent comme si
l’essence même de L’Aventure consistait
à être égarés en tant que lecteurs. Quelque chose de trouble, de double
s’engage très vite. Lignes de vie qui se recouvrent, qui s’enchevêtrent,
destins croisés, miroitements, rappels, échos malgré les séparations
temporelles longues à chaque fois de quinze à vingt ans. Le récit de Claire relate au jour le jour
l’été 90 qui rejoue/ répète/ ranime l’été de ses seize ans. Quant à la
narratrice première, elle revit, juste après la mort de Rose, leur grand-mère
commune, ce qu’elle a connu elle aussi dans les années magiques et
tourmentées de ses seize ans en revoyant Stan après tant d’années. Au cœur du trouble, de l’émoi des
narratrices et héroïnes de l’histoire, cet homme Stan, autour de qui tout se
fait, se défait, se noue, s’enraie, se condense et s’abîme. Stan, cet autre Don Juan, qui fait chavirer
les cœurs de chacune des femmes nommées dans le texte : celui de la
cousine, celui de Claire (jusqu’à la folie), celui de Paule et en marge celui
d’Élisa.
Sans dévoiler le récit lui-même, on peut
dire que toutes les routes du récit passent par Stan ou mènent à Stan. Et
quelle que soit la période évoquée, c’est la période antérieure celle où les
femmes n’étaient que des jeunes filles qui fait ricochet sur celle narrée.
Nostalgie dans le sens étymologique du terme et poésie des mystères des
retrouvailles délicieuses et fatales que vivent les personnages. Il y a
concordance, reprises des mêmes envoûtements et un désir violent, quoique
discret, qui parcourt les lignes. On sent dans cet écrit un je-ne-sais-quoi
du Grand Meaulnes d’Alain Fournier par le mystère et la poésie et un
je-ne-sais-quoi du Ravissement de LOL
V. STEIN de Marguerite Duras, dans le traitement d’une certaine folie
liée à l’embrasement d’amour. La poésie n’est pas seulement présente par
les situations, l’atmosphère ou l’aura des personnages. Elle investit aussi
la vie de Claire qui en découvre, dit-elle, au cours des pages, dès sa
première expérience amoureuse avec Stan, la puissance et la nécessité. Par
elle, la poésie se fait chanson mais la connaissance des poètes (Mallarmé,
René Char, Cocteau) laisse aux deux narratrices des tatouages mentaux et des
itinéraires de vie par lesquelles « la muse » passe et fait son
lit. Une autre voix, en dehors de celle de
Claire et de sa cousine retentit dans le récit. Voix directe par le biais de
rencontres entre la narratrice-cousine et Stan où ils échangent des propos de
la vie ordinaire (même si l’extraordinaire pour la narratrice est prégnant)
et voix indirecte par des bribes de lettres d’amour que Stan avait écrites à
Claire, quand elle avait seize ans et qu’elle retrouve et lit une vingtaine
d’années plus tard. Pour un premier roman, l’apparente simplicité
du propos, cache un sens aigu de l’ambiguïté et de la complexité romanesques.
Et le lecteur embarqué in media res sent le deuil des jours où la discrète et
bienveillante Rose, fleur entourée de roses trémières vivait et recevait les
confidences de ses petites filles en émoi. |
|
2. Otto Ganz, Technique
du point d’aveugle, Editions du Cygne,
2018 (11€) L’angle mort ne
serait-il pas l’équivalent du « point d’aveugle » figurant dans le
titre ? Quoi qu’il en soit, une « technique » s’impose pour
venir à bout ou tenter de limiter la portée du point d’aveuglement qui menace
notre entendement. Tout se déterminera, ici, dans ce recueil, dans
l’intervalle entre cécité et vision, l’œil du poète étant une sorte de caméra
enregistrant ce que le panorama du monde lui offre. Le poème, d’un seul
tenant, sans l’entrave de la ponctuation, relancé tous les trois quatrains
par l’anaphore « Je vois » ne s’achève qu’au moment où le dernier
« Je vois » n’est pas suivi par trois strophes, mais par un
enflement du propos de sept quatrains consécutifs auxquels s’ajoutent deux
vers, comme deux vagues mourant sur le sable, eux-mêmes séparés l’un de
l’autre par un intervalle. Celui qui témoigne
dit « Je ». Il parle en son nom, ne révèle au monde que ce qu’il
voit. Il ne se veut pas visionnaire, ni même voyant, il suggère plutôt que ça
crève les yeux, ça déborde en d’autres sens concernés, en sons, bruits,
odeurs. C’est autour de nous, criant, au milieu de nos vies. La poésie est un
acte politique. Cri d’alarme, de détresse, de désarroi. Urgence. Le voir fait
entendre le désastre du monde. Le témoin est
soutenu par un « tu » qui reste anonyme, et permet au poète
d’entretenir un dialogue permanent, d’une intime délicatesse avec un autre,
peu importe qui, soit frère humain (reflet de soi, sosie, doublure ?)
soit compagne grâce auxquels dire dans un rapport dialectique, nuancé,
contradictoire reste nécessaire, voire indispensable. Ainsi recevons-nous ces
incises « écris-tu », « dis-tu », « diras-tu »
revenant telle une antienne dans l’ensemble du poème comme un contrepoint.
L’altérité commence par la polyphonie, se poursuit en sourdine par les
références culturelles, se parachève par le lien d’amour dans le couple,
socle de la reconstruction, de la signification, de la possibilité de la
joie. Une autre personne
de l’intimité apparaît de temps à autre dans le poème, c’est le fils. Il est
l’enfance du monde, l’innocence « interrogeante »
du monde. (Je vois (…) mon fils me
demander/ papa tu es dieu oui hein/ dans mon souvenir tu restes/ celui qui
n’a aucune raison de croire, P. 33). Il y a donc le
cocon familial, homme, femme, enfant, et la complexité des sentiments, des
relations et il y a le monde tel qu’il va ou plutôt tel qu’il ne va pas. L’histoire, la
géographie du monde et le présent du monde. C’est à la puissance
catastrophique mondiale que le poème est consacré. Recensement des
folies humaines passées et actuelles : massacres, éradications,
sauvageries, génocides, attentats au nom de mythologies, religions (Je vois / se renouveler / les discours des
origines / toujours trop nombreux/ pour les autres sédentaires // la masse
informe et anonyme / de ceux qui crurent naïvement / qu’aucun crime ne
dépasserait l’entendement, P.61) Rappel
d’abominations, exécutions, douleurs (Treblinka
et ses deux sœurs / filant entre leurs doigts / le cassant fil torsadé /
d’une inhumanité amnésique // le sang des justes s’évaporer / poudreux ainsi
que les larmes / d’une cité vitrifiée / par les coulées pyroclastiques,
P. 39) et désignation claire des horreurs contemporaines : Je vois parce que la vérité est impossible à
écrire sans méprendre la teneur de tes
attentes Daech et Volkswagen trafiquer le compteur des
génocides la faux trancher les
âmes comme des fibres
optiques cette clarté que
rétractent les pupilles asséchées par les gaz de
combustion et Kurt Gerstein en
pleurs suffoquer (p. 40,41) Les visions qui se
succèdent strophe après strophe se bousculent dans un désordre et un
éclatement parce que tout surgit à la fois, dans l’incohérence mortelle des
événements : la maltraitance des migrants, le désastre écologique,
l’obscénité du gâchis et de l’économie, la démence politique. Que peut le
poète sinon dénoncer l’état des lieux avec une langue impitoyable, des mots
crus, des images violentes, des syllabes heurtées qui disent le brasier, les
ossements, les pourritures, les tortures, l’asphyxie de l’air, la frénésie
chimique, les incendies, crues, famines, exodes et misères ? Je vois les cargos chargés à
gueule mais sans équipage et tous feux éteints alors que la mer est
grosse (p.61) Je vois la gorge saturée de
terre recracher les milliards de
tonnes d’immondices de sacs flottant hors des eaux
territoriales (p. 61) la liste de ceux qui
mourront enregistrant des mois plus tôt les noms aphones et
méthodiques du sable de cette
foule de migrants (p.24) la maigreur des
migrants trois points de croix
rouges former triangle renversé que l’on se souvienne
(p.51) les effets entêtants de cette odeur
d’ammoniaque exhalée des carcasses de poissons (p. 64) ce temps où personne ne retient les
égarements ni les traces
superposées des errants à celles d’un crime
universel et insipide (p. 25) ce que condamnent les
irradiés de Nagasaki de Fukushima de
Tchernobyl ceux de Guantanamo du cimetière de
Timisoara l’indigence profanée par la
lumière (p.23). Au passage notons que cette strophe par
exception est un quintil. Notons aussi qu’il est
nécessaire de nommer les lieux, les sites, les gens pour rappeler les drames
et les scandales et qu’Otto Ganz n’hésite pas à le
faire dans tout le texte qu’il déploie faisant comprendre qu’il y a un
continuum entre le passé monstrueux et notre présent. Je n’ai prélevé que
quelques strophes. Il est difficile de choisir et impossible de hiérarchiser
les malheurs. De même qu’il est peu probable que l’on vienne à bout des
références littéraires, artistiques qui traversent ces vers de révolte, ces
vers coups de poing et prise de conscience. J’ai plutôt l’impression en
lisant et relisant ce recueil que je passe à côté de bien des énigmes et
profondeurs. Le préfacier Pascal
Perrot affirme que la lecture d’Orlando de Rudder
qu’Otto Ganz cite en exergue de Technique du point d’aveugle permet
d’accéder à l’œuvre de façon subtile. Je ne doute pas que cela soit vrai, ne
prenant connaissance d’Otto Ganz que par ce recueil
et ne connaissant pas, par ailleurs l’œuvre d’Orlando de Rudder.
La marge d’erreurs
pour interpréter même avec modestie un recueil d’un poète dont on n’a rien lu
d’autre est énorme, aussi est-ce avec précaution que je jette sur le papier
cette dernière remarque : si l’œuvre est globalement sombre comme je
crois l’avoir suggéré assez ouvertement, il reste néanmoins des éclats de
tendresse, de sensualité et une aspiration voire une intuition de la joie
dans la poésie d’Otto Ganz. En fin de recueil,
surtout, ce mot « joie » illumine quelques vers. Serait-ce lié à la
philosophie de Spinoza ? Serait-ce un effet d’une vision cosmique,
par-delà le temps terrestre qui nous est alloué ? Il faut peut-être
rester sur ces notes bienfaisantes et qui sait clairvoyantes qu’il déploie
alors. Je vois la joie déferler sur
le monde par l’allégresse des
ruines et l’idée de reconstruire
encore cette utopie que chaque poème
s’obstine à perpétuer […] la vapeur du poème
révèle où l’on ignorait mendier
la tendresse les insensibles de
naissance jamais ne sont détournés
de la voie pour eux la joie
déferlera comme la famine des nuées
de sauterelles la joie engloutira certains la voudront
lumineuse enfantine ou méritée elle ne sera qu’injuste et parce que je ne
joue pas le rire s’il vient
sera cristallin (P. 72-73, derniers
vers du recueil) |
|
3. Mireille
Diaz-Florian, Hors
Cadre,
Éditions du Petit véhicule, 2017 (Galerie de
l’or du temps N° 92, 25 €) Louons
d’abord le travail de l’éditeur qui apporte un soin de passionné à chacun des
livres d’artiste qu’il publie. Sobriété, artisanat, couleur bistre du papier,
typographie élégante et mise en valeur des tableaux. Merci donc à Luc Vidal
qui offre par ailleurs une Postface aux six récits de Mireille Diaz Florian. Avec
Hors Cadre, Mireille Diaz Florian
compose des récits envoûtants à même la chair particulière de chaque tableau
choisi. La première de couverture est la reproduction partielle du tableau de
Francisco de Zurbaràn, Santa Casilda que l’on retrouvera dans
sa totalité avant la cinquième nouvelle du recueil à savoir
« Alcazar ». Le
recueil s’ouvre avec « La Chambre » de Vincent Van Gogh : ce
sera la seule fois où le titre du tableau et le titre de la nouvelle
coïncideront à une nuance près : le C majuscule de Chambre devient
minuscule dans la nouvelle ! C’est aussi le seul récit qui ne se divise
pas en chapitres mais qui, déjà, prend en compte l’alternance d’un
« il » et d’un « elle », comme respiration intérieure du
récit. Le
second récit concerne un tableau de Wilhem Hammershoi,
« Intérieur » : une porte ouverte permet à celui qui regarde
de voir une partie d’une salle à manger. Ainsi, comme dans le tableau de
Vincent Van Goh, notre œil ne dispose que d’objets dans un espace où ceux qui
y vivent ne sont pas là. Dans ce cadre en mi teintes, les ocres et les bruns
dominent, de même qu’une impression de vie bourgeoise, bien rangée. (C’est un
autre contraste avec le tableau du premier récit dont la chambre solaire est
néanmoins rudimentaire !) De ce décor vont surgir des personnages pris
dans les rets des désirs et du quotidien : il y aura Dina, maîtresse de
maison et pianiste, nostalgique d’une enfance où sa sœur Hanne
ne l’avait pas quittée pour un lieu trop lointain ; il y aura Jens venu
ce jour-là pour couper du bois ; Kirsten, la voisine ; Henrick, son mari, plein d’égards qui « savait
qu’une part d’elle-même lui échapperait toujours » (p. 23) ; Hanne aussi relisant « la dernière lettre de sa
sœur » (p.27) et enfin Wilhem, le peintre. La nouvelle se structure
comme un puzzle, en une journée diffractée dans plusieurs consciences prises
dans les faisceaux secrets des passions. La
troisième nouvelle s’intitule « Les pas » et s’élabore à partir de
la peinture de Francisco de Zurbaràn, « La
vierge enfant endormie ». Myriam c’est l’enfant, Joachim est son père, Sarita, sa gouvernante qui l’a laissée s’échapper en
plein soleil à l’heure de la sieste, Ana est la mère, absente ce jour-là de
la maison et Francisco est le frère et le peintre : « … Il est entré discrètement. Myriam est assise
dans la pénombre. Une lumière douce éclaire son visage. Elle a posé son livre
sur ses genoux. D’un doigt, elle marque une page. Elle a fermé les yeux. Elle
semble ne rien percevoir de ce qui l’entoure. On pourrait la croire endormie.
Il la regarde, fasciné par son immobilité.
Il s’est avancé vers la fenêtre pour écarter les tentures. Elle n’a
pas bougé. Il s’est assis à l’écart dans un angle d’où il peut saisir
l’ensemble de la scène. L’ombre gagne peu à peu. Il voit maintenant le décor
d’une chambre. Il le connaît. L’ébauche du tableau en révélera le détail. Sur
la commode au tiroir entrouvert, il placera dans une coupe des roses et des
lys. À
lui seul, le symbole signera le caractère religieux qu’attendent les
moniales. » (P. 47) « L’attente »
est le titre du quatrième récit : en exergue le tableau de Johannes
Vermeer, « Femme lisant une lettre » : un intérieur, une femme
enceinte et des voix distinctes pour préciser les attentes, la vie secrète,
les frictions familiales, les intérêts divergents, le sens de la propriété et
du pouvoir : Grete est la jeune femme enceinte lisant une lettre, Jan
est le mari, Marike, celle qui aidera son ancienne
maîtresse lors de son accouchement, Erna, la sœur et Johannes, le peintre, à
qui Jan a commandé un portrait de sa femme enceinte. (P. 56) Au dernier
chapitre, le regard du peintre s’empare du mystère de la jeune femme et
saisit ce qu’il fixera à tout jamais sur la toile faisant vibrer la vie, la
lumière, les pudeurs : Elle était
revenue avec une lettre dont les pliures révélaient une lecture fréquente.
Elle en évoqua brièvement l’origine. Son visage s’était animé ; tout son
corps vibrait de l’audace de la confidence. Il lui proposa de la relire
durant la pose. On apercevrait en contre-champ, sur
la carte de géographie, le monde ouvert sur l’immensité. On s’attarderait
longuement sur la présence silencieuse de Grete. Avec le peintre, on
devinerait le remuement de la vie intérieure. Lorsqu’elle quitta l’atelier, la nuit étanchait
les derniers éclats du jour sur le canal. (P.65) « Santa Casilda »
est le cinquième tableau : de nouveau, l’Espagne et
Francisco de Zurbaràn et une histoire Alcazar dont l’héroïne est Casilda. À l’origine de l’œuvre la
vision furtive, incongrue d’une jeune fille s’enfuyant par une porte dérobée en contrebas de l’alcazar. Il a fermé les yeux.
Il a oublié ce qui, quelques instants auparavant alimentait sa mélancolie. Il
porte en lui la trace indélébile d’un regard, la pâleur de la main sur le pan
d’une robe, le frémissement du souffle, le pas pressé qui donne à la
silhouette la grâce de l’envol. (P.71) Il y aura dans ces pages
admirables de la nouvelle plusieurs destins croisant aussi bien la jeune
fille que la peinture : l’épaisseur du temps, la fascination pour le
tableau dans lequel on peut saisir l’émoi du besoin de fuir. « Ombre
portée » est le dernier texte. Il est inspiré par « Intérieur au
violon » de Matisse. Une fenêtre, des persiennes, un étui de violon
ouvert et recouvert d’un tissu bleu : nul humain sur la toile mais l’ombre portée de vies ardentes,
bouleversées, chavirées par l’Histoire et scandées par des nécessités
artistiques variées. La peinture, la photographie, la musique, l’écriture. Le
titre Hors Cadre n’a pas été choisi
d’emblée. Il fut d’abord question, comme l’avoue l’auteure dans la Postface,
d’appeler ce recueil de récits, Histoires
dans le tableau. Le cheminement intellectuel conscient ou inconscient qui
fait basculer d’un titre à l’autre est quelque chose de mystérieux, mais
l’apport magique de l’adoption du titre définitif est considérable. Bien sûr
que les histoires dépendent des tableaux, naissent des tableaux et sont
subtilement liées à eux, mais une force littéraire et poétique déborde hors le cadre précis du tableau et chaque récit garde une
telle autonomie qu’il serait saisissant et suffisant à lui-même même sans le
support de la peinture. Chacun
des personnages des six histoires ressent l’urgence de sortir de son cadre.
Il est à ce titre symptomatique que le premier récit, celui qui concerne
Vincent Van Gogh commence par « Il est sorti ». Or, sortir,
s’échapper, s’émanciper, fuir, voilà le dessein clair ou obscur de tous les
protagonistes des récits. Sortir du cadre, du carcan des contraintes
sociales, de la prison mentale (Vincent Van Gogh), de l’enfance (Myriam dans Les pas), de l’étouffement familial
dans L’attente, de l’austérité
carcérale de l’Alcazar pour vivre sa passion amoureuse comme Casilda, (« Casilda a
franchi le seuil au-delà duquel commence un chemin enténébré. Elle-même n’y
pourra rien. » P.73) ou de préserver sa part de mystère, de jardin
secret à travers le rêve, la nostalgie, la musique comme dans Intérieur. Jour ou Ombre portée. À chacun sa
manière pour avoir accès à sa part d’intimité et de liberté, quel qu’en soit
le prix à payer. Que l’on soit dans l’austère Espagne du peintre Zurbaràn, à Delft avec Vermeer, à Arles avec Van Gogh ou
sans doute à Prague, malgré Matisse et la pénombre méridionale du cadre de la
peinture dans Ombre portée, ce qui
rend vivants les personnages c’est la force du désir d’exister, de se
réaliser, d’échapper au regard étroit des autres. Et par-delà les
personnages, ce sont les peintres eux-mêmes qui par leur geste d’artiste
affirment ce besoin vital de singularité et d’audace. Mais
je tiens aussi à louer pour finir le talent littéraire de Mireille Diaz
Florian. Je tiens à dire avec force la beauté de la composition des récits,
la qualité de ses descriptions, la rigueur classique de ses phrases, leur
clarté, leur ciselure, leur précision. Elle réussit comme Madame de La
Fayette ou comme Pascal Quignard à cerner la passion, les émois les plus
fins, le feu sous la glace et tout cela avec élégance mais aussi pudique
lyrisme. |
Créé le 1 mars 2002
A visionner avec Internet Explorer
Notes de lecture
de
Dominique
Zinenberg
Francopolis,
septembre-octobre 2018