«
Tahmiddoucht » de M. Elmanouar.
par Hha Oudadess (Rabat)
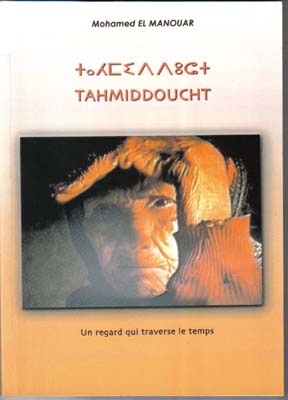
Introduction.
Dans son livre Tahmiddoucht, Moha Elmanouar a eu une
écoute
patiente et sans préjugé aucun. Nous avons tous eu,
à un moment ou à un autre, une véritable attitude
d´écoute en présence d´un ancien que nous
avons eu la chance de rencontrer. Mais juste après, ou parfois
après un certain temps plus ou moins long, tout est
oublié, sauf des réminiscences de plus en plus fugaces ;
de plus en plus rares. Mais l´auteur a, je ne sais pour quelles
raisons, senti la chance exceptionnelle qui lui est donnée. Il a
estimé, à sa juste valeur, l´importance de
l´événement : Sa rencontre avec Lalla Fadma
Tahmiddoucht. Et c´est alors que commence le véritable
travail ; qui a pris des années.
Moha a rencontré Tahmiddoucht, pour la première fois, en
2003. Le livre est paru en 2008. Cela fait donc cinq années de
travail. Respectueux de la Grande Dame, craignant de trahir la
pensée de celle-ci, il a effectué de nombreux
déplacements afin d´être auprès d´elle
dans la région d´Azilal ; et ce parfois même en
hiver. Il m´est arrivé de l´appeler pour avoir sa
compagnie à Rabat et de l´entendre me répondre
« Ah, je suis au pied du mont Azurki auprès de Lalla Fadma
».
Et puis, le livre que nous avons entre les mains
aujourd´hui, est
la nième version du premier jet de l´auteur. Toujours
soucieux de rendre justice à la Grande Dame, de rester aussi
proche que possible de ses déclarations et témoignages,
Il n´a laissé nulle place où la main ne passe et
repasse, comme le conseille le laboureur à ses enfants, dans la
fable de Lafontaine. J´ai d´abord lu un manuscrit
d´une cinquantaine de pages ; nous en sommes maintenant à
129. En me présentant le premier manuscrit, il m´avait
demandé d´écrire une préface. A ce moment,
j´étais très occupé est lui très
pressé, peut être, de faire partager son
ébahissement à la découverte d´une telle
personnalité dans un milieu démuni et dans des conditions
en principe dégradantes. Le livre est paru des années
après.
La préface, qui est très bien écrite, est de A.
Bougrine. Je n´aurais pas pu l´écrire de cette
manière. C´est un autre style. Ali Bougrine a
également été séduit et captivé par
Tahmiddoucht. D´ailleurs, il a un avantage sur moi. Il a
effectué un voyage, avec El Mmanouar, et a eu l´occasion
de s´asseoir auprès de la Grande Dame et de
l´entendre parler.
Plus tard, El Mmanouar m´a demandé d´écrire
quelque chose : Un préambule, une deuxième préface
(pourquoi ne pas innover ; Bougrine n´aurait de toute
façon pas rouspété), une présentation, un
poème. Je me suis mis à relire afin de produire une
présentation du livre. Un soir, alors que je prenais des notes,
la fièvre me saisit et un poème sortit, tout fait, sous
la plume. Il s´intitule `Le
temple du Zen´.
Le Zen.
Pourquoi Le Zen, alors qu´il s´agit de
Tahmiddoucht, une veille femme de chez nous ? Est-ce comparer
l´incomparable ? Non. C´est ainsi que nos poètes
sont seulement des Ineccaden, Imedyazn, dans notre conception moderne,
déformée par des préjugés en nous
incrustés par une formation - une déformation devrais-je
dire ?- orientaliste ou occidentaliste. Dans notre tradition Amazighe,
Imedyazen ce sont nos poètes au sens noble. Mais revenons au
Zen. Pour bien comprendre le lien, permettez moi de vous rapporter ce
que le premier maître de cette discipline a basé son
enseignement sur quatre principes fondamentaux :
(1) Une transmission en dehors des écritures.
(2) Aucune dépendance aux écritures.
(3) Une recherche directe dans la nature profonde de l´être
humain.
(4) L´atteinte de l´éveil par cette connaissance.
Et qu´est ce que donc Tahmiddoucht a fait d´autre, durant
toute sa vie ?
(1) Elle ne sait ni lire ni écrire. Donc tout est en dehors des
écritures.
(2) On pourrait dire que le deuxième point est sans objet, vu
que elle-même ne sait ni lire, ni écrire.
Mais, ce qui est merveilleux, c´est qu´elle n´a
pas succombé aux enjolivures des gens du livre.
(3) C´est ce que Tahmiddoucht a fait toute sa vie.
(4) Et je dis qu´elle a obtenu l´éveil.
Selon l´histoire du Zen, le cinquième
patriarche, an
moment de choisir son successeur, demanda, comme épreuve, la
composition d´un poème sur l´esprit du Zen. Il
refusa celui du plus ancien et le plus érudit des moines,
jugeant qu´il n´émanait pas d´une
véritable inspiration. C´est un alphabète,
chargé des petits travaux au monastère, qui eut sa
préférence. Celui-ci, ayant entendu parler du refus du
Patriarche, demanda à un moine de lui transcrire un poème
qu´il avait alors composé.
Voici quelques affirmations, de Lalla, qui dénotent, sans
ambages, une maturité Zen certaine.
`J´ai
très peu
d´histoire à raconter, car toute ma relation est du
vécu. C´est ce que j´ai enduré qui ma fait
dire ce que j´ai raconté en toute simplicité.´
(p. 74).
Ou encore
`Mais, on
était tous, les gens
de la montagne, dans cette grande école de la vie et de
l´indigence qui nous a appris à travailler pour vivre,
à lutter contre tous les aléas, à produire,
nous-mêmes et seuls, l´essentiel de nos besoins et à
limiter ces derniers au juste minimum.´ (p. 74-75).
Elle fait aussi sienne la sentence poétique
d´un amedyaz,
qu´elle appelle `notre poète´. Je me permets ici de
revoir un peu la traduction de El Mmanouar.
`La parole non
ajustée, va
dévier ; mieux vaut se taire.
Oh !
Bouche qui la
laisse, non apprêtée, en sortir.´
Evidemment, ce que je viens de vous dire est une
analyse a posteriori.
Je n´étais pas du tout conscient de tout cela au moment
où le poème s´était imposé à
moi.
Le contenu.
C´est une grande Lalla (Lal ne Akham=Lal Ukham
; La
maîtresse de maison) qui nous parle. Née tout au
début du 20ième siècle, elle aurait maintenant
environ 108 ans. Elle livre, sans tabou aucun, son expérience,
combien pénible mais riche en enseignements pour qui sait
entendre. Tous les sujets sont abordés : dureté de la
vie, amour, sorcellerie, djins, religion, etc. Mais donnons la parole
à Lalla, par El Mmanouar interposé.
Dès le premier paragraphe, du premier chapitre, le ton est
donné.
`Rares sont ceux
et celles qui
m´appellent encore Tahmiddoucht. Cette filiation disparaît
de plus en plus avec celles de mes congénères qui se sont
toutes tues par l´érosion du temps.´ (p. 17).
Elle se plaint de la mémoire qui commence
à lui faire
défaut. En fait, elle souffre beaucoup de ce handicap.
`L´oubli
serait alors
l´alibi pour la perte de mon identité. Et qu´est-ce
qui me restera après l´avoir perdu ? Que du superflu, du
factice.´ (p. 17).
Et plus fort encore
`L´oubli est
alors une seconde
mort. Même douloureux, le souvenir a un charme. Il console.´
(p. 17).
Elle souffre car elle veut transmettre la culture des aïeux. En
voici des adages, en exemples.
`Vaut
mieux rester debout que de
s´enfuir´
`Vaut
mieux tout perdre
que de quémander´
`Vaut
mieux manger du
laurier que d´avoir la boulimie´ (p. 17-18).
En ce qui concerne Dieu, la prière et
l´au-delà, la
sentence de Lalla est, on ne peut plus, nette.
`D´autres
disent,
m´a-t-on affirmé, que la seule langue du paradis est
l´arabe. Quelle honte ! Alors, comment je puis m´en sortir,
moi l´analphabète dans leur langue, mais croyante en Dieu,
en son prophète et en ses saints ? Moi qui passe mon temps
à prier en disant que cette colline est plus haute que
l´autre et Dieu est le plus grand. Mécréants, ces
telba !´ (p. 22).
Et encore
`Les telba et les
igurramen ne
viennent jusqu´à nous que pour nous piller, nous rendre
encore plus misérables, comme si cet état, qui n´a
jamais été le nôtre, ne leur suffit point. Et dire
qu´ils sont de gens de paix. Qu´ils périssent !´
(p. 23).
De même
`Quelqu´un
m´exhortait,
sans conviction aucune, que je devais faire mes prières. Je lui
répondais, dans ma perception stoïcienne de mon temps et de
mon tempérament que, s´il advenait pour lui de partir au
paradis, il n´a qu´à fermer les portes. Dieu est le
seul maître de ces mondes. Qu´ils périssent ceux qui
veulent vous enrôler dans une vie immature par des subterfuges
qui ne sont pas nôtres.´
(p. 27).
Au chapitre 2,
Tahmiddoucht
fait le point sur le changement, de la société, depuis la
colonisation. Elle commence par rejeter le vocable `Siba´
`C´est quoi
ce nom de Siba, de
l´anarchie? On nous a baptisé ainsi certainement parce que
nous sommes bien obligés de gérer nos affaires
nous-mêmes, en perpétuant, en conservant nos propres
structures, notre gouvernance ancestrale.´ (p. 29).
Elle repense, avec nostalgie, aux régisseurs
traditionnels
`Ah, ces
Ijemmaâen [...], ces
hommes de guerre et de paix, ces hommes qui donnaient du pain, ces
hommes qui connaissaient nos coutumes et notre Azerf, notre droit
coutumier, nos lois adaptées à toutes les circonstances,
à nos particularismes. Ils étaient respectés par
tous, car ils étaient l´émanation de tous ! [...].
D´ailleurs, les plus aptes à assurer une telle charge la
refusaient. Et ce n´était qu´après des
palabres, qui pouvaient durer des journées entières, que
le pressenti cédait enfin. [...]. Aujourd´hui,
l´argent, les alliances d´intérêt, les
compromissions, les magouilles aux limites démesurées,
ouvrent des chemins dans la mer.´ (pp. 29-30).
Ensuite, elle livre son appréciation sur
l´époque
présente.
`Nous
avions le choix. Nous
décidions de nos affaires. Nous étions les maîtres
de notre destinée. Aujourd´hui, nous n´avons
guère le choix. Les choix nous sont imposés. Nous les
acteurs d´une farce concoctée ailleurs.´
(p.
30).
Et aussi
`Maintenant,
depuis que ceux qui
portent ces sortes de couscoussiers sur les têtes ont mis de
l´ordre que nous n´arrivons pas à comprendre et, de
ce fait, est pour nous, un désordre puisque nous ne pouvons plus
nous défendre en attaquant et en pourchassant ceux qui viennent
nous voler, nous piller au grand jour ...Ah, quelle drôle de
situation !´ (p. 31).
Le chapitre 5
est réservé à son métier de bergère.
Elle dit avoir sillonné toute la contrée (monts,
vallées, cols, pentes, ...), en donnant les noms de lieux, de
villages, de familles. Elle avait commencé toute enfant
`Quelle vie, celle
d´un berger
et surtout d´une petite bergère que je fus, alors que
j´avais à peine six ou sept ans. [...]. Nous
n´avions pas eu d´enfance ni d´adolescence.´
(p. 45).
Il n´y a pas, chez elle, de place a posteriori
pour un lyrisme
exaltant. Elle sait qu´elle n´a pas vécu une vie
enviable. Elle ne connaît pas le mensonge. Elle ne veut tromper
personne.
`La vie du berger,
ce n´est pas
une vie. Il suit le troupeau, le ventre vide, sous le soleil, sous la
pluie, dans le froid, pieds nus. Lorsqu´il neige, il doit aller
couper des branches de chêne vert pour nourrir le bétail,
et le propriétaire dit toujours qu´il ne travaille pas
assez.´ (p. 46).
`Si quelques bêtes
arrivaient
à mourir, c´est toi seul qui en es responsable.´
(p. 46).
Le contact est direct, total, naturel, intuitif et
réciproque
avec les animaux (Chiens, moutons, vaches et surtout les
chèvres). L´auteur a été amené
à réserver le chapitre 6 à ces dernières.
Il commence par
`La chèvre
est ma raison
d´être (expression qui apparaît dans le titre
même du chapitre). Elle est la raison d´être ce que
je suis.´ (p. 53).
Quand Lalla parle des chèvres c´est de
`mes
chèvres´ qu´elle parle, comme si elles
étaient toujours les mêmes, en sa compagnie. Elle dit
même `mes chèvres
chéries´ (p. 51). Elle exprime la
réciprocité des services rendus, comme suit:
`Pendant
les période
difficiles, je peine pour les nourrir, les maintenir en vie au
détriment de ma santé, de ma survie. Je me prive pour
elles. Et, quand les temps sont plus cléments, elles me sont
d´un grand réconfort.´ (p. 53).
Et puis, elle leur fait confiance
`On passait par la
montagne et on
descendait le col, toujours derrière nos chèvres. Au
fait, ce sont nos chèvres qui nous montraient le chemin. Elles
étaient et sont toujours nos guides infaillibles.´
(p. 55).
En lisant attentivement, le lecteur
s´apercevra que les
chèvres de Tahmiddoucht sont bel et bien maternées,
évidemment selon les moyens disponibles .
`A nos
chèvres, nous donnions
de l´orge, de l´herbe après chaque retour. Celles
qui allaitent sont les premières à être servies.
Rien de plus normal. Une poignée quotidienne, mais constante,
leur suffit à survivre, dans les temps qui courent.´
Quant aux chevreaux
`Tawraght,
l´autre
chèvre a mis bas un très petit chevreau maigre. Je le
prends toujours avec moi. Après avoir tété, je le
fais dormir à mes côtés jusqu´au matin.´
(p. 90).
Par ailleurs, voici comment Tahmiddoucht estime les
services rendus par
une représentante de la race canine
`Ma chienne Taja
veille sur nous.
Elle est mes yeux.´ (p. 25).
Le chapitre 11
traite de l´amour. Bien rares, les romans qui
feraient
l´impasse sur l´amour, qu´il soit doux, violent,
dévastateur ou autre. Mais ici, il s´agit d´autre
chose. Il s´agit de l´Amour. L´Amour universel qui
contient tous les autres amours. Le premier paragraphe commence par
`Â
tayri ! Tayri ! ! Tayri ! Ad
agh ur iss isghous Rebbi, Ula agh tte ikkes ge ul.´
Que je me permets de traduire différemment
`Ô Amour !
Amour ! Amour ! Que
Dieu ne nous en brûle pas, ni nous le retire du coeur.´
Voici maintenant d´autres appréciations
de Lalla, sur
l´Amour. Elle commence par des généralités,
certainement puisées dans la mémoire collective amazighe.
`[...]. Nous,
Imazighen, nous
n´avons cesse d´aimer. Point, pour nous autres, n´est
haine, rancune ou rapine. L´amour implique le bonheur et
l´aisance, l´équilibre et
l´épanouissement.´ (p. 87).
Puis, elle en vient à ses propres propos qui,
naturellement, ne
peuvent qu´être empreints de l´amour de la nature, de
l´Amour universel.
` Avez-vous
déjà vu une bergère ayant vécu ce que
j´ai enduré, se
sentir aujourd´hui heureuse ? Je ne le pense pas. [...] . Moi,
j´aime
tout ce qui m´entoure. J´aime mes montagnes, mes collines,
mes chèvres,
mes enfants, mes voisines. Toute ma vie, je l´ai passée
à aimer. J´aime
la bonne parole, le beau poème. J´aime le lever du soleil,
son coucher,
la nature. [...]. D´ailleurs, je ne serais enterrée que
dans cette
terre. [...]. Je suis née pour aimer.´(p.
87).
Bien sûr, elle ne se considère pas
comme parfaite
`Nombreux sont
aussi les êtres
et les choses pour lesquels j´éprouve une aversion
irrésistible. [...]. Ils veulent m´amputer de ce que je
suis. [...]. Je ne puis renier ma substance, mes origines profondes
[...]. Tamazight je suis, je ne suis pas la meule qui tourne au
gré de la main, des mains qui la manipulent. [...]. Nos Isaffen,
nos fleuves finissent dans des barrages qui irriguent nos terres
confisquées, [...].´ (pp. 87-88).
En ce qui concerne l´amour individuel
`Dans un couple,
l´amour est
tout autre. Il est égoïste, physique et, de ce fait,
illusoire et changeant.´ (p. 88).
Et voici l´origine de l´expression `L´amour
véritable ne peut se
payer que par l´amour´, de l´auteur
`S´il
n´a pas
d´amour mutuel, il n´y a rien, aussi bien pour les hommes
que pour les femmes. Qui les fait rencontrer et qui peut les unir ?
C´est ce qu´ils ont chacun dans leur tête. Les voies
de l´amour sont impénétrables.´ (p.
88).
Mais elle sait qu´elle n´est pas le bon
exemple
`Quant à
moi, ma
destinée est différente. Mon orgueil, ma liberté,
mon sens de l´honneur ne m´ont créé que trop
de surprises, de supplices, avec ceux et celles qui ont croisé
mon chemin.´ (p. 88).
`Qu´est-ce
que tu
veux que je fasse ? Echine courbée, je ne pouvais être.
Point de remède contre le destin.´ (p. 88).
Le sujet de la sorcellerie et des démons est
traité aux chapitres 12 et 13.
L´attitude
de Lalla est celle d´une personne nette, saine d´esprit,
qui n´a nul besoin d´intermédiaires entre elle et la
nature. Elle ne vit pas dans la crainte maladive d´un coupable.
Sont alors pris à partie les telba, et autres, qui vivent de
cette peur endémique.
`Souvent elles (de
nombreuses femmes)
n´ont cesse de croire en ces choses infâmes, à la
magie, en ces charlatans qui leur prennent le peu d´argent
qu´elles arrivent parcimonieusement à économiser en
vendant une poule ou quelques oeufs. Quand à moi, je ne leur
accorde aucun crédit. [...]. Moi, je n´attendrais jamais
que ces charlatans me dictent leur volonté, me dire ce que je
fais, ce que je suis, ce que je dois faire. [...]. Je ne fais aucune
confiance à un ahergui, un sorcier qui vient me proposer ses
soi-disant services. Je ne peux jamais les croire. Je ne peux,
même forcée, leur adresser la parole.´ (p.
93).
Elle rapporte alors de nombreux subterfuges dont
elle a
été témoin et qu´elle met à nu par un
raisonnement limpide, d´une simplicité aveuglante. Et
quand il s´agit d´écrit, elle rejette la chose, tout
en reconnaissant qu´elle n´y comprend rien. C´est
l´aversion saine et atavique contre ce qui est insaisissable et
qui ne fait pas partie de la cosmogonie amazighe.
`Les pauvres
femmes se complaisent
à ne retenir que ce qui leur convient, ce qui compatit à
leur sort. Moi, je ne comprends pas leurs tours maléfiques. Ils
prennent un livre et disent voilà ceci, voilà cela. Moi,
j´ignore ce dont ils parlent. Je ne suis pas instruite.´
(p. 95).
En parlant des djins, elle insiste sur le fait
qu´elle n´en
ait jamais vu. Elle persiste et signe en reprenant plusieurs fois cette
affirmation. Cependant, elle sait évidemment tout ce qui se dit
sur eux. Et elle le rapporte fidèlement. Mais c´est
toujours avec des `il parait que´,
`on dit que´, `on raconte´, etc. Et de sa
part avec des `je n´en sais rien´,
`je ne sais
pas si c´est vrai
ou faux´, etc. Elle finit pourtant par
l´expression `que Dieu nous en garde´.
Conclusion.
El Manouar, qui a toujours maintenu le cordon avec
ses racines,
s´est immédiatement senti à l´aise. Mais tout
en caressant sa corde lyrique, il a pu garder l´attitude de
l´observateur objectif. Comment a-t-il pu naviguer avec, aisance,
entre deux mondes qui, pour beaucoup, semblent inconciliables ?
El Manouar ne veut pas du tout écrire sur une femme
âgée, excentrique, an vue d´un succès de
librairie. C´est avec égard qu´il écoute
attentivement et rapporte avec fidélité les propos -les
dits et les non-dits- de la Grande Dame qui est
l´héroïne de ce roman. Des séquences de la vie
quotidienne sont rapportées, dans le détail, avec leur
cruauté ou leur douceur. Il ne s´agit nullement de
fictions que se seraient forgées des intellectuels vivant dans
des mondes virtuels. Alors, attention à certaines chutes qui
pourraient en surprendre plus d´un.
Il y a d´abord cette photo, en première de page. Ce
n´est pas pour aguicher le lecteur, en particulier
étranger, féru d´archaïsme. Il s´agit de
présenter, simplement, une personnalité qui impose le
respect. A ce propos, le vocable `Dinosaure´ apparaît dans
mon poème `Le Temple du Zen´.
Mais c´est
l´auteur qui l´a utilisé en premier. Cela m´a
d´abord dérangé, mais j´ai fini par
l´accepter, vu toute la grandeur, au sens le plus noble, qui lui
est associée.
Tout au long du roman, le calme et le ton du discours de nos anciens,
sont très bien rendus. Et ce qui est merveilleux, en
français. L´auteur nous livre une prose fluide et
captivante. Elle est émaillée de mots en tamazight, dans
le texte même ? A noter aussi des proverbes, des vers, des adages
et des expressions donnés en tamazight et traduits en
français. Ainsi, avec ce livre, El Manouar entame, peut
être, une carrière de romancier. Il s´est fait la
main, dirions-nous, sur des sujets intéressants -`Tamazight, la
constitutionnalisation ou la
mort´[1] est même capital- mais ils ne laissent pas de
place au sentiment et au lyrisme. Plusieurs passages, de ce roman,
m´ont rappelé la belle plume du regretté Moha
Abehri dans `Etre ou ne plus être´.[2]
Epilogue.
Durant une longue période El Manouar ne
cessait
de nous parler, de se parler, de Tahmiddoucht. Nous avons
visionné, chez lui, le film de Ivan Boccara. Mais c´est en
regardant une photo, une seule photo -celle en première de
page-, que je fus saisi. Le visage tout en rides. La main
parcheminée, posée à plat sur la tête. Le
tricot élimé. Un être d´un autre temps, perdu
dans l´immensité de l´univers. Mais les yeux, le
regard ?
Le Temple du Zen
Tahmiddoucht ?
Dinosaure, peau parcheminée !
Une hère plus que vieille.
Une carcasse à jeter à la poubelle !
Bergère inculte des monts de
l´à
haut.
Vie sans saveur,
De quelque femme sans demeure.
Sentence nulle,
De piètres maestri.
Voilà-t-il, ses yeux perçants,
Son regard,
Sa posture altière,
Et sa maître-leçon !
Tel l´Atlas,
Elle écrase, de son âge,
Un siècle et un autre.
Quand et comment,
Sublimissime dénuement,
A-t-elle pu la Bergère,
Dompter le Temple du Zen ?
L´intello bat de l´aile ;
Myope, il va, dans ses grimoires,
Loin chercher,
Ce que, elle, de la main, elle peut toucher.
Tahmiddoucht, la perle,
En Tamazgha, n´est pas rare.
Tihmiddouchin, moult il y en a.
Muettes,
Il faut leur donner la parole !
C´est la Mère, la grand-Mère ;
C´est L´Aïeul,
De temps oubliés,
De temps inconnus ;
C´est Tamazight.
Hha Oudadess
(Rabat, Janv. 2009)
[1] Moha El Manouar , Tamazight, la constitutionnalisation ou la mort,
Edit. Imp. Bouregreg, Rabat (2006).
[2] Moha Abehri, Etre ou ne plus être : Séquences de vie
de petites gens exilés dans leur peau, Centre Tarik Ibn Zyad,,
Rabat (2002).
*****************************
Hha
Oudadess
pour
Francopolis
mars 2009
recherche
Ali Iken
|