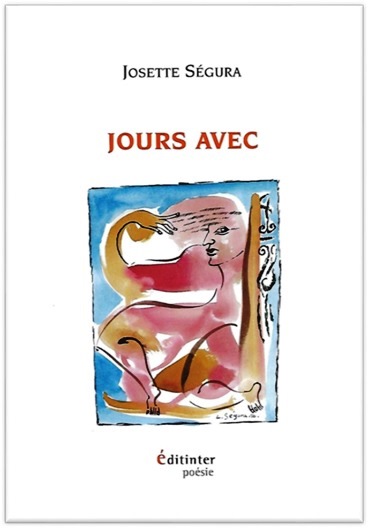|
LECTURES –CHRONIQUES
Petites études
par Dominique Zinenberg :
1.
En
vue de naître de Jean Marc Sourdillon,
éditions
L’Arrière-Pays, 2017. (9 euros)

Que faut-il pour
naître ? Un paysage écrin-ancrage, une pulsation (un cheval lancé au galop venait droit sur nous), de l’amour
pour une femme et un paysage, une langue sobre de poète et de conteur, la
chaîne des générations, une distance (Paris), une géographie de
prédilection (Les Cévennes), le lien secret avec les morts :
« Ces deux tombes pourtant sont bien réelles, elles sont posées là,
parallèles, devant le grand paysage ouvert et elles ne jurent pas dans ce
paysage. » (p.20) et la subtilité d’une écriture qui livre le grand
secret de la vie avec des mots simples et justes, un intime qui atteint
d’emblée l’universel.
Le joli recueil
est bref, de petit format, léger au poignet et en 37 pages, réparties en
cinq temps, il fait accéder à la quintessence de la culture dans ce qu’elle
a de plus humble et pourtant de plus noble. La plupart du temps les textes
sont des proses, parfois en italiques mais il y a aussi quelques poèmes.
« L’enceinte »
est composée de quatre textes qui forment une approche géographique et
historique des Cévennes. Se dégagent un paysage et un climat qui s’avèrent
terre d’accueil pour la vie et nid propice aux naissances. « Je me
souviens ; là quelque chose vivait » (p. 9) et texte 3
« C’est un paysage en attente, tourné vers l’avenir. » (p.11)
Mais terre d’accueil pour les morts puisque les guerres de religion ont eu
au moins une conséquence bénéfique, celle d’établir « le droit de
n’être pas enterré dans le cimetière communal, mais de reposer chez soi,
près des siens, vivants et morts, dans ce paysage où l’on a vécu. »
(p.12)
« Les deux
tombes » rappellent ce fait historique, placent la mort dans la vie et
le paysage, sont présentées comme des objets usuels « Deux sièges vide
face au grand paysage de la vallée » (p.13) qui n’ont rien de
terrifiant et annoncent l’amour « Deux petites tombes côte à côte/
comme si elles se donnaient la main. » Mieux même elles deviennent
plus loin (p. 15) « Deux sentinelles en posture de guet/ comme si
elles allaient renaître demain. »
« Je ne suis que le témoin de tout
cela, et pourtant tout se passe comme si c’était moi qui étais à leur
place.
Je vois les tombes, je ne vois pas leurs
occupants mais je vois ce qu’ils verraient s’ils en étaient sortis et
s’étaient assis sur leurs sièges.
Je suis à leur place et j’ai leurs yeux.
C’est sans doute qu’entre eux et moi, il
n’y a pas de solution de continuité.
Que quelque chose qu’ils abritent, qui
continue de les habiter, brûle en moi, continue de se consumer ;
quelque chose de vivant en eux, de mourant en moi qui s’allume et se met à
brûler à l’instant où, non loin de leurs yeux fermés, les miens se sont
ouverts. » (p.16)
Qu’est-ce que le
feu, thématique amorcée ici, si ce n’est le passage possible du flambeau de
la vie, du relais de la vie ?
Le huitième poème
en prose introduit une réflexion sur le sens polysémique du mot
« tombe » qui passe de l’acception « pierre tombale » à
celle de « chute ». Jeu de mots qui permet au poète de dire :
« Le mot « tombe » ne convient pas. Il n’y a pas de
pierre tombale, ni couvercle, ni dalle. Il ne peut être question de
chute. » et plus loin, raisonnant sur ce concept de chute et
d’élévation, Jean Marc Sourdillon ajoute :
« C’est le mot « ouvert » qui leur convient, le contraire de
« tomber ». Les tombes n’auront pas besoin d’être ouvertes. Elles
le sont déjà, comme on le dit d’un visage franc et souriant, comme on le
dit d’un livre … »
Dans le dernier
poème de cette partie, une nouvelle métamorphose des tombes est proposée.
Ce sont les derniers mots du poème précédent qui l’ont permis :
« Elles sont comme un livre ouvert, avec ses deux pages en regard
l’une de l’autre… » Cependant les inscriptions ont disparu, « Les
caractères se sont effacés à cause de la lumière, du vent, de la pluie et
de l’oubli. » Ce qui fait que le livre ouvert reste à écrire, de
nouveau, non pas comme si on eût fait table rase du passé, mais pour entrer
dans le continuum palimpseste des générations.
Avec les cinq
poèmes de « Transhumances », le poète atteint un lyrisme intime
d’une beauté très pure, c’est un chant d’amour, un hymne au paysage aride,
aux bergers, aux souvenirs de jeunesse, à la réalité érotique et intime de
l’amour présent. Et ces strates se superposent ouvrant un dialogue avec
l’aimée, qui tout à coup devient le centre de l’attention, le sens du
poème :
« Je
ne savais pas à qui parler dans mon poème.
Désormais
je sais.
Bien
sûr, c’est à toi que je parle, bien que tu n’aimes pas venir ici, dans les
Cévennes. » (p. 26)
Transhumances des bêtes bien sûr,
mais transhumances du « je » qui fait des allers-retours
Paris/les Cévennes en voiture. Plus finement on entend aussi le mot
« humus » qui renvoie aussi fortement à la vie qu’à la mort,
envisagée comme un cycle naturel, une transformation après tant d’autres
transformations.
« Reposerons-nous ainsi quand il
sera temps, l’un à côté de l’autre dans un grand sommeil de paille – une
montagne transparente dans le dos ?
Nous tenant par la main comme
aujourd’hui, le regard parallèle tourné vers les lointains,
regarderons-nous avec calme s’approcher la vie par vagues à la vitesse des
montagnes ?
Mais dès à présent, c’est la
réponse : dans la vie convergente que nous menons tous les deux,
jamais loin l’un de l’autre, chacun dans son temps mais dans la même
maison, quand nous tournons les yeux là où naître s’accomplit peu à peu –
un même regard déjà nous traverse. » (p.27)
« Sans appui
et avec appui » est le quatrième temps du recueil. C’est un texte
écrit en italique. Là encore le poème a été préparé en amont avec la
thématique de l’oiseau. (« Où pourrai-je essayer mon
aile ? » (p.23) ) Le poème est tout
entier métaphorique, allégorique. L’image de l’oiseau qui s’envole enfin,
c’est la métamorphose à laquelle aspirait le moi. Mais c’est aussi,
ambiguïté et complexité obligent, la naissance de l’enfant, « Il est accueilli par un milieu nouveau,
mélange de lumière et d’air, un peu pareil à l’eau. Il était admis lui-même
un peu pareil à lui. Ne s’envolait pas, se coulait en lui. »
Vient enfin
« En vue de naître » qui est doublement titre. L’enfant à naître
apporte un message qu’il apporte en vain au grand galop de son cœur battant
dans l’enceinte du ventre maternel. « Mais voilà, il n’avait pas de
mots, seulement son rythme, il ne connaissait pas l’usage de la parole ni
des signes que les hommes se font entre eux pour s’entendre. D’ici qu’il
les apprenne, il aurait depuis longtemps oublié le message qu’il était venu
si vite nous apporter. Pour lors, il n’avait pour nous parler que
l’événement de sa naissance. » (p. 37)
Mutisme, mais
flamboiement, message secret qui est paysage et mémoire immémoriale,
naissance et mort se rejoignant dans le cercle continu de la vie, dans
l’enchantement des mots qui les célèbrent si bien.
« Je me suis alors souvenu du
premier geste quand j’ai su que nous allions avoir un enfant, du premier
geste du commencement de tous les temps, quand j’ai su qu’il y allait avoir
naissance dans l’enceinte de notre vie, qu’un enfant allait naître là entre
nous, du dedans de nous vers l’avant, notre avenir – du seul geste que j’ai
fait, spontanément, sans réfléchir : ouvrir la fenêtre à deux
battants.
C’est à ce geste que j’ai pensé, devant
cette image que je ne pouvais pas voir tout à fait, devant cette image qui
fuyait. » (p. 34)
©Dominique
Zinenberg
|
2.
Jours
avec de Josette Ségura,
édinter poésie, 2017 (12 euros),
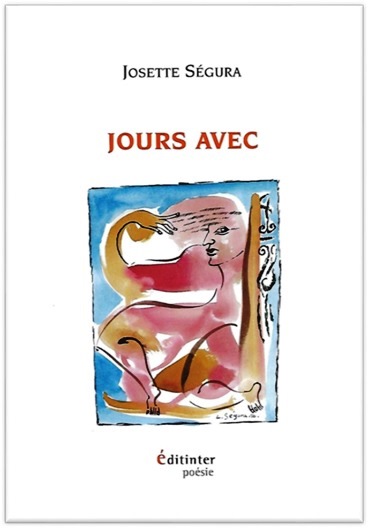
|
Quand un poète
nous offre ses « jours avec », on sait d’emblée que c’est un
véritable cadeau, un choix d’humeur positive, une sélection d’une grande
élégance afin que le lecteur ne soit pas obligé de prendre en charge les
« jours sans ». C’est un peu comme si, pour l’hôte qu’on reçoit,
qui fait une halte chez soi, on laissait de côté le fardeau de la vie pour
ne pas l’accabler, même si le fardeau peut ne pas être loin, les soucis
bien réels, mais le parti pris de Josette Ségura c’est de tendre un miroir
souriant, lumineux et discret quand l’amateur de poésie entre dans la
lecture de ses poèmes.
L’intranquillité
apprend à trier, à
recycler, à laisser décanter,
tout ceci, elle nous
l’offre
comme si elle
connaissait déjà son autre visage,
à lâcher
le fond sombre de
chacun
toujours prêt à
s’insinuer.(p. 21)
Visiter en
recueillant la poésie des noms propres des sites, la beauté des paysages,
la modestie superbe des églises dont on retient un détail émouvant, une
sorte de présence bienfaisante, réconfortante, voilà un des moyens
d’honorer les jours, de retrouver la saveur minimale du Livre d’heures. Et
c’est ainsi que s’ouvre le recueil de la poète : une imprécision
compensée par la description fine de l’impression qui est restée dans la
rétine et dans le cœur après avoir passé le seuil de la petite église sans
nom de village :
Tu ne sais plus
dans quelle église était cette Vierge en bois,
elle ne peut plus ni donner,
ni prendre, les mains sont cassées,
c’est de tout le
corps, de tout son visage de bergère aux bonnes joues
qu’elle vient vers nous,
son regard demande,
ce coin de l’église
est sombre et humide,
pas souvent ouverte,
on a posé un
bouquet d’immortelles, de fougères et de blé,
on devine un
silence
puis le bruit de la
porte qui s’ouvre, se referme,
parfois un oiseau reste
enfermé,
vole de vitrail en vitrail. (p.7)
Enchantement des
noms de villages à prononcer, à énumérer et qui forment enfilade de visites
courtoises, admiratives : Saint-Bernard-de-Comminges (p. 8), Carennac,
Cadouin, Rocamadour, Conques (p. 9), Causse de Gramat, de Limogne (p.10),
Bruniquel, Penne-de Tarn à la Terrasse, Roussergues
(p. 11), Saint-Guilhem-le-Désert (p.12), Monfort
(p.13), Carlucet, Gavaudun (p. 14), vallée de l’Aveyron, Montricoux (p.15),
le Quercy, Bourg- de Visa (p.23), Tonneteau
(p.29), les Landes(p. 33), les vergers d’Esclassan
ou de Montesquieu (p. 34), Martigny (p. 36). Pur bonheur de la magie des
noms de lieux éveillant le lieu dans ce qu’il a de plus mystérieux, parfois
de plus familier pour les amis, le voisinage, les gens du cru et de plus
abstrait pour tout lecteur ignorant mais quand même emporté par la grâce
des lieux-dits.
Car ces lieux
sont offerts lors de conversations où tout indique un ici et maintenant,
une énonciation entre « je » et « tu » qui facilite
l’échange et la possibilité au poème de se déployer, non dans une éloquence
solennelle, mais dans un conciliabule intime, bon enfant, amical.
Ainsi une des
tâches à laquelle se voue Josette Ségura c’est de restituer à l’aide de
vers simples, de mots simples et clairs, les rituels des escapades dans les
environs ou les petits riens du quotidien : jardinage, détail sur le
temps qu’il fait, sur la couleur du ciel, la lumière du jour, les jeux des
enfants, l’odeur des églises, l’envoi d’une lettre, la lecture du poème de
Gaston …
Ce sont des vers
au présent, dans le froissement presque imperceptible du temps qui passe,
de la journée qui commence ou s’achève, des saisons qui défilent apportant
chacune ses particularités modestes et reconnaissables.
Chemin du retour,
le silence de ce
village est impressionnant,
vacances scolaires, Petit
Casino fermé, pas un chat,
nous achetons de
l’eau dans une épicerie,
mais comme si ici,
c’est étrange,
de la pâte à pain
levait. (p. 37)
En filigrane, une
sagesse et un art poétique se dégagent de ces doux poèmes qui versent leur
lumière tamisée sur toute chose. Une sagesse qui est présence à soi, aux
autres, à l’instant, à ce que l’observation exacte contient de précieux et
d’unique, de spirituel aussi :
Peut-être que
chacun n’accueille la vérité de sa vie
que petit à petit,
chaque fois un pas de
plus
grâce à ce roulis
incontournable,
la vie de tous les jours,
les événements. (p. 35)
Et un art
poétique dont les racines profondes, essentielles, sont d’abord de vivre
(« Des occasions d’écrire/ et puis non/ vivre plutôt/ cueillette de
pommes … p. 34) sans la pose de l’écrivain ou du poète, comme si seul le
vivre pouvait faire résonner « le ton juste », dans la saisie
mystérieuse du réel par le biais d’une plume légère, frôlant les choses du
monde avec délicatesse pour apporter le baume qui manque tant à nos jours
pleins de bruit et de fureur.
Vivre, dire, mine
de rien,
comme si cette façon
pouvait donner le ton juste,
sans bruit, comme il
faudra passer ici,
souvent à la recherche
d’une légèreté, d’une brise
quand les tracas
troublent la paix
avec laquelle
pourtant nous allions. (p.39)
Une mission d’humaniste
à l’écoute du secret simple de la vie qui va, et qui, à force d’attention,
réussit à « faire respirer le jour » (p. 46).
|
Petites études
par Dominique Zinenberg
Francopolis
décembre 2017
|