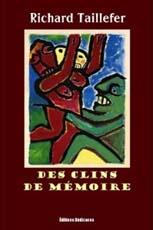Revues papiers, |
|
|
________________________________________________________
Regard
sur l'écriture - Soleil et Cendres - Au coeur du cri... et plus
|
|
RICHARD TAILLEFER
 Portrait littéraire par Patricia Laranco ( Extraits de la conférence donnée par Patricia Laranco le 2 juin à Saint-Mandé, dans le cadre de l’association Arts et Jalons ) Issu par son père
d’une famille originaire de la Picardie (donc du Nord de la France),
par sa mère, d’une famille de souche provençale, Richard
Taillefer a passé son enfance en Provence, entre Saint-Maximin,
le village de Montmeyan dans le Var, et Marseille.
Il garde un souvenir assez vif de sa prime enfance, pendant laquelle, en raison des problèmes de santé qui affectaient sa mère, il a été, selon ses propres termes, «ballotté» - et en particulier, de la période qu’il a passés au restaurant «Le Carillon» à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, que tenait sa grand-mère Antoinette et son grand père Roger, grand résistant pendant les années sombres de la deuxième guerre mondiale, "juste parmi les justes de France" , avec qui il a entretenu une relation très forte. Cette grand-mère dotée d’une forte personnalité, mais aussi aimante, généreuse, fait partie des personnages qui l’ont marqué le plus profondément. Sa mère, quant à elle, exerçait tour à tour les professions de femme de ménage et de cantinière, tandis que son père était traminot à la régie des trams. Richard est donc issu d’un milieu modeste. De l’âge de cinq ans à celui de onze ans, il a eu l’occasion de vivre, dans la cour de ce qu’il appelle une «maison rurale» en plein Marseille, à deux pas du parc Borély. Une «vie en vase clos» où le contact très étroit avec la nature a décisivement éveillé sa propension au «rêve» et ses facultés imaginatives. C’est très tôt, dès l’âge de dix ans, qu’il se sent attiré par l’écriture (il produit alors des «plagiats de contes et de poésies» qu’il s’en va régulièrement montrer à ses instituteurs). La versification l’attire, il ne cessera plus dès lors de «griffonner». A Marseille, au collège Charpy puis au Lycée Technique Jean Perrin où il fait ses études, il n’arrête pas d’écrire des «acrostiches» que ses copains lui commandent en vue de les offrir à leurs petites amies. Mais sa rencontre sérieuse, réelle avec la littérature aura lieu bien plus tard, en 1977, avec sa toute première publication, à compte d’auteur, d’un ensemble de poésies rassemblées sur l’initiative de son épouse. Tirée à 300 exemplaires, la plaquette connait un indéniable succès d’estime et lui vaut, déjà, dans le cadre de son milieu professionnel (celui des cheminots), une forme de «reconnaissance». Il avoue qu’il subissait à l’époque essentiellement l’influence de Jacques Prévert, qu’il cite comme sa «première découverte poétique». Ensuite, la chance lui fait croiser la route de Maurice Bourg, directeur de la revue poétique La Sape ; cela se passe en région parisienne, à Montgeron où il travaille désormais (depuis 1973, en tant que cheminot à la SNCF), lors d’une exposition intitulée Le Mur aux Poèmes. Bourg, qui a déjà remarqué son écriture, se montre très encourageant et, de fil en aiguille, lui permet de faire la rencontre de poètes confirmés tels que Serge Brindeau et Jacques Arnold. La Sape lui consacrera un de ses traditionnels "feu de bois" Dans le même temps, outre les poésies de Bourg et de Brindeau, il découvre celles de Guillevic, de Jean L’Anselme, de Vénus Khoury-Ghata, de Michel Deguy, de Guy Allix, de Jean-Luc Maxence, de Jean-Claude Renard, de Jean Orizet et de Jean Breton. Il se met à fréquenter assidûment les soirées poétiques et achète régulièrement, en kiosque, les revues Poésie 1 et Vagabondages. Il parle de cette époque (fin des années 1970) comme d’une époque déterminante, d’un véritable « big bang poétique » qui va orienter sans retour l’évolution de son style. Autre influence – et pas des moindres – celle de la Beat Generation américaine qui révolutionne la poésie occidentale en y introduisant le «je», le «quotidien» et «l’engagement». Les diverses influences de ce qu’il nomme «l’écriture sapiste» par référence à La Sape et qu’il définit comme «heideggérienne, philosophique», et des représentants français du courant de la Beat Generation (en particulier Daniel Biga et Franck Venaille) fusionnent en lui pour devenir une source d’inspiration majeure. Emporté par son
élan, Richard crée avec Michel Méresse, Karim
Boudjemaà, Marc Chenaye, Marie Taillefer, Sabéha
Bezghiche, en 1981, la revue Poésimage,
laquelle va lui permettre de publier une centaine d’auteurs et
plasticiens et d’en inviter aussi un grand nombre aux soirées
poétiques de la revue, qu’il organise à la
médiathèque de Savigny-le-Temple. Cette belle et riche
revue – qui durera une bonne vingtaine d’années – lui permettra
du même coup de réaliser quelques entretiens d'artistes et
notes de lecture.
En 1981 et 1984, deux de ses recueils obtiennent le Prix Froissart : «Litanie pour quatre saisons» et «Au rond-point des falaises». Signalons au passage que, dans le jury de ce prix poétique, figurent Hélène Cadou (la veuve de René-Guy Cadou), Luc Bérimont ainsi que Francine Caron et Jean Rousselot... Lorsqu’on lui demande s’il se voit ou non comme un « autodidacte », Richard répond, assez catégoriquement, qu’ «il ne s’est jamais posé la question» ; en fait, il réfute plutôt ce terme au profit de celui de «poète débraillé», qui lui semble beaucoup plus juste. La raison ? L’«autodidacte», pour lui, est quelqu’un qui s’est fait tout seul et il ne pense pas que cela soit son cas, vu la dette qu’il se reconnait envers les poètes qu’il a eu l’occasion de fréquenter. Quand on lui pose une autre question, celle de ses «choix de lecture», il indique sans hésiter : Yves Martin, Daniel Biga, Franck Venaille, Serge Wellens et André Laude, et les poètes de la mouvance de l'école de Rochefort. Mais, parallèlement à sa vocation de poète actif, Richard Taillefer mène d’autres activités qui sont elles aussi très liées à l’engagement, à la présence au monde : syndicaliste et socialiste «par tradition familiale», il occupe les fonctions de délégué du personnel au sein de son entreprise pendant une quinzaine d’années. En 1986, il met sur pied une section du Parti Socialiste à la Gare de Lyon. Beaucoup plus tard, en 1996, il devient conseiller municipal à la mairie de Savigny-le-Temple puis encore, en 2001, maire-adjoint chargé de la culture de cette même municipalité. Ceci coïncide avec le moment où s’arrête la parution de la revue Poésimage, dont il était le Directeur de la Publication. A partir de
l’année 1991, Richard
semble disparaître du milieu de la poésie
française. Cela ne l’empêche cependant pas de continuer
à écrire, quoique sans publier.
Il faudra attendre l’année 2008 pour qu’il recommence à proposer ses textes, et il se tourne alors vers la Toile, en premier lieu vers le site web Le Capital des Mots d’Eric Dubois, puis vers divers blogs (dont Patrimages). Il déclare utiliser le Net commun laboratoire» car, dans son optique, ce n’est qu’un «moyen supplémentaire de communication» et en aucun cas un éventuel remplaçant du « papier », du livre, auquel il demeure profondément attaché. Il envoie d’ailleurs, à la même époque, des poèmes aux revues Comme en poésie, Décharge et La Grappe.
J’ai demandé
à Richard quels étaient ses deux «livres de
chevet», ses deux grandes références
littéraires
du moment. Il m’a révélé que, «depuis
quatre-cinq ans», il en avait deux : une anthologie de poésie chinoise
classique, qui le touche particulièrement, son ancrage
dans les «choses essentielles», la profondeur du lien
avec la nature et avec «tout ce qui nous entoure» qu’elle
reflète, et Le Gardeur de
troupeaux de Fernando Pessoa dont il adore «l’aspect
contradictoire» et «l’approche philosophique». A
cela, il ajoute quand même les Lettres
d’Antonin Arthaud à son médecin qui le fascinent
parce qu’elles marient «la lucidité» à
«son contraire» et surtout parce qu’elles lui montrent
«comment on va au fond de son puits».
Un peu comme Gabrielle
Althen, il se
définit volontiers comme un poète de la présence
au monde. Immensément attentif aux choses de la vie («les
choses simples», «le temps qui passe», «le
rapport [de l’être] aux autres et à la nature», «l’absence»,
«la
mort»), il communie intimement avec elles. Il contemple, sent,
mais également pense sans qu’il y ait séparation entre
ces trois démarches. Sa dimension philosophique, il la trouve
dans ce qu’il appelle un «équilibre entre
mélancolie et espérance» qui fait – finit-il par
dire – de lui «un pessimiste offensif». Au plan
stylistique, il dit se méfier des métaphores, les
éviter car selon lui elles peuvent «devenir un
système», une sorte de procédé
littéraire.
Pour ma part, je n’aurai pas de peine à le définir comme un inquiet amoureux de la vie, ou encore un amoureux inquiet de la vie. Ce qui retient dans la poésie de Richard, c’est sa combinaison assez inattendue de distanciation contemplative et de présence, de disponibilité chaleureuse au monde, aux gens. Richard, c’est la vigueur du mot et l’apesanteur du manque. C’est la nudité rugueuse – mais poreuse – de la lucidité : «Rien ne subsiste de rien» (dans Jusqu’à ce que tout s’efface). C’est l’empathie chevillée au corps, la chaleur généreuse de l’homme qui a vécu et se sent concerné par tout ce qui l’environne. C’est le plaisir d’éprouver, d’être vivant voilé par l’ombre subtile du sens du tragique. C’est le tour de force de combiner, d’entrelacer parfois étroitement le soleil de la chaleur humaine, de la proximité avec les autres et le vent gris, glacé d’une détresse existentielle plus ou moins diffuse. Homme attentif (on ne le
dira jamais
assez), Richard attend. Tout en ne perdant jamais de vue que «Rien ne subsiste de rien»,
que «nous naviguons à
vue» et que «Tout
est vrai et faux à la fois».
Poète philosophe subtil, Richard, comme on vient de le voir, possède un sens de la formule qui le rapproche de l’aphorisme. C’est qu’il traque la simplicité mystérieuse de la vie et la complexité souvent impénétrable du monde au moyen d’une écriture que l’on sent exigeante, finement travaillée mais qui pour autant ne s’écarte jamais du chemin de la simplicité, de l’authenticité des mots. En ce qui me concerne, j’aime sa façon chaleureuse d’aller à l’essentiel. La poésie de Richard Taillefer, à mon humble avis, lui ressemble : trop profonde pour se laisser encombrer par un intellectualisme prétentieux ou des formatages. Trop ancrée dans l’opacité du réel et dans son incomplétude énigmatique pour perdre son temps à essayer d’impressionner inutilement. Elle impressionne.
Richard
Taillefer
présenté
par Patricia
Larancorecherche Dana Shismanian Francopolis septembre 2012
|
Créé le 1 mars 2002
A visionner avec Internet Explorer