|
Dialogues avec l'arbre dans
Aux arbres penchés,
d'Emeric de Monteynard
Lecture
croisée de Cécile Guivarch et Nathalie Cousin
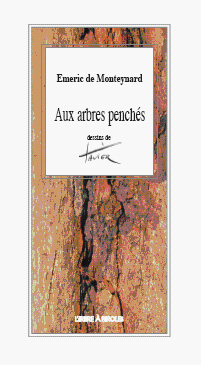 Après la
tempête de décembre, je me souviens d’avoir vu deux ou
trois arbres, au moins centenaires, clairement déracinés.
On sentait bien qu’ils avaient dû se faire surprendre par la
violence de la chose, qu’ils avaient dû s’agripper les uns aux
autres, un peu n’importe comment, de telle sorte qu’ils
s’étaient retrouvés ainsi de travers, effrayants,
liés contre nature. Je me souviens aussi sous l’amas, d’un petit
panneau métallique d’à peine deux ou trois mètres,
encore intact et planté, que je n’avais jamais remarqué
auparavant, ni ici ni ailleurs : « Danger ! Arbres penchés
». J’ai aussitôt eu envie de crier du dedans, de
dédier un recueil, quelque chose, un hommage, à ces
arbres penchés longtemps debout ou d’abord debout.
(Préface par Emeric de Monteynard) Après la
tempête de décembre, je me souviens d’avoir vu deux ou
trois arbres, au moins centenaires, clairement déracinés.
On sentait bien qu’ils avaient dû se faire surprendre par la
violence de la chose, qu’ils avaient dû s’agripper les uns aux
autres, un peu n’importe comment, de telle sorte qu’ils
s’étaient retrouvés ainsi de travers, effrayants,
liés contre nature. Je me souviens aussi sous l’amas, d’un petit
panneau métallique d’à peine deux ou trois mètres,
encore intact et planté, que je n’avais jamais remarqué
auparavant, ni ici ni ailleurs : « Danger ! Arbres penchés
». J’ai aussitôt eu envie de crier du dedans, de
dédier un recueil, quelque chose, un hommage, à ces
arbres penchés longtemps debout ou d’abord debout.
(Préface par Emeric de Monteynard)
Au marché de la poésie en juin dernier, j’ai
rencontré Emeric de Monteynard au stand de L’arbre à
paroles. J’avais déjà eu de nombreux contacts
écrits avec cet auteur dont j’apprécie l’œuvre et je ne
voulais en aucun cas rater cette entrevue qui me promettait la joie de
tenir entre les mains son nouveau né, Aux arbres
penchés.
En ouvrant ce recueil, outre mon
admiration devant le superbe travail d’illustration de Xavier, ma
première surprise est le constat d’une écriture
différente au regard des précédents ouvrages
d’Emeric de Monteynard. Aux courts poèmes aux vers
aérés, où les silences se poursuivaient en tentant
de dissimuler l’émotion du poète, se succèdent de
courts poèmes de quelques lignes, non versifiés. Emeric
de Monteynard s’adresse dans cet ouvrage à tous les arbres, qui
ne sont souvent pas nommés, toutefois un chêne pointe son
nez en page 43. Il nous faut toutefois attendre le dernier poème
pour se mettre à l’ombre des ormes, du sycomore, des pins du
midi, des tilleuls, du marronnier, des bambous, du pommier, du
séquoia, de l’olivier, du merisier ou du platane
Cet ensemble de textes nous mène
sur le chemin de l’observation quotidienne de l’arbre. Dès les
premières lignes, le poète nous met en garde, disant
qu’il ne peut être un arbre. Par une série de
questionnements, Emeric de Monteynard nous amène à
réfléchir sur la condition de l’arbre. L’arbre parfois
humanisé ou l’homme qui aimerait s’y fondre, devenir arbre pour
apprendre à résister, à exister, à
traverser le temps. « peut être
aurais-je dû t’imiter » Pourtant au fil des
poèmes, l’arbre touche de près l’homme, jusqu’à
presque se confondre, mais gardant toujours une certaine distance. Ils
ont des points communs au prime abord mais très vite, le
poète se rend à l’évidence qu’ils sont
différents de par leurs préoccupations, leurs besoins,
leur façon d’être, leur conception de la vie et de la
mort. Par exemple, Emeric de Monteynard relève à
plusieurs reprises que l’arbre en fixant la lumière a pour
principale ambition d’aller toujours vers le haut, de regarder devant,
l’avenir. L’homme, le poète, tente de l’imiter « comme toi, je m’efforce de maintenir en moi la
lumière ». Mais est-ce qu’il y parvient
vraiment ? Il est à observer une grande admiration du
poète pour l’arbre « Tu sais
nommer ce que tu soustrais, compter les étoiles – en plein jour…
et tu sais mesurer l’infini, à l’infini des chemins. »
L’arbre est un modèle, représente la puissance, la
supériorité sur l’homme, jusque dans le fait de ne pas
avoir besoin d’écrire, de parler pour se défendre,
s’exprimer et peut être d’aimer et de se faire aimer. Le bonheur
de l’arbre dépend finalement de peu de choses et n’est pas
matériel.
Un arbre ne
s'adonne qu'à une chose, une seule, peut-être essentielle
: fixer la lumière.
Parfois, le lecteur ne sait plus vraiment
où se situent la frontière entre l’homme et l’arbre,
cette confusion est amenée par l’emploi du « nous ».
Mais cela se contredit par le fait que la plupart du temps l’emploi du
« tu » ou du « il » pose une séparation
entre eux. Règne un perpétuel balancement entre
l’imprécision entre les deux êtres et
l’impossibilité pour l’homme d’être assimilé
à l’arbre. Tout cela est renforcé par l’emploi
fréquent des mots en italique, le questionnement et une relation
étroite entre l’homme et l’arbre capables de dialoguer entre
eux. Un exemple de cette imprécision où le confusion
entre « moi », « lui », « toi » :
« Je
porte en moi, en lui, l’ivresse et la sève – le transport de la
terre.
En toi. »
Emeric de Monteynard rend compte
également de la vie, du temps qui passe, de la naissance
à la mort dont l’arbre à l’inverse de l’homme ne se
soucie pas de la même façon. L’arbre a pour atout
d’être capable d’ « user le
temps » On recense également les tracas de la
vie, les angoisses, que l’homme tout comme l’arbre se doivent
d’affronter. L’arbre vit sans se soucier du regard des autres, de leur
manière de vivre, de la mort.
À manquer de racines,
faner nous fait peur. Ou ça peut. Il voit bien que ça
pèse.
Aussi devant
nous, ne parle-t-il jamais de ses racines, ou dit radicelles ou «
ses vieux » – ceux qui veillent, ou rhizomes ou du grec,
précisant chevelus… pour faire savant, décalé,
faire sourire.
L’arbre représente la vie, une vie qui
s’écoule des racines jusqu’à la sève et revient
aux origines : « tu as su laisser la
vie entrer en toi » Il a également une
fonction charnelle tout en conservant à la fois certaine pudeur
et une grande générosité. L’arbre à
l’inverse de l’homme ne recherche pas la lutte, ni le sang, son
rôle est avant tout de donner la vie, une fois qu’il est parvenu
à exister.
« A
peser autant sur lui-même, il a besoin d’apprendre à
résister – d’abord à l’étouffement. A exister.
Mais il
étend ses bras et nous les ouvre. Et les écarte. Pour
nous – Comme si donner était sa chance à lui ! Comme si
la vie pouvait aller – se poser – ailleurs et puis disparaître
à jamais ! »
Enfin, Emeric de Monteynard, nous
délivre un message. Celui du massacre des arbres par les hommes.
« Comme
vous, j’ai entendu des arbres grincer, siffler, crier, fouetter l’air…
avant de tomber. […]
En quoi l’homme serait plus fort et qu’aurait-il à gagner…
à trop souvent renouveler cette épreuve ? »
Emeric de Monteynard achève son
recueil par une citation de Lionel Ray qui conclue superbement avec le
fait que les arbres représentent la vie.
« Beaucoup d’oiseaux
sont nés ce matin.
Les arbres ont réussi »
Par Cécile Guivarch
  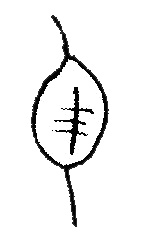
« Qui d’autre que lui,
aurait ainsi lier la terre
à ses cieux – intercéder peut-être ? »
Après Le petit homme qui brûlait[1] et quatre
recueils de poèmes publiés chez Éclats d’encre[2]
, voici « l’opus 6 », tant attendu, d’Émeric de
Monteynard : Aux arbres penchés.
Comme un arbre qui pousse, j’ai pu en
suivre un peu la croissance, depuis les premiers extraits
publiés dans la revue prédestinée de L’Arbre
à paroles (n° 116 avril-mai-juin 2002), jusqu’à
la publication de l’ensemble aux mêmes éditions de L’Arbre
à paroles, sorti juste pour le Marché de la poésie
à Paris, en juin 2006. Avec les dessins de Xavier[3] .
Je me souviens qu’une fois Émeric
de Monteynard m’avait dit à propos de ses arbres
penchés : « ce ne sont pas (que) des arbres dont je
parle dedans ! », phrase qui au début m’avait
intriguée et déroutée. Au fur et à mesure
que j’avançais, je m’interrogeais sur ce qu’il avait voulu dire,
je prenais la mesure de la complexité des rapports de l’homme et
de l’arbre, dans les deux dimensions, de leur similarité et de
leur altérité, qui, de tous temps, ont fasciné les
poètes et les écrivains[4] .
Avec Aux arbres penchés,
il s’est agi pour moi d’une véritable initation. De nombreuses
lectures, de ce recueil et d’autres en parallèle, m’ont
été nécessaires pour, peut-être,
espérer trouver un chemin en moi, dans l’infini des chemins
que m’a ouvert Émeric de Monteynard. Il ne peut être
question dans le cadre de cet article de rentrer dans le détail,
mais seulement de poser quelques jalons que j’appellerais pour une
lecture expérimentale ou encore exploratoire. Parmi plusieurs
angles possibles et après avoir longtemps tâtonné,
j’ai choisi le thème des dialogues avec l’arbre par analogie
avec les Dialogues avec l’ange de Gitta Mallasz[5] .
J’entends le mot dialogues dans un sens large, de contacts,
d’échanges et de relations, non limités à la
parole.

Cécile Guivarch a constaté
comme moi que le recueil paraissait à première vue
différent des autres : une suite de soixante courts
poèmes en prose à l’écriture le plus souvent
horizontale. Toutefois sans renoncer pour autant complètement
à la verticalité, d’ailleurs les premières
versions des Arbres penchés étaient encore dans
ce style. Les poèmes, de longueur très variable, de deux
ou trois lignes peuvent atteindre une quinzaine et même une
trentaine pour le plus long.
Pour un poète du silence comme
Émeric de Monteynard, cette abondance inattendue - tout en
gardant les qualités de concision et de densité qui ont
toujours été les siennes - m’a frappée. C’est
presque pour lui un long discours ! De même j’ai noté la
fréquence inhabituelle des points d’exclamation (plus de trente)
par rapport aux autres recueils : comme s’il était devenu
impossible au poète de maîtriser davantage son
émotion, et que tout à coup, il se mette à
s’exclamer, à répéter certains mots, expressions,
phrases, ou à les prononcer avec insistance (nombreux
italiques). Ce changement pourrait s’expliquer (au moins en partie) par
cette envie folle de crier… du dedans, comme il le dit dans
l’introduction, et de dédier ce recueil aux arbres
penchés, déracinés par la tempête de 1999.

Le titre Aux arbres penchés est
suivi d’une seconde dédicace : À ceux qui riaient face au
vent, expression reprise dans le premier poème[6] (p. 12) : « N’allez pas croire ce qu’on vous lit… ou que
j’ai pu rire autant face au vent, être un arbre ».
Qui parle ici ? L’arbre ? Le poète s’identifiant à
l’arbre ou parlant à sa place ? et à qui s’adresse celui
qui parle en ces paroles énigmatiques : « à vous boire, je souriais »
? D’emblée, ces questions soulèvent le problème de
l’ambiguïté constante de l’énonciation. Mais quoi
qu’il en soit, un premier type de dialogue est ouvert, ici du «
je » au « vous ».
Les cinq poèmes, suivants,
très courts, sont plutôt des réflexions sur l’arbre
en général à la 3e personne du singulier («
Un arbre », « il ») où apparaissent plusieurs
éléments qui font partie de la thématique du
poète, mis en relation directe avec l’arbre : la lumière,
la pierre, le silence (tout de même encore bien présent),
le temps.
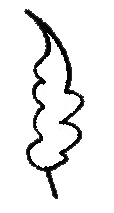
Un deuxième type de dialogue
commence à s’instaurer, ici entre l’arbre et la pierre ; il est
avant tout sensoriel et passe d’abord par le regard : « Mais il sait aussi donner du temps et regarder
la pierre[7] . » (p. 14).
Le premier dialogue entre l’homme et
l’arbre vient ensuite. Le verbe « explorer » connote
l’idée d’un voyage dans un pays lointain ou inconnu que l’on
découvrirait peu à peu. : «
Un arbre, ça s’explore » avec lenteur et
douceur, à la fois « à
mi-voix… mais avec les mains » : l’homme conjugue
sensorialité (ouïe / toucher) et sensualité - toutes
deux essentielles chez Émeric de Monteynard – renforcée
par la comparaison avec les femmes : «
comme il s’est fait – des siècles, des femmes… durant. »
(p. 17).
Plus loin, le poète invitera
à tous les hommes à écouter : « C’est charnel un arbre : il suffit d’entendre,
écouter monter sa sève – écoutez !…. »
(p. 44) et à toucher :
« Osez !
Touchez-le !
Pour votre main – d’abord
Et la former à la douceur » (p. 34)

Le dessin en regard du poème
cité plus haut (p. 16-17) suggère un arbre aux formes
féminines, douces et arrondies. Il devient possible d’y lire une
forme de réponse de l’arbre à l’homme. Comme si, par le
truchement de sa main, Xavier, l’auteur des dessins, se faisait
l’interprète des arbres d’Émeric de Monteynard[8] .
Ainsi un nouveau type de dialogue se
fait jour entre l’arbre et l’homme par les textes et les dessins. Plus
généralement, dans Aux arbres penchés,
même si les dessins n’ont pas été
réalisés au départ pour accompagner
spécifiquement tel ou tel poème, le choix de mise en page
finalement adoptée pour les dessins et les poèmes, met en
évidence des correspondances remarquables entre les deux arts et
les deux artistes.
L’écriture précise et
concise du poète, sa façon de dire toujours l’essentiel,
son choix de parler de l’arbre sans nommer d’espèce
précise (sauf exceptions pour le chêne et tout à la
fin), tout ceci s’accorde à merveille avec la
sobriété et la stylisation des dessins en noir et blanc
de Xavier.
Toutefois, il ne faudrait pas en
déduire qu’il n’y ait qu’un type d’arbre, ou qu’ils soient tous
représentés de la même façon. À
côté des arbres aux formes rondes, aux allures
plutôt féminines (voir aussi celui de la p. 36, mis en
regard du beau poème sur l’arbre apprenant aux mères qui
portent un enfant l’instant et la durée), il y a à
l’inverse des dessins d’un grand dépouillement, mais tout aussi
expressifs, d’un arbre à la silhouette noire longiligne, aux
branches dénudées, à l’image de l’homme qui lui
fait face (p. 58), le touche (p. 33) ou se tient à califourchon
sur une de ses branches (p. 81). À noter qu’il s’agit encore ici
d’un autre dialogue : celui de l’homme et de l’arbre dans le dessin
lui-même.
Dans l’un des poèmes les plus
émouvants du recueil où l’homme confie à l’arbre
son secret le plus intime, « Tu sais
donc ma folie et l’odeur des femmes – de celles que l’on serre. Aussi
comment pourrais-je redouter, de l’une ou de l’autre, d’enceindre , un
jour, nos vies ? [9]» (p. 25), le dessin qui y
répond est ce même arbre semblant être enceint de
l’homme.
Ainsi présentés,
poèmes et dessins ne peuvent plus se concevoir l’un sans
l’autre, ils dialoguent et se répondent entre eux comme on vient
de le montrer.
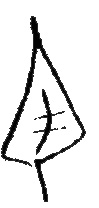
Mais continuons notre lecture… Le
dialogue peut aussi prendre la forme de paroles directement
adressées à l’arbre. Le poète tutoie alors
l’arbre, lui parle de plus en plus intimement, recherche les points
communs qu’il pourrait avoir avec lui, comme on fait avec un ami pour
se connaître mieux : « Comme toi,
je m’essaye… je m’efforce de maintenir en moi la lumière »
(p. 19), ou bien il reconnaît au contraire à l’arbre, avec
une certaine envie, des savoirs ou des pouvoirs que lui, homme, ne
possède manifestement pas : «
Tu sais compter les étoiles – en plein jour… et tu sais mesurer
l’infini, à l’infini des chemins » (p. 21).
Le poète pose aussi beaucoup de
questions à l’arbre, mais parfois, on ne sait plus, encore une
fois, si c’est l’arbre ou l’homme qui parle, notamment quand il(s)
di(sen)t « nous » : «
Comment nous taire enfin… nous faire silencieux (…)? »
(p. 23) Ici apparaîtrait peut-être plus clairement le point
d’identification où l’on pourrait véritablement parler d’
« homme-arbre »[10].
Dans les dessins de Xavier, je vois un
des portraits de l’homme-arbre p. 87 : la tête de profil avec
l’œil, le nez, le menton, un chapeau-feuillage, des bras-branches et
des mains-feuilles, un tronc, un ventre et des jambes-bas du tronc et
racines.

Il y aurait encore beaucoup à
dire sur l’homme-arbre, si l’on accepte cette terminologie, et sur les
autres rapports de l’homme et de l’arbre dans Aux arbres
penchés, autant dans leurs ressemblances ou analogies que dans
leurs différences (physiques, psychologiques…) etc. que je ne
détaille pas ici, laissant le lecteur les découvrir par
lui-même. Ils sont si riches qu’ils auraient pu faire l’objet
d’un autre article[11] . Toujours en relation avec les dessins si
« parlants » de Xavier, je mentionnerais les
étonnants arbres-hommes qui marchent (p. 68-69).

Grâce à la notion d’homme-arbre, certains
mots peuvent devenir complètement interchangeables comme dans
cet autre dialogue en style indirect qui met en scène l’arbre
(=homme) et les dryades[12] (=femmes)
« À quoi bon
laisser des traces… quand tout
est accompli ? »
disait-il aux dryades
[femmes ?].
« À quoi bon
?»
Il sait très bien,
qu’elles rêvent de lui, de l’habiter, d’écrire… et
d’infinis. Il le sait. »
Mais que voulez-vous, un arbre
[homme ?], ça peut parfois se la
raconter, et même y croire. Ça peut vouloir faire sage.
Ça peut être épuisé, timide, avoir froid…
» (p. 63)
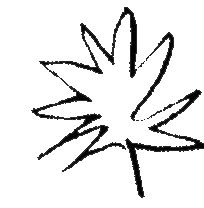
Il y a bien d’autres traces de dialogues
poétiques de l’arbre[13] avec ce qui l’entoure , ceux du vent et
de la racine (p. 35), des oiseaux de l’étoile et de l’arbre (p.
60-61), jusqu’au « chant du vent qui
danse avec lui » (p. 33)…

À lire et relire Aux
arbres penchés, j’y ai senti autant des poèmes que
des méditations[14] profondes sur la vie, la mort, l’amour,
l’amitié, le temps, la solitude... Cette dimension spirituelle
reste en effet très présente chez Émeric de
Monteynard et est souvent mêlée de sensualité.
Ainsi, lorsque l’arbre est comparé à un
derviche (– la robe en corolle, en corymbe)
:
« …Dans ta chair, ma chair, tes liens, mes liens,
du coup s’embrouillent, s’imbriquent et se nouent
au Sacré
-à l’instant. » (p. 51)
Je pense en particulier à une
photo de Reza représentant « la danse du monde » par
un derviche d’Istanbul (Turquie, École de Molâna) ; je
relie ces images au poème initial des arbres penchés : « et faire ainsi danser la magie des mondes qui
m’habitaient… » (p. 12)
Témoigne aussi de cette
spiritualité le dernier dialogue de l’homme et de l’arbre,
où ce dernier est comparé à un ange dans une
ultime interrogation : « Serais-tu
comme un ange, gardien de la terre, quelqu’un qui se tait, qui sait,
qui porte[15} … ? » (p. 94)

Edward Burne-Jones, L’échelle de
paradis[16] .
Conclusion :
Aux arbres penchés m’a
permis de découvrir beaucoup d’autres poèmes et
poètes sur les arbres notamment Des poètes et des
arbres : promenade anthologique d’Eryck de Rubercy [17], Le
Tracé des Sèves de Jeannine Dion-Guérin,
Arbres de Jacques Prévert, Éloge de l’arbre
de François Solesmes qui dit :
« …Celui qui aime l’Arbre, qui
s’est longtemps pénétré de son dessein, de son
ordonnance et s’il se peut de ses vertus, sent bien qu’il y aurait
profit à l’écouter en chacune de ses variations ; qu’un
éloge de l’Arbre devrait se prolonger par des louanges
particulières qui rendissent pleine justice à son
invention en fait de port, de fût, d’écorce, de ramure, de
limbe, de pièces florales et de fruit ; en fait de
sous-étage et d’ombre[18] . »
N’est-ce pas ce que fait Émeric
de Monteynard saluant à la fin, comme dans une pièce de
théâtre les acteurs, douze espèces d’arbres pour
leurs qualités intrinsèques respectives ? « Dans l’ombre des ormes ou du sycomore, des
pins du Midi ou des tilleuls d’antan… » (p. 95)
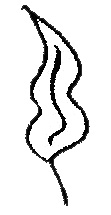
Mes propres dialogues avec l’arbre
m’ont entraînée à aller toujours plus loin, dans
des lectures et des interprétations de plus en plus
personnelles, trop peut-être ?… Ainsi, parmi les arbres du
recueil des Arbres penchés, celui qui « voue sa
vie à ceux qui cherchent »… «
ceux qui voient partout des sanctuaires à secrets ! »
(p. 55) est celui que j’aurais aimé… épouser… si j’avais
été une dryade[19] !
Ne pourrais-je m’identifier à
elle, m’incarner en elle … par le rêve, l’imaginaire, la
métamorphose, la poésie, que sais-je ? ou par un exercice
de méditation similaire à celui qui « consiste
à s’identifier à une pierre, puis à une plante, un
arbre, ensuite à un animal et enfin un humain[20] » ?
Alors, pourquoi ne pas être une dryade ?

 La dernière semaine des
vacances cet été, j’étais dans le Pays de Caux,
par hasard à quelques kilomètres d’Allouville-Bellefosse,
où se trouve un vénérable chêne
millénaire, d’autant plus vénérable qu’il abrite
une chapelle dédiée « à Notre Dame de la
Paix érigée par Mr l’abbé du détroit
curé d’Allouville en 1696 ». La dernière semaine des
vacances cet été, j’étais dans le Pays de Caux,
par hasard à quelques kilomètres d’Allouville-Bellefosse,
où se trouve un vénérable chêne
millénaire, d’autant plus vénérable qu’il abrite
une chapelle dédiée « à Notre Dame de la
Paix érigée par Mr l’abbé du détroit
curé d’Allouville en 1696 ».
L’arbre, remis en valeur, consolidé à
l’aide de charpentes métalliques, greffé de plus jeunes
rameaux, est le fleuron des arbres de la région. Le plus
extraordinaire est que l’on peut entrer à l’intérieur du
tronc pour voir la statue de Notre Dame et dans la chapelle
supérieure un crucifix.
 J’ai pensé à
nouveau Aux arbres penchés et au sanctuaire à secrets.
À Allouville, on peut toujours, non seulement se mettre sous,
mais dans un arbre, « on y est bien. » J’ai pensé à
nouveau Aux arbres penchés et au sanctuaire à secrets.
À Allouville, on peut toujours, non seulement se mettre sous,
mais dans un arbre, « on y est bien. »

Au terme de cet article, je voudrais
remercier :
- Cécile Guivarch pour m’avoir si gentiment
proposé de « croiser nos deux notes »,
- mes parents, ma famille,
- mes amis et en particulier Jeannine Dion-Guérin,
- Eryck de Rubercy pour sa belle promenade anthologique.
- mes amis arbres dont : l’abricotier, le thuya et le pin de mon
jardin, l’arbre penché d’Espalion, les marronniers d’Inde, le
ptérocarya du Causase, le chicot du Canada, le séquoia
géant de Californie et tous les arbres qui ornent le Jardin du
Luxembourg, les châtaigniers centenaires de Montmorency, et, avec
une intention particulière, le chêne millénaire
d’Alouville…
-Merci surtout à Émeric de Monteynard, mon seul
Orphée depuis quatre années…
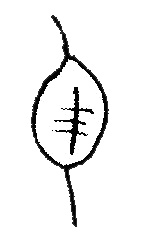
Par Nathalie Cousin.
Dessins de feuilles de Xavier : cf. Aux arbres
penchés, p. 62. Homme-arbre p. 87.
Photos : L’arbre millénaire d’Allouville-Bellefosse (76). (N.
Cousin, août 2006.)
[1]Ed. du Laquet, 2001, 124 p.
[2]Aimer le dire, Concéder l’or et le bleu, Dans ce
tremblé des dires, Toucher les doigts du sourcier.
[3] Xavier Vilató Lascaux. Voir la notice bio-bibliographique
dans Aux Arbres penchés, p. 101. Voir aussi : Xavier : Paso a
paso : 1975-2005, julio-septiembre 2005, Malaga, Fundación
Picasso, 2005, 183 p.
[4]Robert Dumas, Traité de l’arbre : essai d’une philosophie
occidentale, Actes Sud, 2002, 254 p. Voir en particulier les chapitres
I (« l’arbre symbolique ») et II (« L’arbre de
paroles »).
[5]Edition intégrale, trad. du hongrois par Gitta Mallasz, nouv.
version revue par Dominique Raoul-Duval, Aubier, 1994, 396 p.
[6]L’expression « rire face au vent » se trouvait
déjà dans Le petit homme qui brûlait : «
Faut-il te l’écrire ou te le dire, mon amour, le murmurer ou le
crier, les yeux dans le cœur ou l’âme à rire aux
éclats face au vent (…) » (lettre dix-huit, p. 47 ).
Toucher les doigts du sourcier s’ouvrait également par un rire :
« J’ai froissé du rire dans tes mains ».
[7]Cf. « Donne à ton tour / Du temps à la pierre
» (Si elle se tait, To)
[8]Jacques Prévert avait eu la même idée dans son
recueil de poèmes précisément intitulé
Arbres accompagné de gravures d’arbres de Georges
Ribemont-Dessaignes (Paris, Gallimard, 1976, rééd. 2004,
69 p.). Il dit : « peut-être sans le savoir Georges
Ribemont-Dessaignes dans ses dessins est quelque part leur
interprète » Pour donner un autre exemple, Le tracé
des sèves de Jeannine Dion-Guérin, (Soisy-sur-Seine,
Éditinter, 2003, 69 p.) contient des « illustrations de
l’auteur inspirées de Vincent Van Gogh ».
[9]Mot rare pris dans ce sens (rendre enceint(e)). J’en ai
trouvé un exemple en poésie sur le site
http://vitriol.over-blog.com/article-1548716.html (publié par
Triplex Nomine) « enceindre reine en dire de ce cri : ci commence
le chant dédié à son corps ».
[10]Cf. Robert Dumas, op. cit.
[11]Je renvoie à celui de Cécile Guivarch.
[12]]Nymphes des bois et des forêts, des chênes en
particulier (dryades vient de drus, chêne en grec). Eurydice par
exemple était une dryade. Cf.
http://fr.wilipedia.org/wiki/Dryades»
[13]Ou de l’homme-arbre, ou de l’arbre parlant par la bouche du
poète ? Cf. Dialogues avec l’ange de Gitta Mallasz quand l’ange
va s’exprimer par la bouche d’Hanna et que celle-ci prévient :
« Attention, ce n’est plus moi qui parle ! » (p. 23) ?
[14]Sur ce sujet, j’ai lu en particulier l’article de Vincent Roger,
« Henry Vaughan et la poésie de la méditation
» dans La prière de l’écrivain, sous la dir.
d’Emmanuel Godo, actes du colloque de l’Université de Lille,
Paris, Imago, p. 59-80. Vincent Roger montre comment le poète
anglais applique la méthode ignacienne de la méditation
en trois phases, préparation, méditation, colloque. J’ai
pu y voir des éléments intéressants relatifs
à ma lecture d’Aux arbres penchés.
[15]L’ange apparaît aussi p. 47, un dessin de Xavier en regard…
En parallèle avec le thème de l’ange : voir notamment
Gitta Mallasz, Dialogues avec l’ange, op. cit., Andrei Plesu,
Actualité des anges, Buchet Chastel, 2005, 269 p.
[16]Source : Edward Burnes-Jones, Le livre des fleurs, Taschen, cop.
1994, 95 p.
[17]Paris, La Différence, 2005, 494 p.
[18]François Solesmes, Éloge de l’arbre, Encre marine,
1995, 189 p.
[19]Cf. « Je ne retiens rien des hommes, mais j’épouse les
arbres, dont tu n’es pas jaloux. » « C’était aux
arbres qu’allait ma préférence, aux arbres qui te
ressemblent, dont mes deux bras faisaient le tour », (Mireille
Sorgue, L’Amant, Albin Michel, Le livre de poche, cop. 1985, p. 110,
59).
[20]Cf. Paule Salomon, « La présence douce », dans
Éric Le Nouvel, Dir., L’art de vivre au présent, Albin
Michel, « Espaces libres », 2001, p. 35. Voir aussi dans le
même ouvrage : « Deviens le coquelicot : présences
réelles, inaccessibles et incarnées : rencontre avec
Jean-Yves Leloup », p. 180-207.
Cécile Guivarch
Nathalie Cousin
Pour Francopolis
Octobre 2006
|