|
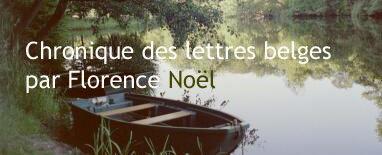
En
toute impunité, de Jacqueline Harpman, 2005, chez
Grasset
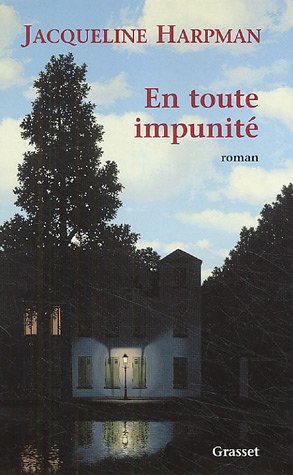
Jacqueline Harpman est une digne dame de la littérature
belge. Née en 1929 à Etterbeek, elle publie par
intermittence depuis 50 ans et écrit certainement depuis
bien plus longtemps. Comme ces confrères et compatriotes
Henri Bauchau et François Emmanuel elle a la particularité
d’exercer en parallèle la profession de psychothérapeute.
Est-ce cela qui confère à ses romans une si juste
analyse des rives et dérives de l’âme humaine
? En tout cas, la fantaisie et une certaine provocation ne désertent
pas le rythme enlevé de ses textes.
Cette fois, l’intrigue ne se mêle d’aucun fantastique,
d’aucune irréalité, pas de femme changée
en homme (Orlanda), pas d'êtres éternels suivant
d'un oeil intéressé nos vies brèves (le passage
des éphémères), .... Sinon cette atmosphère
évoquant de manière persistante un film de Chabrol.
On ne peut à priori faire plus terre à terre car
l’héroïne principale en est une maison. Pas
n’importe laquelle, une maison parfaite même dans
sa déchéance, une demeure noble par essence et qui
même dépouillée jusqu’à l’os
envoûte et séduit ses propriétaires exclusivement
féminines au-delà de toute raison. Six femmes vivent
dans l’unique but de la faire survivre, de la sauver de
la ruine. Six femmes sur trois générations, qui
lui consacrent tout depuis toujours, qui se donnent chacune à
sa manière pour sa gloire presque éteinte.
La demeure se meurt, les femmes s’étiolent et un
témoin, le narrateur, architecte hébergé
brièvement arrive juste au moment où la passion
sacrificielle bascule dans l’intrigue calculée.
Le récit du
narrateur commence
comme une exploration sociologique tour à tour étonnée,
amusée, naïve puis enchantée dans cette famille
hors du commun. Le verbe est vif mais strictement châtié,
la complicité immanente, les scènes quotidiennes
et pourtant extraordinaires d’une tribut familiale à
la morale opportune boosté à l’énergie
du désespoir. Autarcique, célibataire mais féconde,
économe et inventive, fière mais sans scrupule,
la famille La Diguière impose sa règle comme une
évidence et pousse chacun de ses membres à œuvrer
pour la Passion commune. Ainsi l’aînée, Madame
La Diguière cherchera-t-elle l’ultime solution à
leur indigence dans un mariage d’argent sous les conseils
cyniques mais désarmants de ses filles et petites filles.
Car il faut tout faire pour que la maison survive à l’hiver,
réparer le toit est un minimum mais la somme, pour refaire
à l’identique, demande de trouver d’autres
revenus. On se laisse prendre, comme le témoin de ces scènes,
au jeu spontané et impudique. Choqués, puis pardonnant,
séduit par la franchise des moyens qui justifient une fin
presque honorable. Mais le récit évolue, un second
volet s’ouvre et le nœud se resserre, les consciences
s’opacifient, la manière devient plus sournoise et
la frontière entre le désir et l’acte se franchit
sans état d’âme, en toute impunité.
Humour, de plus en plus noir, légèreté grave
et gravité des petits riens, le détail et la rigueur
dans l’écriture subjective du narrateur nous entraînent,
insatiables, à évorer l’histoire. Narrateur
qui, poussé par sa curiosité, deviendra détenteur
d’une vérité étouffante, dont les ombres
malsaines viennent nous hanter longtemps après avoir refermé
le livre.
Jacqueline Harpman semble approfondir dans ce roman une piste
annexe lancée dans son précédent texte, «
Le passage des éphémères » : le sentiment
fou amoureux envers une maison. La personnalité de la demeure,
cette force presque incarnée qu’elle a de nous faire
nous dépasser, nous sublimer pour être à son
service. Et c’est peut-être dans ce sulfureux matérialisme
esthétique que le roman exhale sa plus grande immoralité.
avril
2005, Florence Noël |