|
Le
lait amer de la mort
à propos de Sans titre de solitude de
Corinne Cornec-Orieska,
Poiêtês, 2005.
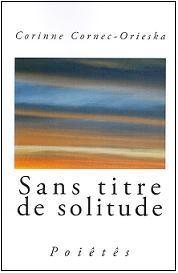 J’ai
sur les lecteurs qui vont avoir l’immense plaisir de
découvrir « Sans titre de solitude
» un avantage certain : je connais son
auteur. Ou plutôt j’en connais certaines parcelles
car – et je le déplore – je n’ai
jamais rencontré Corinne Cornec-Orieska autrement que
par le truchement virtuel que constitue notre petite communauté
de l’Aurore
Poétique. Mais après tout, même lorsque
que nous croyons les connaître parfaitement, les êtres
ne se dévoilent-ils jamais autrement que par lambeaux,
par bribes qu’ils nous laissent, au gré de leur
envie, voir, toucher ou sentir ? J’ai
sur les lecteurs qui vont avoir l’immense plaisir de
découvrir « Sans titre de solitude
» un avantage certain : je connais son
auteur. Ou plutôt j’en connais certaines parcelles
car – et je le déplore – je n’ai
jamais rencontré Corinne Cornec-Orieska autrement que
par le truchement virtuel que constitue notre petite communauté
de l’Aurore
Poétique. Mais après tout, même lorsque
que nous croyons les connaître parfaitement, les êtres
ne se dévoilent-ils jamais autrement que par lambeaux,
par bribes qu’ils nous laissent, au gré de leur
envie, voir, toucher ou sentir ?
Il en va de même, et sans doute encore
plus, pour les poètes qui aiment souvent se dissimuler
derrière le mystère de la langue, changer de
masque, de peau, de lieu de naissance dans le geste très
secret d’écrire. Je me suis toujours demandé
pourquoi il était si important de connaître la
biographie des auteurs pour mieux lire et comprendre leur
œuvre. Peut-être que tout simplement est scellée
dans la vie et le ressenti de chaque poète une part
de l’énigme poétique. Ceci justifie pleinement
le projet d’écrire des biographies d’auteur
mais n’est pas, à mon sens, entièrement
satisfaisant pour la compréhension d’une poésie.
Car demeure ce que j’ignore – ce que vous ignorez
– de Corinne, ce que, pour combler cette ignorance,
nous apportons de nous-mêmes dans la lecture-interprétation
des poèmes qu’elle nous offre. Ceci constitue
l’autre part de l’énigme, peut-être
la plus obscure, la plus complexe, celle qui nous relie tous
dans le geste démultiplié de lire de la poésie.
Il y a donc ce que je sais de Corinne : jeune
femme d’une trentaine d’années, française
mais de père slovaque et de mère allemande,
infirmière, passionnée par les chevaux, peintre
et photographe à ses moments perdus, poétesse
autodidacte. Elle a publié en juin 2005 ce premier
recueil dans la jeune maison d’édition de Laurent
Fels, Poiêtês, et les amateurs de poésie
francophone et contemporaine ont pu la croiser dans plusieurs
revues papier ou électronique (Alter Texto, L’Ascaris,
An Amzer, Francopolis, Les Cahiers de Poésie…
). Ceci est le portrait presque officiel de Corinne, celui
des quatrièmes de couverture, mais il ne dit pas tout,
il ne peut pas tout dire : il ne dit pas le drame, le deuil,
la perte d’un être cher, l’insondable souffrance.
Il ne dit pas ce qui fait la vie, la sienne, la notre, et
tisse toute sa poésie, telle qu’elle l’écrit,
telle que nous la recevons. Si la poésie de Corinne
parle en nous avec tellement de force c’est qu’elle
évoque notre commun malheur, l’horizon ultime
de notre condition. Ceci nous le comprenons tous et n’avons
pas besoin de biographies ou d’explications de texte,
seulement de retrouver l’enfant en nous et la peur ancestrale
: peur de perdre ceux que nous aimons, peur de la maladie,
peur de la solitude…
La mort – cette « mère…
au lait salé » (Amère, p. 47) –
est bien le thème majeur de « Sans titre
de solitude ». Il faut noter d’emblée
que le ton n’est ni morbide ni mortifère, la
mort nous féconde, nous fait grandir, nous enseigne
mais son lait a un goût particulièrement amer…
Ce thème principal se décline toutefois en deux
temps, au travers des deux parties qui composent le recueil.
Dans la première, intitulée « les
soleils s’endorment seuls », l’expérience
de la mort paraît toute extérieure, comme une
prophétie annoncée mais non encore advenue.
Elle n’engage pas entièrement l’être
intérieur dans la violence des déchirements
intimes. Il s’agit d’abord de la mort qui frappe
les autres dans un univers que Corinne connaît bien,
celui de l’hôpital. Elle en visite ainsi les lieux
froids et aseptisés, les chambres aussi blanches que
stériles (Pluie bleue, p.49), les lits qui ne sont
pas les nôtres (Ta petite robe à fleurs, p.36),
les tiroirs des morgues (Cavité virtuelle, p.14), elle
nous montre ce que c’est que « mourir à
l’hôpital » (Un petit coin à
soi, p.32) dans le froid, seul. Et on ne peut s’empêcher
d’imaginer Corinne au chevet de ses patients, livrant
une multitude de minuscules combats contre l’inéluctable,
tenant une main, caressant des cheveux, prononçant
des mots qui valent plus que mille mots parce que ce sont
les derniers et que personne d’autre ne les prononcera…
Voilà que la part biographique resurgit – infirmière
! – pour nous expliquer cette connaissance du monde
hospitalier, l’utilisation de ces mots tellement peu
poétiques a priori (narcose, ictère, cyanose,
érythème, intubation, bradycardie, analgésie,
etc.) qui ponctuent cette première partie mais disent
tellement bien la promesse de notre finitude et des douleurs
à venir. On ressent aussi à lire ces poèmes
toute la force que requiert cet accompagnement vers l’ultime,
le courage qu’il faut pour se tenir droit devant les
êtres qui s’amenuisent (« L’homme
est devenu si petit qu’il a disparu », Demain
ne vient jamais, p.66). On comprend la nécessité
pour celui qui a vécu tout cela de trouver un espace
où poser ce si lourd bagage, là tout au creux
de la page blanche…
Et puis, le décor change dans la seconde
partie, « Vide bleu », il devient un
espace beaucoup plus intérieur, borné par la
présence – l’absence ? – d’un
« toi » auquel s’adresse un « moi
» en proie à l’incommensurable douleur
de la perte. C'est que brutalement la prophétie s’est
réalisée, la mort a frappé au plus proche,
dévastant le monde, ancrant la solitude. Ici les objets
sont trop connus, familiers – « le cuir odorant
de tes sandales » (D’un rien vers le jour,
p.65), « le petit banc de bois bleu »
(Entre la vie, p.82), « ce bouton ocre et mauve
» (Question de style, p.113). Plus question du
blanc hospitalier, il y a des couleurs, des odeurs : celles
de la vie qui s’enfuit, celles des souvenirs qui affluent.
La poésie trouve alors la porte par laquelle établir
l’essentiel dialogue entre ce qui est – vide,
douleur, silence, lutte contre l’oubli – et ce
qui fut – l’amour, les rires, les caresses, les
jeux…
|
« Des lointaines prairies où tes yeux bleuissent
je me souviens de l’herbe
arrondie sous le vent
De tes lèvres
à tes mots
l’horizon s’efface et n’a qu’une
empreinte
celle de ton rire
pendu au cintre du monde
Sur ta peau
La clef d’un rêve »
(Le bleu du vide, p.81)
|
La poésie de Corinne devient alors ce dialogue dans
l’épaisseur de la solitude où se rétracte
la vie même, comme par réflexe, cette parole
échangée entre « toi » et «
moi », entre l’absent et le présent, entre
tous les absents et tous les présents, entre finalement
soi et soi. Parce qu’il faut bien continuer et conjurer
« ce terrible silence » (Sans titre de
solitude, p.63). Parce qu’il nous faut grandir et boire
jusqu’à la lie le lait amer de la mort.
Certains poètes proclament haut et
fort leur solitude, leur misanthropie, leur dédain
du monde et des autres ; ils en exhibent fièrement
les titres, comme autant de quartiers de noblesse, et se drapent
dans l’orgueil des solitaires ou des incompris. Rien
de tel avec la poésie de Corinne. Sa solitude à
elle ne revendique rien, ni titre, ni récompense. Elle
a frappé un jour comme un coup de poignard dans le
cœur, ouvrant une brèche par laquelle s’écoule
désormais une parole autrement plus vivante que beaucoup
de celle de ses contemporains. « Pleurer ne suffit
pas » nous dit-elle, non il faut écrire
aussi, il faut prolonger le dialogue coûte que coûte,
et rire même de la mort :
|
« Estomper le vide
contre le monde et
rire de soi
ironie du mort
regarder les choses fondre
entre soi et soi »
(Ecrire, p.20).
|
Vous pouvez vous procurez Sans titre de solitude en commande
sur le site des éditions Poiêtês.
Par Xavier Jardin
pour francopolis
Mail 2006
|