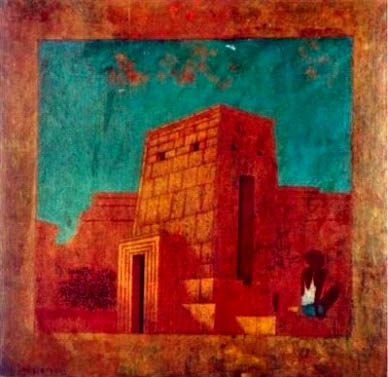Nous
avons planté nos tentes aux portes de l’Europe.
Nous la convoitons et
nous la méprisons.
Nous lui donnerons
l’assaut.
Les noces avec
l’Occident

François Augiéras à 20 ans
Nuit
du solstice de juin 1943, magnétique et chaude. Rejoignons
François Augiéras, dont le nom signifie « Noble
lance », au château périgourdin de sa tante
Germaine, à Val-d’Atur.
Avant
d’atteindre ses dix-huit ans, il a lancé sa première
offensive contre la Civilisation matérielle. Il vient de
traverser une violente crise mystique. Affolée, sa pauvre
mère le conduisit à deux doigts de l’internement, car il
délirait, prétendant que Dieu et l’Amour avaient
élu domicile en lui. Comme Dieu irradiait partout, il pouvait
donc le faire pénétrer chez autrui. Il sacralise
déjà tout ce qui l’entoure. «Sauvage est la
proximité du sacré» pourrait-il dire, comme
Friedrich Hölderlin. Les lignes d’une excessive séduction
qu’il envoie à son ami Georges Croses sont presque dignes d’un
démiurge.
«
Certains jours Dieu est comme dilué en moi et
ceux qui m'aiment à ces moments là, c'est un peu comme
s'ils aimaient Dieu.
Si l'on m'aime
c'est que ma vie est pleine d'intensité et par son
intensité pose et résout tous les problèmes.
Je vis, je ne fais
que vivre et raconter ma vie.
Avoir de
l'affection pour moi c'est un peu m'imiter. Vous avez entendu,
m'imiter, donc être de mes disciples. » (Lettre
à Georges Croses. 24 Décembre 1943. Collection
privée.)
C’est à cette
période qu’il écrit, dans Les noces avec l’Occident
:
« Celui que
j’aimais se faisait identique à moi-même et
pénétrait mon cœur… Il n’est de réel que l’esprit,
et l’amour de l’esprit m’a seul enivré... Là fut ton
existence unique, entre les seuils éternels de la nuit. »
Dans certains passages
de ses premières proses, la certitude de ses pouvoirs
frôle la folie. Parmi un groupe d’enfants idiots et tarés,
l’un d’eux, qu’on lui désigne, suscite sa compassion.
«
Ses yeux divergeaient atrocement. Il prit entre ses
mains le crâne tondu de l’enfant, ses deux pouces
écrasèrent les globes des yeux, et il les lui remit
définitivement en place. »
La fin de l’hiver
glacial atténue son prosélytisme, et lui rend le
goût de l’orgie des sens. Il fuit sa mère
déjà veuve, avant sa naissance en Amérique. Comme
elle lui suggère de collaborer avec les Allemands, en donnant
des conférences, il la traitera dans ses Mémoires
de sale Polonaise.
« Je ne sais
pas d’où elle sort, de quel Danube crasseux (…) Elle est
besogneuse, idiote, inhumaine, sans affection pour moi, sans
attachement pour personne, et finalement dangereuse comme la peste
à force de nullité. »
Sa
tante lui a attribué une chambrette isolée dans l’une des
deux tours, sous les combles.
Cette nuit du
solstice, passée en solitaire dans les bois, il a, comme
toujours, atteint une jouissance qui l’a laissé abasourdi : il
en a perdu jusqu’à la certitude élémentaire de sa
propre existence. Cette jouissance, il a appris comment la provoquer
physiquement, après avoir volé avec un engin de son
invention, au-dessus des grands prés du domaine familial.
Au
comble de
l’exaltation, le jeune homme termine, puis recopie une suite de proses
poétiques, à la lueur vacillante d’une coupe de bronze.
Il l’alimente avec des morceaux de bougies.
L’urgence
d’écrire le taraude depuis longtemps. Il éprouve le
besoin de tenir une sorte de journal de bord, pour démêler
l’absurde écheveau de sa vie, et lui donner un sens, avec de
petits éclats d’éternité. Lecteur avide, il a
découvert très tôt ses éclaireurs. Tout se
passe comme si, à ses débuts, il avait entendu la parole
de Gide à propos du Classicisme qui, on le sait, « tend
tout entier dans la litote. C'est l'art d'exprimer le plus en disant le
moins. C'est un art de pudeur et de modestie. » (Incidences) Le
choc de la rencontre d’Augiéras avec son oncle astronome,
fin 1947, ne modifiera pas son style. Chagrin cosmique. Il transmutera,
à peine transposés, humiliations et coups
reçus dans le désert en œuvre d’art : Le Vieillard et
l’Enfant.
 Spirale de la
nébuleuse de l'Aigle (Télescope Hubble)
Spirale de la
nébuleuse de l'Aigle (Télescope Hubble)
En
juillet de cette année-là, il envoya son œuvre onirique
en lettre recommandée à sa revue
préférée, Les Cahiers du Sud, à
Marseille.
Ses futures Mémoires préciseront cette date.
Il
s’agit de la
version initiale des Noces avec l’Occident, premier chant
passionné de ce
«fou divin», dédié
à l’univers. Cet aventurier de l’esprit, drogué de
lumière astrale, a entre seize et dix-sept ans lorsqu’il compose
cette suite flamboyante - l’âge de Rimbaud auquel il fut souvent
comparé, par la suite. Dans ses Mémoires, il nous
conte
comment, à cause d’elle, il fut renvoyé de nuit par le
chanoine dont il travaillait les terres.
«
Je suis
incapable de "vivre avec les autres", je ne sais quoi leur dire ; je
suis gai, d’une gaieté solitaire. »
Lorsqu’il
revient de
ses équipées nocturnes, ébloui par les cieux, il
traverse le salon sans se cogner au piano, ni renverser les saints de
faïence. Puis il grimpe les escaliers à l’aveuglette.
C’est le
tournant de son existence, car il a découvert sa
vocation : sans plus attendre, il faut fixer par des termes la
lumière surgie des choses, avant qu'elle ne disparaisse de
l'espace.
« Dès
les premiers mots qui viennent sous ma plume, je
me rends compte que mon avance passe par un système de formes :
les blés et l’azur, les bois et les astres. »
Il est persuadé
qu’alors, grâce à ses traces, dans
peu de temps, d’autres hommes iront du même côté que
moi, retrouveront le ciel et me ressembleront.
Rentrant
dans l’obscurité à quatre heures du matin,
grisé par l’odeur des moissons, l’adorateur des étoiles
réveille le chanoine. Intrigué, celui-ci frappe à
la porte de la chambre dont la lumière est restée
allumée. Il doit penser qu’il n’est pas très catholique,
le seul employé qu’il n’a pu mettre au pas.
Des feuillets noircis
par une belle écriture appliquée
jonchent le plancher. Ils parlent d’eux-mêmes. Le discours
halluciné de François, la plume à la main,
épouvante l’abbé. Il n’est question que des astres et de
la métamorphose de l’homme en Dieu, que le malheureux voit. Il
est missionné, affirme-t-il.
« -Vous
écrivez ! Et quoi donc, je voudrais le savoir ?
»
Avant de partir
à l’aube, à travers champs,
l’écrivain en herbe traité d’ « illuminé
» nous éclaire :
« Je lui
explique que je sors souvent la nuit pour regarder
les astres, qu’une mutation de l’homme me semble très probable,
que je veux aller vers l’avenir, que c’est le récit de mes
courses nocturnes. »
De
ce manuscrit ne subsiste qu’une enveloppe vide
expédiée par « M. Augiéras Kacsinski
François, Val-d’Atur, Dordogne ». Il s’agit de
l’unique
fois où l’auteur associa ses deux noms.
Il
décrit de petites scènes agrestes ou inavouables, dont le
style touche à l’universel. Les bois, les choses, les
êtres qui s’étreignent derrière un bal
champêtre sont d’une évidence et d’une
immédiateté insolites.
Dans Les noces,
la
chrysalide se libère, ambivalente et révolutionnaire,
pour l’époque. La double nature de l’auteur éclate
à chaque instant : androgynie, dualité du nom, ange et
démon, amour et cruauté, candeur et cynisme. Pages plus
éclairantes, à ce sujet, que les Mémoires.
« L'homme
est une corde tendue entre l'animal et le Surhomme, une corde au-dessus
d'un abîme », écrivait Nietzsche, dans Ainsi
parlait Zarathoustra.
Des
phrases simples. Le ton est parfait, définitif, d’une gaucherie
voulue. Parfois, l’identité fluide de l’auteur glisse, d’une
page à l’autre, entre celle d’un petit enfant et celle d’un
garçon trop tôt mûri. Il est tour à tour
innocent moissonneur sous la lune ; saltimbanque ; thaumaturge qui rend
la vue ; enfant qui cherche un père ; client de maison
close ; ennemi nu, debout, au bord de l’Orient.
Vingt
ans après, songeant à ce manuscrit perdu, il
décrète dans ses Mémoires, avec une
sûreté souveraine : « Cela sera retrouvé,
plus tard. »
Sa vie
durant, il dispersera ses écrits en tous sens, persuadé
que c’est l’unique moyen de ne pas les perdre. Un double du texte
égaré émergea dans un coin reculé des
collines d’Aquitaine, chez le peintre Marcel Loth, dix ans après
la disparition de l’auteur. En 1981, cet ami de jeunesse en publia
soixante et un exemplaires dans ses Cahiers du Bospicat. Il fut
repris
par les éditions Fata Morgana, la même année.
Il s’agit bien du
même manuscrit.
« J’y parle
de mon attrait pour les astres, les forêts et les blés ;
j’y raconte que je joue de l’accordéon, en dansant devant la
voie Lactée, que j’ai changé de religion. »
(Extrait non retenu pour Une adolescence. Augiéras. Une
trajectoire rimbaldienne. Ed. Au Signe de la licorne, 1996.)
Les
noces avec l’Occident décrivant l’aura en flammes du
colonel, futur père mythique de François, constituent un
puissant appel de magicien.
En
1950, dans une
dédicace à Marcel Loth, à la première page
du manuscrit, l’auteur posa superbement les bases de ce qui deviendra
son mythe fondateur : l’invention d’une civilisation nouvelle, en
relation avec les astres.
« Ah, la
noblesse de l’esprit, je laisse cela à mes cochons d’amis.
Moi, j’invente
des coutumes ! »
Puis il
oubliera ces pages, dans lesquelles il fait revivre ses années
d’apprentissage, à peine transposées : la tournée
du théâtre du Berger ; le travail dans le potager du
chanoine ; la garde des jeunes délinquants, au château de
Marsac. Au milieu des années soixante, il reprend d’ailleurs
quelques descriptions, de mémoire, dans Une adolescence.
Mais
celles-ci comportent moins de détails.
Les
courtes évocations des Noces font revivre
comédiens et
filles de joie, trafiquants de farine dans un grenier, marchands
ambulants, résistants et paysannes, orphelins perdus dans une
France ressemblant à une fourmilière
dévastée.
Elles ne font pas
allusion à la rencontre avec son parent astrologue, pourtant
décisive, après la fin de la tournée des
marionnettistes.
Avant de
confier ce document à Marcel Loth, Augiéras n’y ajouta,
apparemment, que peu de passages. Le lecteur pressé remarquera
peut-être le titre du premier chapitre, Et le soldat se souvint.
En
regard à la
Préface, située à Aubusson, un bref
épisode, en guise de Postface, nous transporte près de
Sète, en 1950. Intitulé L’autre rive de l’Occident,
il
dut être rédigé lorsque l’auteur avait vingt-cinq
ans. Il relate sobrement une relation nocturne entre deux adolescents,
l’un au bord de l’autre, sur une plage déserte.
« Le lendemain, ils ne s’en allèrent pas, et
après avoir mangé, ils dormirent encore jusqu’à la
nuit, sur cette autre rive d’Occident.
Et avec un Dieu l’Occident avait connu ses noces pour mille ans.
»
Il
est possible que François ait recopié une partie des
poèmes, sans trop les modifier, en 1950. Le laps de temps dont
il disposait, à la charnière de son destin, foisonnait de
tant de projets ! La page relative au vieillard, auprès duquel
il dort, appartient sans doute à la première version.
(« Alors l’adolescent parut dans le sommeil du vieil homme,
qui
le vit lumineux et entouré de flammes jusqu’à l’heure
où vint le jour. »)
Ce n’est pas le cas de
l’Hymne à l’Amour inspirée par Abd
Allah, Le Seigneur de Dieu nommé en toutes lettres,
après
une allusion au passé :
(« L’amour
dans les bois, dans les camps de travail de ce
siècle. »)
………………………………….
«
L’amour est un chant de guerre.
l’amour
oppresse la poitrine
l’amour se
moque de la mort.
D’où
me viennent mes pensées
si ce n’est
de tous…
Que suis-je
d’autre que mes pensées ?
Abd Allah, je
sais d’où tu viens ;
tu es beau
lorsque tu parais au soleil levant.
Je n’ai
d’autres dieux que mon frère Abd Allah.
Si je ne
chantais pas, je mourrais. »
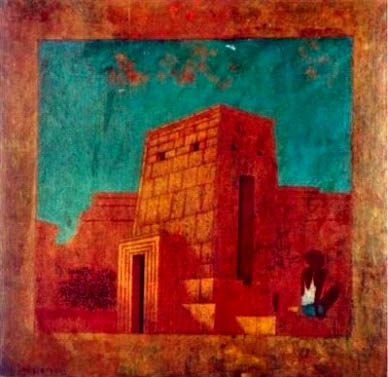 Temple. Huile de
François Augiéras
Temple. Huile de
François Augiéras
Ainsi, les lieux et les temps s’entrelacent, comme par magie.
« Trop de meurtres l’avaient entouré… ll hait
férocement et sans raison. »
Nous
voici loin des images d’Épinal des Mémoires. C’est la
plume d’un homme qui a connu la brûlure du fouet.
D’après
son ami
et biographe Paul Placet, Augiéras ne fit jamais allusion aux Noces,
après 1950, et il ne chercha plus
à les publier.
Peu lui importe leur devenir. «J’écris pour Dieu»,
dira-t-il souvent. Il ne croit pas au Dieu des abrahamistes. Il aime
son ‘âme éternelle’, Dieu qui est, l’étincelle
divine qui habite le cœur de tout homme, même le pire criminel,
et qui ne demande qu’à s’embraser.
Le 16
mai 1946, il
écrivit à Pierre Fanlac pour lui soumettre une
ébauche de manuscrit. Il prit son temps. Il faut attendre 1947
pour que soit signé avec le jeune éditeur de
Périgueux le premier contrat pour un fascicule artisanal. Il
verra le jour fin 1949. Le vieillard et l’enfant, signé
Abdallah
Chaanba, est prétendument imprimé en Belgique, à
225 exemplaires numérotés. (La lettre "n" du
pseudonyme
est sans doute une coquille.)
A
l’instar de Salah Stétié, j’ai une secrète
préférence pour ces débuts littéraires
méconnus, frémissants de sève. On devine
l’éclosion d’une résonance poétique, grisante,
avec l’univers ; Augiéras aiguise sa plume à la lueur des
mots.
Pour
sa publication,
Bruno Roy inséra au début du petit livre un bref extrait
d’Une adolescence, que l’auteur date d’octobre 1949 - en fait d’octobre
1948 : « Je rentre en France. Je suis éreinté
par
la vie infernale que j’ai connue cet été chez mon oncle…
Il y a un terrible sourire sur mes lèvres, inquiétant,
sauvage, heureux… »
Le
second
séjour d’Augiéras chez le colonel ressembla en effet au
barbare corps à corps de deux labyrinthes.
Suivent
quelques
lignes de l’éditeur pour préciser que le livre fut
rédigé presque sans ratures en 1950. C’est-à dire
entre le retour du troisième séjour d’Augiéras
à El Goléa et son départ pour la Sicile, où
il rejoignit André Gide. Mais il dérive en partie de L’Histoire
d'un homme, destiné à
devenir L’Histoire d’un
dieu, antérieur aux premières versions du Vieillard
et
l’Enfant - où l’on remarquera l’inversion des termes «
oncle » et « père
». II s’agit toujours
d’épisodes lapidaires, juxtaposés. De même, dans
les tableaux du peintre, quelques silhouettes de personnages ou
d’animaux se répètent.
L’écriture
de L’Histoire d’un dieu remonterait au second
séjour
d’Augiéras à El Goléa, en 1948. Les amours
d’Abdallah le Chaamba à Ghardaïa sont de la même
époque. Avec Le vieillard tué secrètement au bord
du monde, le sort du colonel est réglé symboliquement, de
manière œdipienne, et son corps profané. Après ce
dernier fragment de mosaïque, Augiéras est prêt
à rédiger Le Vieillard et l’Enfant, de 270 pages.
On
jurerait que le sable est devenu encre, et que le jeune écrivain
veut épuiser toute cette encre du désert.
Augiéras
avait coutume de remanier ses pages, glissant volontiers d’un manuscrit
à l’autre. Fréquemment, les descriptions qu’il
préfère, dans son journal de bord, figurent de
mémoire, avec des variantes, dans les lettres adressées
à ses correspondants.
Les
Noces ambiguës furent habilement retouchées ; le
procédé, bien dans le style d’Augiéras, est
destiné à demeurer occulte, comme le seront les fresques
du blockhaus, la seconde descente à la grotte de Lascaux ou
notre relation. L’auteur a la pudeur de ses sentiments.
«
C’était
un esprit farceur, une âme légère, inventive
à l’extrême, la nuit, parcourant la ville à
l’affût de quelque sottise. »
Tous
les feuillets des
Noces sont véridiques, puisque François Augiéras
n’invente jamais rien. Les scènes d’amour démentent donc
la légende de sa virginité tardive, qu’il revendique dans
ses Mémoires.
Dans
le chapitre El
Goléa du Voyage des Morts, à propos du colonel, en 1947,
il confie: « J’ai assez couché avec tout le monde pour
connaître la douceur, malgré tout, des hommes. »
Il
est vrai que ceci fut écrit tardivement.
L’embryon
des Noces
ignore encore l’encre noire du malheur. Poèmes en nage, pages en
sueur des scènes prises sur le vif. L’audace est à couper
le souffle, pour l’époque, avec son art consommé du
frôlement. L’intelligence de la chair saisit autant que la
sobriété de l’expression. Désir incarnat.
Étreintes dont l’intensité fait défaillir, contre
un tronc d’arbre… joie tactile avec une campagnarde ou un pâtre…
senteurs de résine… voluptés abruptes au goût
d’éternité, « sous les premières
étoiles semblables à des grains de maïs ».
En
1943, le jeune
homme a découvert que l’ancienne maladrerie, surnommée La
Maison des Anglais, est un mauvais lieu bien caché. Il la
décrit avec exactitude, avec sa curieuse tour, dans Les
noces
avec l’Occident. Les cartes postales d’époque en restituent
tous
les détails. Cette demeure du XIIème siècle
servait autrefois de foyer pour les malades, les pèlerins et les
sans-abris. Elle fut achetée quarante mille euros par la ville
de Périgueux, en 2011, afin d’être restaurée.
François
y
accède en barque, puis par un escalier extérieur.
« Il
retrouva
quelques jeunes hommes soupant ici en compagnie de filles que toute la
ville connaissait.
…Un feu de
sapins brûlait dans une cheminée aux revêtements de
faïence.
Une fille d’une grande
beauté : de petite taille, très jeune, les lèvres
peintes de vermillon, avec une tête ronde d’enfant qu’encadrait
une longue chevelure noire.
…Ouvrant sur le monde
des yeux admirables et respectueux des institutions, elle avait vu sans
étonnement défiler dans son lit plusieurs garnisons, tant
françaises qu’étrangères.
…Cette ville
en aval
de laquelle on soupa, cette nuit-là, fut son perpétuel
amour. »
Augiéras
offre
son corps à qui lui plait, quand cela lui plait, et il
possède qui le désire. Filles et garçons font de
même ; ils se prennent et se déprennent avec une
surprenante aisance. La disponibilité des êtres est celle
d’un Age d’or.
«
Ils
s’éprirent les uns des autres à cause de l’odeur et de la
sueur de leurs poitrines et de l’étonnement qu’ils eurent de la
beauté de leurs corps. »
Ils semblent nous
signifier que nous sommes un seul être multiple, parent des
bêtes, des pierres et des eaux.
Les
aveux interpellent.
« Cet
adolescent
était d’une grande beauté, ignorant les scrupules… Trop
d’années passées dans des fermes… Les vices des
garçons d’étable révèleraient toujours son
passé, son âme cruelle et tendre. »
Dans
« La course
dans les blés », toute une nuit, « le bel
adolescent
volait au-dessus des tiges », à la poursuite d’une
jeune
paysanne qui l’a insulté, après un bal.
«
Ils se
touchèrent, l’un et l’autre tombèrent sur les pailles et
les épis qu’ils brisèrent. Et il la prit sous lui et
s’enfonça dans la chair rouge de la petite. Pour s’enfuir
ensuite dans la brousse blonde. »
Nous
voici
déconcertés : en dépit de la part de jeu, il
s’agit quasiment d’un viol.
Les lecteurs du Vieillard
et l’Enfant reconnaîtront, dans les
deux derniers mots,
le début du roman autobiographique.
« J’ai vu un
lieu étrange dans le désert, une brousse blonde. »
Ces termes ne peuvent
dater de 1943.
Quand
décrivit-il les jeunes gens défaillant de plaisir, sous
l’édifice des étoiles qui flambent ?
« Ils
crurent
rouler entre les astres incandescents au plus noir du ciel, dans la
nuit criblée de soleils tournant à une vitesse
prodigieuse. Eux mêmes, changés en flammes, se
traversaient dans leur course sans se briser, (…) transfigurés
de joie, éternels musiciens et danseurs. »
Prémonitions,
à propos du choc de la rencontre avec le père mythique de
l’auteur, obsédé comme lui par l’immensité
céleste ? Ces lignes sont peut-être postérieures
à son arrivée dans le désert.
Tous
les thèmes
d’Augiéras sont déjà là. Jusqu’à
celui, emblématique, des grottes. Et jusqu’aux gendarmes qui
l’appréhendent, pour des vêtements volés. Ils
recommenceront si souvent, jusqu’à la fin de sa vie... « Coupable
de rien, suspect de tout. » avait
coûtume de dire
le nomade.
Il est
probable
qu’Augiéras a modifié son texte, entre 1948 et 1950. Seul
un contemplatif de son espèce est capable d’une telle agression
contre l’hypocrisie de la société.
L’énigme
demeure. Noces aussi mystérieuses que la brusque irradiation de
l’amour dans les ténèbres. Si le récit de
l’adolescence, dans les Mémoires, est plus pudique que Les
noces, c’est peut-être à cause de sa jeune
épouse
d’alors : au milieu des années 60, Viviane et son entourage
avaient violemment rejeté L’apprenti sorcier, trop
scabreux.
Les Noces nous
contraignent à une double lecture des années de jeunesse.
À la manière des étoiles dans le ciel, l’esprit
farceur
s’est-il amusé à cacher là une sorte de
rébus ?
L’astrologue
avait
prédit des ennemis. Chez Augiéras, c’est
congénital. Ce Slave à demi orphelin étant
différent, comme les Roms, il suscite l’hostilité. Les
autres volent en bande, comme les corbeaux. Lui, jamais. Il n’aspire
qu’à s’élever dans le ciel. Cet écorché a
dû terriblement souffrir pour que, dès la Préface
des Noces surgissent des termes inquiétants. On pourrait
multiplier les exemples.
«
Même par
la haine je suis entré dans votre âme et nous voici
prisonniers les uns des autres.
L’ennemi venu des
plaines d’Asie.
…Après qu’il
eut chanté longtemps, tous s’en allèrent se sachant son
ennemi pour la vie.
…Il songea
aux hommes
qui le trahissaient sans raison, comme autrefois ils l’avaient
aimé. »
Les
furtives scènes des Noces sont des sortes
d’instantanés,
reflets de la réalité pendant l’Occupation. Volontiers
scandaleuses, elles sont décrites avec une justesse et une
liberté que seul un jeune affranchi pouvait se permettre, alors.
Elles font penser parfois aux scènes de maisons closes de
certains monotypes de Degas, trop délicates, dans leur aveuglant
réalisme, pour être pornographiques. Les escarbilles
foisonnent, jaillies d’un brasier originel. Chacune semble recueillir
en elle tout le feu de la parole.
Dans
la revue Europe,
en 2006, Dominique Fernandez souligna le fait que les œuvres
d’Augiéras datent d’avant la libération des mœurs.
« Pareille témérité dans l’affirmation
de la
légitimité du bonheur physique, on ne l’avait vue qu’une
seule fois dans la littérature française : c’était
en 1953, quand Pierre Herbart fit paraître L’Âge d’Or.»
(Une aristocratie morale. Europe, 2006.)
Rédigées
en partie pendant la guerre, ces pages n’évoquent pas la peur,
la misère, la famine. Le thème de la faim, présent
dans les Mémoires concernant cette période,
n’apparait pas dans Les noces. Le vin et l’eau de vie abondent.
Sur le
chemin des vagabonds, il y aura toujours une ferme abandonnée,
une boulangère accorte ou une noce champêtre.
Fantasmagorie
et
vécu s’épousent. Atmosphère propice aux
rencontres, hors du temps. On soupe dans des terrains vagues, dans des
prés ou dans des baraquements d’un jour. Chaque soir, les
municipalités offrent des banquets qui s’éternisent. La
vie est une fête.
L’année
précédant la parution du Vieillard et l’Enfant,
aux
éditions de Minuit, Yves Bonnefoy salua Un Musée au
Sahara du jeune inconnu dans Les lettres nouvelles.
C’était en
septembre 1953 : « Pages assez souvent admirables,
évocation directe, pauvre, nullement (ou parfaitement)
littéraire, de l’essentiel. Rien n’est ici un ornement, rien ne
séduit ou voudrait séduire, tout signifie. Il y a, dans
ce Musée, un respect de la dignité des choses, cette
pensée sans détours, cette grave simplicité qui
est la vraie poésie.»
Abdallah
n’est
peut-être pas encore né, mais François a
trouvé son style.
« C’était
une algérienne. De même que dans ce vieux bordel, il y
avait en elle de la richesse et quelque chose de pauvre. »
Avec les faciles
plaisirs des sens, pendant l’Occupation, nous voici fort
éloignés des méditations du futur yogi tantrique
de la grotte de Domme… Étant passé maître dans la
science du souffle, Augiéras y pratiquera l’union avec son
invisible compagne, sublimée, pour atteindre l’interminable
jouissance océanique.
La clameur de la
guerre s’étend. On se tue dans les rues et dans les bois. Dans
les campagnes reculées se cachent des munitions et des camps de
maquisards. La Résistance est si farouche que les envahisseurs
nomment cette région «petite Russie». Le
chaos
règne partout. Une nuit, un homme est abattu et enseveli sous un
arbre de la propriété. Lorsqu’il est
déterré pour être inhumé dignement, on
trouve un corps brûlé vif, atrocement mutilé.
«
Fini le temps
de l’insouciance ! » s’écrie soudain Augiéras.
Il
ne songe qu’à être mobilisé en Afrique. Ses
rêves lui répètent : «Le désert est
propre, le désert est pur.»
Pendant
trois ans, il sera obsédé par son oncle paternel,
père qui pourrait le protéger. Marin en permission,
à Laghouat, le bel animal sera presque sur le point de
l’atteindre. À El Goléa, le mirage d’oasis saharienne se
cristallisera lorsqu’en surgira le colonel Augiéras, à
près de mille kilomètres au Sud d’Alger.
Une
nouvelle
identité attend François, lui qui aime tant les masques
et les métamorphoses. Il va devenir Abdallah, jeune victime aux
lamentations hypnotiques et triomphales.
« Tout grand
art
est un art d’apparition. »
*
Les Noces avec
l’Occident (Editions Fata morgana, 1981) ne furent pas
réimprimées. Plusieurs fascicules du Vieillard et
l’Enfant parurent avant la version des éditions de Minuit,
en
1954. Le Voyage des Morts vit le jour en 1959, à la Nef
de Paris.
BIBLOGRAPHIE SOMMAIRE
-
Le
Vieillard et l'enfant (sous le nom d'Abdallah Chaamba), éditions
de Minuit, 1954 . Précédé de « Zirara
», Minuit, 1985).
- Le Voyage des Morts
(sous le nom d’Abdallah Chaamba, La Nef de Paris, Collection Structure,
1959. Sous celui de François Augiéras : Fata Morgana,
1979. Grasset, « Les Cahiers rouges », 2000).
- L’Apprenti sorcier
(sans nom d’auteur : Julliard, 1964 – sous celui de François
Augiéras : Fata Morgana, 1976. Grasset, « Les Cahiers
rouges », 1995).
- Une adolescence au
temps du maréchal. Récit (Christian Bourgois, 1968
; Fata Morgana, 1980 ; sous le titre voulu par l’auteur, La
Trajectoire, Fata Morgana, 1989 ; sous le titre Une adolescence au
temps du maréchal et de multiples aventures, La
Différence, 2001).
- Un voyage au mont
Athos (Flammarion, 1970, 1988 ; Grasset, « Les Cahiers rouges
» 1996).
-Les
Noces avec l’Occident (Fata Morgana, 1981).
- Domme ou l’Essai
d’Occupation (Fata Morgana, 1982 ; édition intégrale, Le
Rocher, 1990 ; Grasset, « Les Cahiers rouges » 1997).
-
Les
Barbares d’Occident (Fata Morgana, 1990 ; La Différence, «
Minos », 2002).
Lettres à Paul
Placet (Fanlac, 2000).
- Le Diable ermite.
Lettres à Jean Chalon, 1968-1971. (La Différence, 2002).
*
Les
peintures de
François Augiéras furent souvent exposées - entre
autres, en 2000, à la Mairie du 6°, à Paris, et au
Festival de Venise, en 2006.
*
Film hispano-suisse :
Los pasos dobles. Isaki Lacuesta, avec Miquel Barcelo. 2011. Prix de la
Coquille d'or au festival de Saint-Sébastien.
* - Voir aussi l'article : Les ondes-le colonel
Marcel Augiéras (février 2015)
Francesca Y.
Caroutch
recherche Dana Shishmanian
juin 2015
|