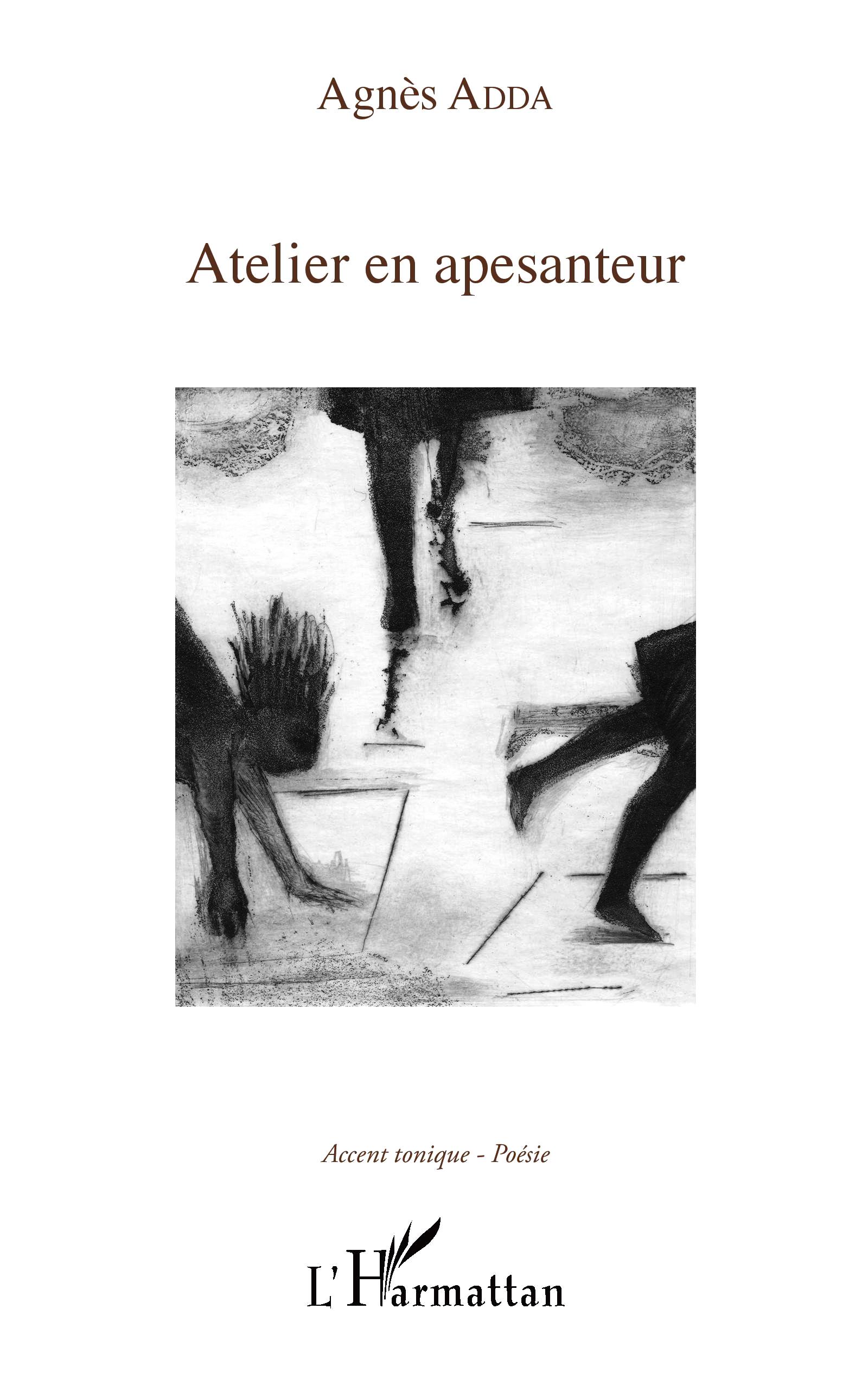|
Qui
navigua jamais à portée de vue ? (p.93)
DZ : Chère Agnès. Je me permets d’entrer
immédiatement dans le vif du sujet. La poésie tient du mystère et de
l’évidence n’est-ce pas ? Et je me demandais comment elle avait pris
naissance en toi aussi bien en tant que lectrice de poésie qu’en tant que
poète. Quels poètes ont été pour toi (et le restent peut-être encore)
déterminants et enchanteurs ? N’écris-tu que de la poésie ?
AA : Ces trois questions se ramènent peut-être à
celles-ci : Qu’est-ce que la poésie ? Qu’est-ce que j’écris (ou
cherche à écrire) ? Je tente de répondre : communiquer une
émotion, à la fois singulière et universelle. La recherche consiste à
creuser l’émotion, l’approfondir, la cerner et à en rendre compte avec une
extrême justesse (idéalement !). L’écriture, la langue sont
elles-mêmes des guides, des passeurs, lors de ces deux opérations.
La question de la forme
est donc essentielle ; je pars à sa recherche. J’ai aimé, j’aime les
auteurs qui ont œuvré dans ce sens – auteurs très divers, mais dont
l’univers mental, la sensibilité, bien sûr, me sont accessibles (je
m’exprime et je lis en français essentiellement, je vis dans une grande
ville au XXIème siècle…)
Je citerai quelques noms et quelques courants :
Ronsard (recherche d’une langue, de formes : manière et
rigueur) ; le symbolisme, Verlaine en particulier, son art de la
suggestion « sans rien en lui qui pèse ou qui pose » ; le
pré-surréalisme : Apollinaire et Reverdy (pour ce dernier j’ai travaillé
sur ses premiers recueils). Le modernisme de Reverdy, ses goûts plastiques,
son sens de l’ellipse, sa volonté de recréation m’ont, jeune,
fascinée : il ne s’évade jamais de la réalité (Les Ardoises du toit, La Lucarne ovale) mais bannit toute copie
du réel. Le surréalisme : Breton et Eluard sont encore des maîtres
dont il faut poursuivre la voie : l’imagination vaut la réalité (ou
prétendue telle), elle est aussi « vraie ». Yves Bonnefoy chez
qui le rêve et la mémoire possèdent une épaisseur, ou plutôt une légèreté
sensible. Georges Schéhadé, pour sa simplicité.
J’ai abordé d’autres expressions que l’écriture
strictement poétique. D’une part la nouvelle : je me demandais comment
rendre compte d’une temporalité (la nouvelle fut pour moi un laboratoire de
recherche). D’autre part l’évocation sensible et comparative d’œuvres
picturales. Je n’ai pas donné suite à ce travail, mais il n’est pas exclu
que j’y revienne.
DZ : Atelier
en apesanteur met en lumière ton goût pour d’autres modes
d’expression : le théâtre, l’opéra, la peinture, la danse.
Pratiques-tu un ou plusieurs de ces arts ? Ton inspiration poétique
dépend-elle beaucoup de coups de cœur esthétiques, de spectacles auxquels
tu assistes etc. ?
AA : Je pratique la danse en amateur et sans prétention.
Parmi les spectacles que je préfère et dont je suis l’actualité, il y a les
ballets, modernes en particulier.
La peinture fait partie de ma vie, mais je ne la
pratique plus actuellement, n’ayant évidemment aucune disposition pour cet
art. J’ai souvent travaillé, je travaille avec les arts plastiques, des
œuvres consacrées ou non, anciennes, modernes ou contemporaines ;
elles sont une source d’inspiration, le moule de nombre d’émotions – le
ventre où prennent naissance bien des textes.
Fabienne Yvetot, qui a réalisé la couverture de ce
dernier recueil paru à L’Harmattan, est à l’initiative de nombreux livres
d’artistes et portfolios réalisés en commun dans un mouvement
d’aller-retour entre écriture et plastique.
DZ : Que contient le mot « atelier »
pour toi ? Sa polysémie me paraît riche de possibilités. A quelles
perspectives le choix de ce mot dans le titre ouvre-t-il ?
AA : Un atelier d’artiste et de recherche … Ma
chambre d’enfant puis de jeune fille donnait sur un atelier qui se
déployait sous une grande verrière ; elle était suspendue entre le
ciel et le sol d’un atelier où ma mère, qui ne pratiquait à proprement
parler aucun art, ou bien le silence, officiait.
DZ : Il y a eu donc très jeune une relation
intime entre atelier et apesanteur !
Venons-en justement à cette idée d’apesanteur : faut-il être en
apesanteur pour écrire des poèmes ? Cet état est-il une forme de
voyage ? La présence précise à une émotion, une sensation ? Une
attention redoublée aux mots, à leur sonorité, à leur préciosité, à leur
délicatesse ?
AA : Quand on écrit, on est à l’affût d’un dire.
On l’extirpe et on le modèle. L’excitation, la concentration, le guet
participent en effet à l’état du poète, du voyageur. Un inconnu profond,
viscéral, surgit, à formuler. La délicatesse des mots – leur fragilité
comme leur préciosité – devra se mettre au service de cette brutale
étrangeté qui caractérise toute véritable émotion humaine.
DZ : Les paysages et de façon plus générale la
nature fait aussi partie de tes thématiques poétiques. T’inspirent-ils au
même titre que les arts ? Ont-ils pour toi autant d’importance
émotionnelle que les arts ?
AA : Un paysage urbain ou naturel, une scène,
une coïncidence, une sensation, une production humaine sont susceptibles de
nous interpeller également : leur charge émotive, sans être identique,
est équivalente.
DZ : Dans ton dernier recueil, le
« je » est souvent remplacé par un « nous ». Que
représente cette première personne du pluriel ? D’ailleurs, en dehors
de cette présence du nous, le sujet de l’énonciation reste discret, sinon
absent. Peux-tu expliquer pourquoi ?
Je pourrais répondre « Tout homme porte la forme
entière de l’humaine condition », ce ne serait pas une boutade car je
suis une femme, un être humain !
Le jeu des pronoms correspond aussi à une recherche
esthétique qui repose sur la variation des points de vue.
Comment rendre compte des multiples facettes d’une
émotion ? Comment aussi et surtout ne pas faner la surprise de son
surgissement ? Comment enfin éviter le ton doctoral et pompeux,
contourner cet écueil du poète, le « romantisme » ?
DZ : Il me semble que tu réussis fort bien à
déjouer tous les écueils dont tu viens de parler. Ta poésie est aux
antipodes de tels travers, rassure-toi !
Atelier en
apesanteur ne
tourne le dos ni à l’Histoire ni à ses drames et stigmates, même si cela
reste discret et épars dans le recueil. Peux-tu pour autant te sentir ne
serait-ce qu’en partie poète engagée ? Cette question fait- elle sens
pour toi ?
AA : Je ne me définirais pas comme un poète
engagé. Mais tout écrivain est engagé dans l’Histoire parce qu’il a une
histoire et qu’il vit dans le temps et l’espace, même s’il ne se soumet pas
à l’attraction terrestre !
Pour ma part, je n’ai pas choisi de me raconter ni de
témoigner des progrès ou des drames de l’Histoire. Je ne méprise pas les
grands genres, le lyrisme ou l’épopée ; j’admire leurs réussites et je
ne prophétise pas a priori leur défaite. Néanmoins, la « poésie
engagée » n’est souvent qu’une parole accaparée par un point de vue
partiel et partial. Ma recherche est inverse. Cette question développe donc
et prolonge la précédente. Libérée d’une perspective unique et unifiée,
j’explore en poésie l’étrangeté du microcosme et du macrocosme.
DZ : Et pour clore cet entretien, voici ma
dernière question, chère Agnès. Si tu devais élaborer un art poétique, quel
serait-il ?
AA : Je ne prends ma revanche sur aucune forme
littéraire existante. A quoi bon édicter des règles et soumettre l’autre à
sa mode ?
A quoi bon scléroser sa propre inspiration ? Cet
entretien, guidé par tes questions, m’a permis de révéler quelques lignes
de fuite de mon dernier recueil paru. Je t’en remercie. Mon atelier reste
en apesanteur.
DZ : A moi de te remercier pour ce bel et
fructueux échange.
(*) Vous pouvez consulter ma note de lecture sur Atelier en apesanteur de mars-avril 2018
dans la revue Francopolis à la rubrique des Chroniques.
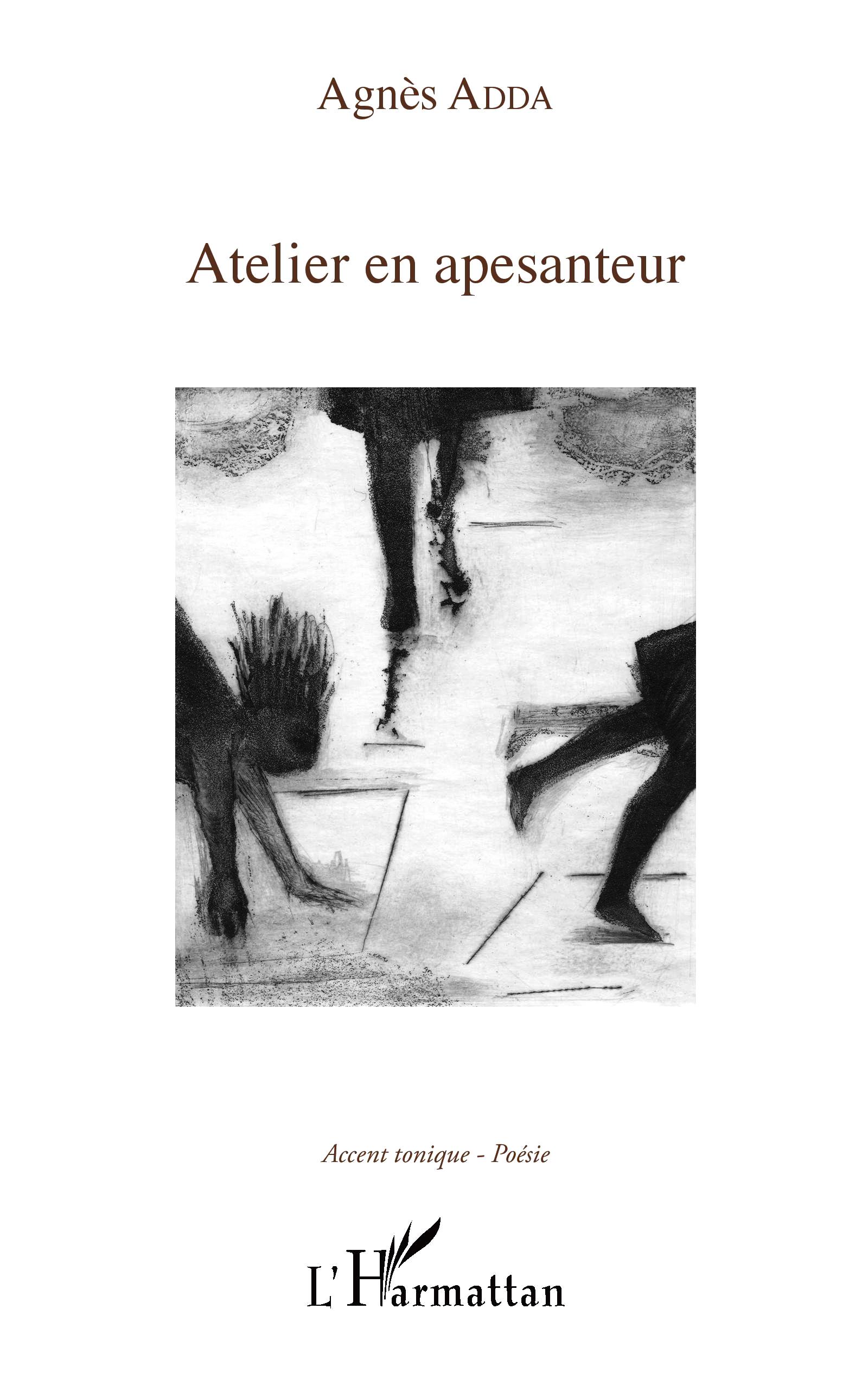
|