|
Entretien
entre Francis Candelier
et Dominique Zinenberg (19 mars 2016)
Nous avons eu l'idée de cet entretien, Francis
Candelier et moi,
après la parution de son premier recueil « Par l'argile et
l'ortie »
aux Éditions du Cygne au début de l'année 2016.
Dominique
Zinenberg : As-tu toujours écrit de la poésie ?
Francis Candelier : J'ai écrit quelques
poèmes à l'adolescence, puis à la naissance de mes
enfants. Mais ma « carrière » de
poète commence vraiment à l'âge de 39 ans. Le
facteur déclenchant a été un atelier de
poésie, bien que je ne me rappelle pas la raison qui m'a conduit
à y aller. On commentait les poèmes des uns et des
autres, avec bienveillance et pertinence. Ça m'a
encouragé. C'est grâce à l'animateur de l'atelier,
Jean-Marie Martin, prêtre et poète, que mon éveil
poétique a eu lieu et s'est développé. Je lui dois
beaucoup.
DZ
: Qu'est-ce que la poésie pour toi ?
FC : La poésie pour moi n'est pas le royaume
du vague, ce n'est pas une contrée nébuleuse et
inintelligible. Elle n'est pas incompatible avec la précision.
Elle est un rapport mystérieux entre habiter le monde et habiter
le langage, - l' étincelle entre les deux.
DZ
: Affectionnes-tu certains thèmes en particulier ?
FC : Je n'ai pas de thématique obsessionnelle.
Certes je suis sensible au regard, à l'attention ; ce qui
importe est d'être en éveil ; dans Par l'argile et
l'ortie1, le regard se porte sur les choses les plus
humbles, « terre à terre » ; cependant, si je
sollicite beaucoup la vue, je n'en délaisse pas pour autant la
musicalité et le rythme. Mais aucun thème n'est à
exclure de la poésie : ainsi, dans ce recueil, deux
poèmes tentent de décrire une cure psychanalytique.
Peut-être faut-il néanmoins garder un certain
équilibre entre la poésie parlant du monde et la
poésie parlant d'elle-même, - que la seconde n'envahisse
pas tout.
Mais si tous les thèmes ont leur place en
poésie, la forme imagée y est incontournable : je ne
conçois pas la poésie sans la métaphore, qui n'est
nullement dépassée. La poésie rapproche des choses
qu'on ne rapproche pas d'ordinaire. Autrefois on créait des
métaphores verticales, comme les paraboles
évangéliques, entre le ciel et la terre, le spirituel et
le matériel ... Aujourd'hui on crée surtout des
métaphores horizontales, comme celles d'Elstir chez Proust entre
la terre et la mer.
DZ : Parle-moi de ton rapport aux mots.
FC : Il n'y a pas pour moi de mots
spécifiques à la poésie, tous peuvent être
intégrés dans un poème. Les expressions courantes,
voire vulgaires, ne sont pas indignes de la poésie. Mais
certains mots sont comme des bibelots, de jolis objets de langage qui
ont une charge poétique exceptionnelle, surtout quand ils
sont associés à d'autres mots.
La poésie libère le langage, ou plutôt
lui restitue sa liberté initiale, par un « délire
raisonnable ». Les gens parlent toujours de la même
manière, stéréotypée, en assemblant
toujours les mêmes mots. Écrire poétiquement, c'est
associer les mots autrement. Ce sont les mêmes mots, mais
assemblés autrement ils ne sont plus exactement les mêmes.
Une expression toute faite légèrement modifiée, un
jeu de mots redonnent sa vie au langage. C'est comme un ordinateur
qu'on n'utilise qu'à 1 % de ses capacités : le
poète tend à utiliser le langage à 100 %. Ou comme
un cuisinier qui crée de nouveaux plats en associant des
ingrédients qu'on n'avait jamais associés avant. Toutes
ces tentatives connaissent beaucoup d'échecs, en cuisine comme
en poésie, mais celles qui réussissent en valent la peine
!
DZ
: Des lectures t'entraînent-elles à écrire,
après coup, des poèmes ?
FC : Je lis peu, et peu de poésie ; je le
regrette, mais c'est ainsi. La lecture n'est donc pas ma source
principale d'inspiration. Mon aiguillon, c'est la vie quotidienne, la
mémoire, les émotions.
DZ
: Le rêve a-t-il sa place dans ta
créativité ?
FC : Le rêve m'importe, mais pas à la
manière des surréalistes. Certaines expériences de
l'état de veille sont pour moi « de l'ordre du
rêve ». Mais je suis peu enclin à la
rêverie.
DZ:
Te faut-il un plan pour constituer un recueil ?
FC
: Ce n'est pas parce que ma poésie n'est pas
narrative, comme un roman, qu'elle n'est pas com - posée. Par
l'argile et l'ortie est un cheminement du ténèbre
à la lumière. Un poème peut aussi se construire
sur la répétition, l'énumération,
l'inventaire, sous forme de litanie, comme, dans ce même recueil:
le Chant des silences.
DZ
: N'écris-tu que de la poésie ?
FC : Non, j'écris aussi des nouvelles, qui ont
en commun avec la poésie la concision, peu de
narrativité, la possibilité de naître d'une phrase
ou d'un mot, voire d'un rythme intérieur comme le relate Paul
Valéry pour Le cimetière marin. Cette phrase, ce
mot, ce
rythme peuvent rester en sommeil pendant des années, puis
soudain le cours du récit ou du poème reprend.
J'écris aussi des « récits de choses », un
peu à la manière de Francis Ponge ou du Claudel de Connaissance
de l'Est.
DZ
: Pour finir, je voudrais te laisser t'exprimer sur
ce que tu nommes souvent, avec d'autres, « la crise de la
poésie » .
FC : Pour moi, la crise de la poésie (le fait
que la poésie se lit et se vend très peu alors qu'on en
produit beaucoup) est due à son inaudibilité, qui
découle en partie d'une crise générale de la
communication : on ne parle qu'à ses proches, à son clan,
à ceux qui parlent comme vous, - c'est le communautarisme.
Toutefois cette inaudibilité est aggravée par
l'opacité quasi délibérée de certains
poètes, qui se prennent pour Mallarmé sans en avoir le
génie. D'autre part les gens aiment les histoires, «
l'action », et la poésie est peu narrative. Pourtant tout
le monde pourrait lire et produire de la poésie, ce n'est pas un
monde de martiens. Il y a crise de la lecture de poésie , mais
pas du désir de poésie. Il faut s'interroger sur les
moyens de libérer ce désir, de débloquer la
lecture de la poésie, en particulier pour ceux qui n'en
écrivent pas eux-mêmes. La prophétie de Hegel sur
la mort de l'art (ou, pour mieux traduire Auflosung, sa dissolution,
son étiolement) est partiellement vérifiée pour
les autres arts, mais elle se vérifie totalement pour la
poésie, qui est actuellement en état de mort clinique.
DZ
: Je te trouve bien pessimiste, Francis, et je crois qu'une lutte
réelle et un dynamisme toujours renouvelé bien qu'en
partie confidentiel, permettent à la poésie de
renaître de ses cendres, telle le phénix et d'offrir
à ceux qui le veulent bien (et il y en a, et partout) des
pépites diverses et bouleversantes. Mais merci pour tes propos
et tes enrichissantes réflexions.
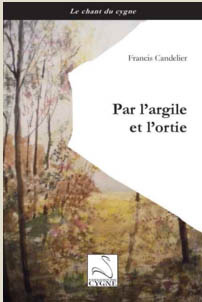
À l’origine, dans l’enfance, « la
noyade au sein froid de la négation ». Et puis, de
poème en poème, c’est la recherche d’une lumière
à tâtons, dans les ténèbres de la vie, avec
ses avancées, ses reculs, ses haltes nocturnes. Peu à peu
le pas s’assure, de la clarté vient, de la paix s’installe ; la
« lumière du très simple », un
moment, apparaît. L’âme se trouve « en lavant les
pieds de l’Infime », se guérit de l’idéalisme
brumeux « par l’argile et l’ortie ». Elle aborde
enfin aux rives heureuses, acceptant même « la
transcendance, à condition qu’elle ait de la terre sur les ongles
».
|
FRANCIS CANDELIER
Né à Roubaix, titulaire d’une maîtrise de Lettres
classiques, ancien haut fonctionnaire, Francis Candelier vit à
Vernon, en Normandie. Il s’est toujours intéressé aux
mots, à leur histoire, à leur étonnant rapport aux
choses.
Il a publié des poèmes dans les revues Phréatique,
Arpa, et dans la revue en ligne Francopolis.
Son oeuvre comprend également des haïku, des nouvelles, des
proses poétiques entremêlant descriptions minutieuses et
métaphores. Son esthétique est celle d’une poésie
lisible, imagée, lumineuse – en rupture avec l’obscurantisme
mallarméen
|
Francis Candelier
présenté par Dominique Zinenberg
AVRIL2016
|
|