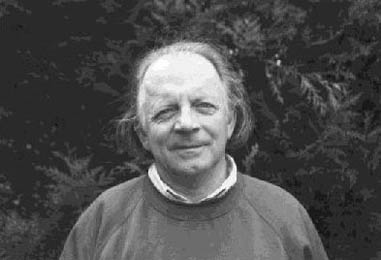Paul MATHIEU
Dans le souffle
de Pierre Dhainaut
En parcourant Pluriel
d'alliance, Le don des souffles et quelques autres
recueils.
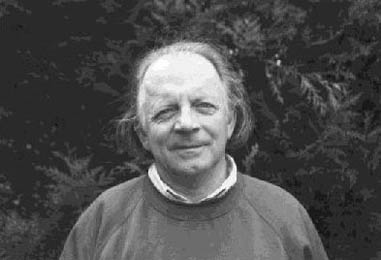
Parler
de la poésie de Pierre Dhainaut ne va décidément
pas de soi. Déjà pour de simples raisons pratiques. De
fait, si, chez bien des poètes contemporains, le lecteur est
souvent confronté à des textes minimalistes de quelques
lignes, il en va ici tout à fait à l'inverse. Il se
trouve en effet devant des compositions denses qui, si elles laissent
de la place à la respiration, n'offrent que peu de vides ou,
pour le dire autrement, s'avèrent étrangères
à ces grandes marges blanches qui faisaient tant rêver
Paul Éluard. La densité de telle parole poétique
drue, rangée en paragraphes monolithiques ne facilite pas
nécessairement l'approche du contenu. Du coup, même si
elle ne nuit pas, l'abondance de signes pourrait porter à croire
que le fil de l'écriture s'en trouve plus facile à
saisir. Mais non. Même si dans l'ensemble chaque mot vient
à son heure, il reste là-dedans un je ne sais quoi qui
résiste.
Poète
de la vigilance permanente, tenant du souffle – celui du vent et celui
de la poitrine, partisan de l'ouverture et de l'intimité dans un
même temps, Pierre Dhainaut est un artiste de l'écoute,
mais aussi et avant tout du regard. Confronté sans cesse
à l'immensité, à la plaine des Flandres où
l'on sent avec une prégnance de tous les instants la
présence invisible de la mer, il laisse aller sa vision dans une
sorte de confidence illimitée. Frottée au large, la voix
roule sans limites, mais, dans le même élan, elle confine
au murmure du quotidien.
On pourrait résumer notre approche à celle de quelques thèmes :
la nuit
(voire la nuit confiante), le sommeil, le large, l'enfance qui jette
des cailloux aux mouettes...
Sans cesse, comme tant d'autres, Pierre
Dhainaut cherche les points faibles, les failles par où glisser
sa voix. Mais ce travail de fouille, de sape ou d'archéologie,
c'est selon, n'aboutit que partiellement: la nuit n'explique pas la
nuit (Le don des souffles,
p. 51). En réalité, pour utiles qu'elles soient si l'on
veut composer, mettons, une sorte d'inventaire, ces pistes ne suffisent
pas à entrer pour de bon dans la poésie de Pierre
Dhainaut qui se présente avant tout comme un cheminement.
Dans Marines sans paysage (repris dans la brochure Le poème n'est pas seul à respirer), il écrit : « notre place est dans l'approche, nous ne craignons pas qu'elle prenne fin ».
On comprend mieux dès lors que, comme autant de matériaux
épars glanés au cours de la marche, certains textes
ressemblent à des fragments, à des notes, à des
réflexions tendues tout autour de la notion même
d'écriture, à des morceaux de poèmes en voie de
construction.
Dans Le don des souffles, voilà par exemple telle série explicitement intitulée « fragments
». A l'identique, les récits d'approche au début du
même recueil paraissent significatifs. Tout s'y passe comme si
les choses avaient du mal à se mettre en place ou du mal
à s'achever avec cette vague impression de « longueur de temps, d'après-midi [qui] ne voulait pas finir »
(Ibidem, p. 34). Fidèle à cette image, le poète en
rajoute sans cesse, encore et encore, pour obtenir ce résultat
pictural d'une étendue où rien ne bouge hors le sac et
ressac de la mer. Voilà au moins qui transcende les
catégories habituelles et qui même nie le cours ordinaire
des heures:
Regard plus profond que le temps,
la mort ne viendra pas de lui
(Le Don, p. 45).
Constant aussi chez Pierre Dhainaut, voilà encore ce regard vers
l'autre rive dont on ne saisit que trop bien ce qu'elle peut
représenter mais à laquelle l'inscription à
rebours de toute chronologie contraignante permet d'échapper. Il
est vrai aussi que dès l'entrée de Pluriel d'alliance, l'écrivain avertit: Je parle pour ceux qui nous précèdent dans l'invisible.
Cette propension à s'inscrire dans l'âpreté de
l'obscurité, voire de la disparition, semble une manière
de se poser outre les limites trop solidement fixées. N'est-ce
pas au départ de l'ombre que l'on aperçoit le plus
sûrement la lumière?
Avec Pierre Dhainaut, il
s'agit de trouver une voie, de tracer sa propre route / et de
progresser parmi les ruines (Pluriel, p. 12) et plus même de
faire apparaître [dans la nuit] un visage plus grand que le
visage (Ibidem, p. 9).
La tâche n'a rien d'évident,
déjà dans Un Livre d'air et de lumière, le
poète le reconnaissait:
Faisons-nous plus
que nous approcher?
Ouvert à mesure de la progression, le chemin devient, le
thème est désormais classique, plus important que le but
quel qu'il soit :
Chaque pas nous invente, il invente un chemin (Don, p. 43).
Il n'est pas étonnant à ce chef que l'écriture de
Pierre Dhainaut ressemble à une perpétuelle quête
du sens, ou, pour dire les choses autrement, un perpétuel art
poétique. En témoigne sa réflexion sur les mots,
sur le peu de vocabulaire dont on peut disposer. Sur le peu
d'expérience aussi.
Ainsi : la poésie est [peut-être] le sujet du poème. Ce à quoi il ajoute :
Le poème est cette parole moins soucieuse de sa nature, de sa
pureté, que de l'élan qui la déploie, dont elle
entretient l'origine.
(Pluriel, p. 38).
Il est vrai une fois de plus que, si le but à atteindre en
poésie n'a qu'une importance assez relative, il n'en demeure pas
moins que le cheminement, même s'il ne se fait pas dans le
hasard, reste plus facile à manier que ce qui aura en fin de
compte été amassé:
Ce n'est rien de toucher la cible: le plus ardu vient après (Pluriel, p. 37).
Beaucoup d'efforts pour peu de résultats ? Non, puisque
voilà présent le coeur de cela qui veut toucher avant de
dire quoi que ce soit. Le poème n'est-il pas avant tout acte de
création et non d'écriture raisonnée?
Sans cesse occupé à reconquérir l'aube, dans sa
conclusion -partielle et provisoire comme toutes les conclusions,
Pierre Dhainaut ne pouvait guère s'appuyer sur une
technicité à tout crin, mais bien plus
expressément se solder par une sorte d'acte d'amour:
aimer et servir les mots et les mots seront tellement plus que des mots
(Pluriel, p. 41).
Absence de technicité ? Oui, certes, puisque – et semblable aveu
peut passer pour un label d'authenticité – il confesse son
hésitation devant la reconnaissance du poème. Ainsi :
il n'y a pas de poésie, il n'y a que des preuves de poésie
(Pluriel, p. 45).
Et ceci encore:
Le poème tient parole, qui n'est qu'une promesse
(Ibidem, p. 56).
Ce dernier aphorisme (c'est pour ainsi dire de cela surtout dont il est
question dans Pluriel d'alliance) rappelle combien on doit
s'élever humble vers l'irréductible (p. 18).
Humble, le lecteur doit aussi le rester quand il sait à l'avance
que le souffle ne s'explique pas. Qu'il faut le laisser passer. Le
laisser passer et c'est tout.
Références bio-bibliographiques :
Le poète Pierre Dhainaut est né le 13 octobre 1935
à Lille. Il vit à Dunkerque où il a
effectué toute sa carrière de professeur. Sa
première publication, d'inspiration surréaliste, Mon sommeil est un verger d'embruns,
date de 1961. Depuis, plusieurs dizaines de titres sont venus enrichir
son oeuvre. Une anthologie témoigne de l'évolution: Dans la lumière inachevée,
Paris, Arfuyen, à paraître. Il a souvent travaillé
avec des peintres et des graveurs comme Jacques Clauzel, Mariette et
Marie Alloy.
Parmi ses titres :
Pierre DHAINAUT, Un livre d'air et de mémoire, Marseille, Sud Poésie, 1989.
Pierre DHAINAUT, Le don des souffles, Mortemart, Rougerie, 1990.
Pierre DHAINAUT, Pluriel d'alliance, Jégun, L'Arrière-pays, 2005.
Pierre DHAINAUT, Le poème n'est pas seul à respirer, Dunkerque,
Bibliothèque municipale, 2006.
A consulter :
Jean ATTALI, Pierre Dhainaut, Rodez, Éditions du Rouergue, 1986 (coll. « Visages de ce temps », n° 34).
Paul MATHIEU
Traversées n°49

****
Entrouvertures
1.
La pluie sur
des vitres, la nuit,
par rafales,
jusqu’au silence
qui crépite, qui ruisselle,
ensemble, on rêve
comme on s’éveille.
2.
Galet rond dans
la paume, ces lignes
ou ces veines
suivies une à une,
interrompues,
reprises, s’y perdre,
on ne l’a jamais craint.
3.
Invisibles, les oiseaux,
de grand matin, leurs
traces, à peine,
confiées au sable,
le regard,
le regard ne cherche
qu’à se changer en souffle.
4.
Noeuds secs et fentes,
rien qu’une planche
à terre : que la main
la caresse,
à la première écharde
elle sait que l’arbre
continue de croître.
5.
Si noire, si
étroite, cette flaque :
les yeux d’un enfant
n’en font pas le tour,
seuls, ils l’éclairent,
ils vont
aussi loin que les ondes.
6.
Ecrire, est-ce encore
le mot juste ? que l’on
effleure, que l’on incise,
l’envie est la même
pour l’empreinte,
qu’elle déborde
la page, l’écorce.
7.
Au lieu d’ombres,
les plus frêles, les plus
rugueuses,
les doigts verront
des flammes, des nuages :
ce qu’on nomme un mur,
ils le franchissent.
8.
Avancer le front
à travers les feuilles,
il n’y a pas d’ailleurs,
mais peut-être
avec l’air, avec
l’écume qui l’imprègne,
se découvre un visage.
9.
Au gré des vagues,
des phrases, aucune
ne sera la dernière,
heureuses
en respirant d’offrir
à ce rivage, à l’horizon,
la pleine incertitude.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------