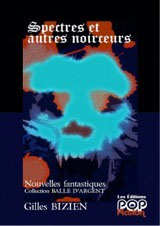|
|
||
|
GUEULE DE MOTS -ARCHIVES 2010
Eric Dubois - Hélène Soris - Laurence Bouvet |
||
|
.
GUEULE DE MOTS
Cette rubrique reprend vie en 2010 pour laisser LIBRE PAROLE À UN AUTEUR...Où les mots cessent de faire la tête et revêtent un visage... libre de s'exprimer, de parler de lui, de son inspiration, de ses goûts littéraires, de son attachement à la poésie, de sa façon d'écrire, d'aborder les maisons d'éditions, de dessiner son avenir, nous parler de sa vie parallèle à l'écriture. etc
Les artistes aujourd’hui savent
montrer les différentes facettes de leurs talents : ils sont poètes,
écrivains, peintres, récitants, et en écriture savent passer de la poésie à la
nouvelle, en édition papier ou en version numérique.
Ils adhèrent pleinement à toutes ces technologies qui font l’essentiel de notre vie actuelle. Ce mois-ci, c’est avec un immense plaisir que je vous présente Gilles Bizien. Artiste complet s’il en est. En parallèle à la poésie, il écrit des textes fantastiques publiés chez l’éditeur québécois, Popfiction. Pour les lecteurs de francopolis, Gilles Bizien livre ici une longue réflexion sur l’acte d’écrire, l’implication personnelle qu’il demande, la place importante qu’il prend dans la vie même d’un auteur. Longue réflexion qui nous offre un réel plaisir de lecture, avec l’invitation d’en assurer un prolongement personnel. Gilles Bizien : Pourquoi écrire
Il n’est jamais simple de répondre à
cette question : « Pourquoi écrire ? » ou « Pourquoi
écrivez-vous ? ». Tout d’abord parce que cela relève de l’intimité.
Ce que l’on peut assurément noter chez la plupart des écrivains, c’est le désir
de répondre à un besoin vital de donner une existence à une nécessité
intérieure. Comme le dit Roland Barthes : « La littérature ne permet
pas de marcher, mais elle permet de respirer ». J’aime beaucoup cette
citation de Franz Kafka : « La littérature est assaut contre la
frontière », j’ajouterai simplement contre la frontière intérieure :
le besoin d’écrire. Frontière, borne, délimitation, démarcation, limite, comme
on voudra pour matérialiser l’impérieux besoin de création au centre de soi.
Pour autant, il ne faudrait pas prendre cette réflexion pour de l’égocentrisme.
Mais plutôt comme une irrésistible, une pressante injonction à coller au plus
proche de soi même. Similairement, on retrouve souvent
la question tournée dans un autre sens. Tel que : « Faut-il avoir
quelque chose à dire pour écrire ? ». Quelque chose
d’intelligible ? Au fond, on revient au questionnement initial. C’est cette
nécessité intérieure qui est le message des auteurs. Cette motivation intime
qui est véritablement un aveu, une déclaration, en amont de la production
littéraire proprement dite. Si je ressens ce besoin c’est que fatalement, j’ai
quelque chose à dire. Alors, ma parole vaut. Il faudrait ajouter un mot sur
« Quoi écrire ? ». A mon sens, cela s’apparente plutôt aux
considérations d’ordres techniques. Le genre, la traduction matérielle d’une
pensée, le style, l’objectif, etc.…Ce qui ne nous intéresse pas ici. On pourrait mentionner le fait que
l’écriture, une fois l’œuvre produite, échappe toujours à l’auteur. En quelque
sorte, l’écrivain n’a plus la main sur ce qu’il a produit. L’œuvre prend
parfois une ampleur sociétale, une dimension sociale, une envergure culturelle
étonnante, sans que cela soit prémédité. L’œuvre symbolise quelquefois, entre
les balises morales de l’homme et des sociétés, l’insoumission, la dépravation,
des idées neuves, un regard de haute volée sur le monde. Ce qui n’est pas sans
engendrer de l’étonnement, de la sympathie, de la répugnance, de la haine. L’oeuvre
est parfois récupérée à des fins politiques ou sert des causes humanistes. Cependant,
tout cela bien plus loin en aval du cocon intime et profond qui l’a fait
naître. Bien sûr, on pourra trouver chez
d’autres des motivations différentes. Il y a autant de raison d’écrire que
d’écrivain. Par exemple, l’auteur de pamphlets aura pour but de s’attaquer à un
pouvoir quelconque, de dénoncer des injustices. Un romancier axera son défi sur
le plaisir, le rêve, l’évasion, qu’il pourra donner aux lecteurs. Mais pour se comprendre, il est bon
de se poser la question suivante : « Que serait ma vie sans
l’écriture ? ». Pourrais-je vivre sans cela ? Serais-je en phase
avec moi-même ? Vivre tout simplement serait-il possible ? J’écris pour être vivant. J’écris
parce que je dois écrire. Je ne suis ni forçat ni galérien. Je ne tire aucun
wagon trompeur, faux, feint. Ce sont les wagons qui me poussent. Sans eux, je
n’aurai pas même conscience d’être dans un souterrain. J’écris pour ne pas
étouffer, pour me baigner pleinement dans ce ruisseau intime qui coule entre
les roches de mes poumons. J’écris parce que sans cela mes nerfs, mes fibres, n’auraient
pas la vibration conforme. J’écris pour
que l’ébranlement de mes membres fasse sourdre cette musique interne, le
frissonnement idoine. Je ne suis ni embastillé ni captif. Je suis vivant. Le poème apparaît, chaque fois
qu’une peuplade solaire de sons et d’images s’installe dans la poitrine ou
couve sous le fleuve de peau du corps. Chaque fois qu’un monde équivoque
circule comme du sang neuf dans les artères. Le poème naît d’un effondrement
enfantin. De la plus petite particule qui voyage en fraude telle une fée
miniature et hallucinée entre les routes ferroviaires de l’espérance. Parfois une pluie new-yorkaise,
l’écume bleue d’une caresse, ruissellent sur les barreaux qui encagent le cœur.
Quand le jour s’épuise, il y a ce soulèvement, cette tension justificative de
la vie, à l’intérieur. Il y a la part de malédiction, la saignée, une étoile,
un coin de nuage, dansant sur les pupilles. Tout ce qui nous consume et nous
maintient vivant paradoxalement. Mais qu’importe la mer, les arbres
aux épaules de ruffians, le sable poudreux qui tombent des astres, sans les
mots. Qu’importe la mer, les arbres, le sable, sans les mots au-dedans. A quoi
servirait le long roucoulement de l’espace au dessus de nos têtes, si ce n’est
pour vivre incroyablement proche du poème. Je sais que la chanson de nos vies
manque de couleur. Je sais que ta silhouette pleine de fragments, d’impacts de
rêve, comme nous tous, quitte souvent le monde. Cargos fantômes, tu dérives
vers un port de fortune ressemblant à un
baiser sans amour. La dérive même est notre patrie. Nos bras sont trop courts, lessivés.
Nous n’attrapons qu’avec les yeux. Parce que tout se répond, tout se fait écho
dans le cœur des choses. Il suffit d’écouter les choses et les êtres qui les
traversent pour comprendre qu’il n’y a ni ordre ni désordre dans ce qui nous
entoure. Les choses sont de longues trajectoires non statiques, des météores,
des sortes d’aérolithes aux traînées vaporeuses. Elles nous paraissent
immobiles alors qu’elles sont en réalité des vortex avalant la conscience. Les
êtres pour la plupart ne sont pas conscients qu’ils marchent au travers de
champs de forces qui pourraient effacer leurs craintes, porter leur douleur,
écraser leur lassitude. Des chevaux insaisissables chahutés
par le vent atterrissent sur l’hiver, sur le pétale scintillant de quartz de
nos fuites. Les signes sur les visages ne trompent pas, reflètent le besoin,
l’île qui nous manque. Hoquets sur nos vies, je veux voir le globe de verre des
eaux rouler sous des ponts gracieux comme des goélettes. Je vais, je viens,
entre enfer et dérisoire. Amour sans paradis, paradis sans illusion. Je veux
toucher le double. Le sol, un échiquier de confusions, plate-forme mouvante,
aérogare avec toi au milieu. Ce qui coule le long des fissures,
le courant, une lisière verticale. Adjoints aux souterrains de nos
envoûtements, les cultes grossiers, les accouplements avec la mort. Le ciel
sous terre est un lac acide. Le ciel sous terre abrite des animaux qui
n’étancheront jamais notre solitude. Des animaux ailés qui cependant rampent,
qui ne verront plus la lumière, enfermés dans la noirceur. Cerfs aux ramures
brûlées par des cosmos nocturnes, loups prisonniers de leurs légendes, animaux
miroirs. Mais voyagent-ils plus que l’homme ? Laissent-ils des traces sur
le sol et les cœurs ? Connaissent-ils les prières des pauvres gens ? Le père cherche ses enfants. Le fils
cherche une caresse dans les yeux de sa mère. Les fontaines s’appellent des
sources. Aurore miraculeuse que personne ne traverse. Peut-être que les enfants
chétifs partent encore en pèlerinage vers l’espoir sur des traîneaux bleus.
Peut-être que les mains des amants bruissent à la façon de l’eau vive. Tandis
que s’enlisent les bourreaux dans des gloires fabriquées. C’est comme cueillir le rêve sur le
dos de la mort. Ca dépasse l’espace et le temps. Il n’y a ni besoin de croyances
ni d’église, juste la soif galactique du plongeon. On pourrait pleurer après le
dépouillement. Trimbaler nos carcasses alcoolisées sur de l’asphalte trempé
d’urine sans toucher aux gouffres derrière les yeux. On pourrait continuer à
écrire sans voir, comme penser au ciel sans jamais y monter, comme s’empaler
sur un horizon perdu en nous et non au-delà de nous. Qui niera qu’écrire n’est
pas aussi l’arbre sensible où nous accrochons nos furtifs mirages, nos brèves
amours. Pourtant personne n’en revient vraiment. Personne n’en revient vraiment
car il y a plus. Pays évanescent certes, bras de vent qui écartent les
forteresses et les remparts, qui creusent la terre brune gonflée de cadavres. A
la fois déclin et enfance. Avant, il fallut renoncer aux
promesses. Se cacher au travers du monde trop grand. Trop grand pour moi, trop
grand pour toi. Même quand l’idée rassurante d’un nuage déroulant sa main, ses
séquences baroques, sur la rue, ne devenait plus accessoire. Il fallait bien
continuer à lutter. Tout au moins avancer. Ne pas laisser pourrir le fouillis
de caillasses emplissant la voix. Ne pas laisser se perdre la preuve de
l’attention portée aux multitudes d’éternités contenues dans l’instant. J’entends toujours crisser ce train.
Je l’entends distinctement. Il roule sur des voies ultra ferrées. Il pénètre
des tunnels saturés de lumière. Je perçois les sons agressifs que les wagons
produisent. Un hurlement mécanique comme vomi par des bouches invisibles. Des
milliers de bouches paranoïaques d’une foule fantomatique. Des visages et des
corps altérés, flottants, qui ne peuvent traverser le rideau du réel. Où va ce train ? A-t-il une
destination ? Emporte t-il des passagers ? Les larges fenêtres
vitrées des wagons défilent à grande vitesse. Je voudrais que ce train soit le
train de l’écriture. Je voudrais monter dedans, m’y installer. Je sentirais sa
carcasse métallique m’envelopper ou plutôt m’emprisonner. Qu’il s’arrête un
instant pour que je puisse monter dedans. Je ne veux pas rester à quai. Même en
marche, il me semble que je peux même monter à l’intérieur. Malgré la vitesse.
Malgré le rugissement de ses roues d’acier. Malgré le vacarme assourdissant de
sa marche. Je veux être lui. Je désire m’intégrer à son corps, faire partie de
ses atomes, de sa tôle rectangulaire et constellée de rivets. Je veux qu’il
m’avale, qu’il m’engloutisse, que son exosquelette ne fasse qu’une bouchée de
moi. Je veux être le rêve d’un rêve. Mais le poème ne saurait être autre
chose qu’un indice. Quand le poème apparaît, ce que je vois est double. Il y a
ce que je suis mêlé aux mondes qui s’ouvrent. Il y a toutes ces impermanences
tangibles. Pour finir, un mot sur
l’universel : Un poète, un écrivain,
doit mettre au monde des œuvres qui témoignent du haut degré d’intelligence de
l’espèce humaine. Et cela dans le but d’étouffer chez l’homme les penchants
pour la destruction, le mercantilisme, la violence, l’asservissement… Il doit
être un émissaire de sa propre culture et des cultures contemporaines que le
génie humain à su développer. Il doit être un miroir de ce que nous sommes sans
en occulter la moindre part. Gilles Bizien : dernière parution
Spectres et autres noirceurs, recueil
de nouvelles fantastiques, aux Éditions Popfiction. - Lire des critiques de Spectres et
autres noirceurs : Blog : Vampire Blog : Limaginaria Enfant
pour l’enfer : Editions Popfiction
Si la peur, recueil de poèmes, aux Editions Ex Aequo Retrouver Gilles Bizien :
|
|
|