Mémoire
des Maisons closes
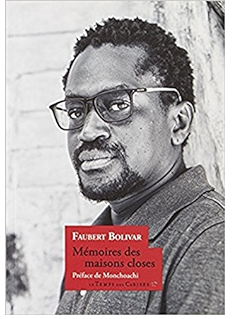
Le poème est chose étrange, mon ange
Écoute, en mon cœur, il traîne les pattes et me
griffe
Le
Temps des Cerises a eu la bonne idée de rendre accessible au public
français ce recueil publié originellement en Haïti (éd. Bas de Page,
2012) qui se compose de deux ensembles, Marelle et Alphabet,
écrits, nous dit l’auteur, respectivement dans la « maison
close » de ses parents à Port-au-Prince et celle de son premier
domicile conjugal à Kingston, suivis d’un Supplément.
Né
en 1979 en Haïti où il occupa un moment la fonction de directeur du
Livre, Faubert Bolivar enseigne désormais la philosophie à la Martinique.
Il est non seulement un poète, auteur en particulier de la prose poétique
Sainte Dérivée des trottoirs (2014), mais encore un dramaturge
récompensé par plusieurs prix.
Les deux premières
parties sont composées de textes brefs, sans titre, on vient de lire le
plus court qui se résume à deux lignes. Des poèmes qui disent souvent les
affres de l’amour :
Déchire-moi
chiffonne-moi
je suis douleur
Amour et écriture se
conjuguent chez le poète (« Tu joues dans mes mots / et mes
ombres... ») bousculant, s’il le faut, la syntaxe :
… je n’ai rien d’autre que l’amour
mais, la langue morte des nuits vieillissant la bouche
en quatre morceaux de murmure...
L’amour c’est aussi des
chairs qui se touchent, des corps qui se possèdent. Peut-on le dire
crûment sans cesser de poétiser ? Faubert Bolivar le tente et y
parvient, comme dans ce quatrain :
Une femme
se masturbe
à la page gauche
je lui cède tous les doigts
L’amour est impudique
(« je sais le jour / dans tes culottes ») et sans doute
impur puisque non exempt
… des remords
qui font pli à ta robe assortie aux serments
que je dégrafe
dans un poème sans ourlets
Il y a des patries
plates et sans âme dont on peut se détacher et d’autres dont on ne
saurait se défaire. Haïti est de celles-là.
J’habite mon île comme j’habite ma mort
Avec la phrase sèche d’un vent de deuil
Comme mon île d’arbres fatigués de branches
Mon île, maman...
L’Haïti-mère qu’on ne
reniera jamais n’est pas moins associée à la mort (1), au deuil, à la
désolation. Elle est « un trou dans [la] tête et [le] cœur »
du poète. On l’aime comme on la déteste (Île maudite et néanmoins
bénie). Haïti, ce « pays tord-boyaux », belle
« comme la chaux » est habitée par
… des squelettes résignés
riant – peinant, chantant – souffrant, dansant
car il faut bien rire, chanter, danser pour continuer à
vivre.
Le Supplément comprend
six poèmes d’une page chacun, plus longs donc que les précédents. Le
dernier qui s’adresse en des termes charmants à sa seconde fille encore à
naître s’ouvre sur cette interrogation :
D’où viens-tu
Inconnue sans papier
Belle, étalée dans le ventre rond ?
Bolivar, on le voit,
sait jouer sur des registres très différents dans une langue toujours
poétique où abondent les trouvailles.
***
Brûler
les ténèbres
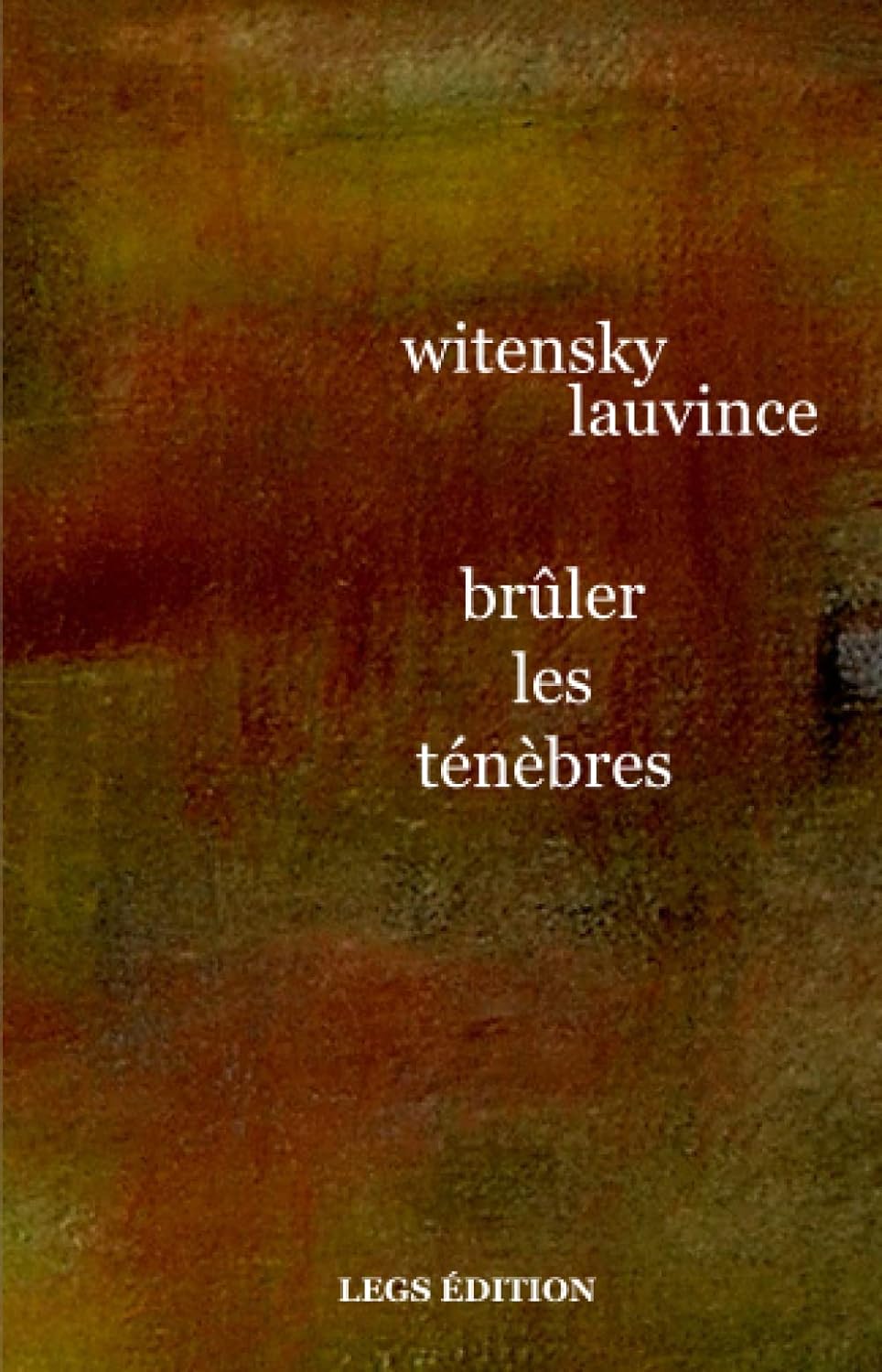
Je suis pleurs du ciel tonnant sur toit de tôles
Le même Faubert Bolivar
a créé l’association Balisaille, laquelle décerne annuellement depuis
2022 deux prix internationaux de « l’Invention poétique », l’un
en français, l’autre en créole.
La première édition
a couronné Brûler les ténèbres du poète haïtien Vitensky Lauvince,
né en 1996, par ailleurs déjà l’auteur de deux romans.
Témoin des malheurs
de son peuple, Vitensky Lauvince espère trouver en la poésie un
refuge : « la poésie comme panse-douleur pour la beauté
fouettée à vif ». Seule, « la politique de
l’éblouissement » serait capable en effet, selon lui, de « Proposer
volcan contre l’obscurité. Installer partout la lumière ».
Cependant la figure du
volcan est ambiguë ; il peut se montrer dévastateur, comme la nature
en général et Haïti en a fait souvent la triste expérience, le
tremblement de terre de 2010 reste dans toutes les mémoires.
… sous vos pieds
volcans en mouvement
tel un soleil éventré...
Que peut vraiment la
poésie quand à la violence aveugle de la nature s’ajoute la violence
coupable des hommes ?
… ma ville nécropole de chrétiens vivants
ô rues de Port-au-Prince maculées de sang
par ces projectiles qu’on plante
dans le corps de mes frères
pour faire pousser la souffrance et la mort...
Le constat est
implacable :
… le bonheur chez nous
est un risque sur lequel
on ne peut pas parier
Ainsi la poésie ne
peut-elle être le remède espéré ; elle peut seulement crier –
« le poème en roue libre siffle la révolte » –, appeler
à « brûler les ténèbres » comme y incite le titre du
recueil, sans croire vraiment être entendu, car « reste-t-il
assez de bras / pour planter l’espoir ? » Et le poète de se
retrouver seul avec ses « bouts de poèmes ».
Witensky Lauvince
balance entre sa foi en une poésie réparatrice et l’évidence que, à
défaut de sauver le monde, elle s’avère incapable de calmer sa propre
douleur. Dans un des rares poèmes sur l’amour, on comprend que celui-ci
est son seul véritable recours.
Il me faut ton rire
troupeau de soleil
pour badigeonner
mon corps et mon âme
de toute ta lumière
S’il ne parvient pas
toujours à se maintenir au niveau de ses plus beaux élans, s’il aurait
besoin d’élaguer certains de ses poèmes, d’éviter quelques platitudes,
Witensky Lauvince n’apparaît pas moins dans ce premier recueil comme un
poète sincère et attachant.
(1) Et même aux
morts-vivants comme dans la pièce Le Flambeau où l’un des
personnages se retrouve zombifié.
© Michel Herland
|