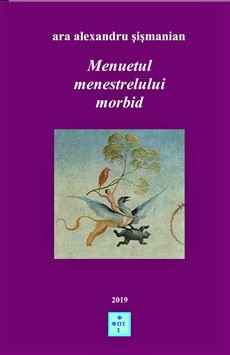|
La poésie est accord au soi profond,
à l’espace abyssal et onirique d’au-delà de la réalité et de l’imagination.
En ce sens, la poésie – non seulement elle mais toute forme élevée de
l’esprit, dans une sphère libre de tout domaine – est une démarche négative
qui utilise, exclusivement pour les refuser, les offres du monde en
présence et, pourquoi ne pas le dire, refuse le monde tel quel. Le logos de
la poésie, comme celui de la philosophie dont la première est proche
parente, pour le plus grand mécontentement de la dernière, va au-delà des
choses qui semblent tendre vers elle, mirages et aliénantes tentations, il
les utilise seulement pour les rejeter, les fond dans la froidure de
l’expression pour en libérer l’étranger sans visage, le sous-jacent que
l’anxiété de l’illusion devine, en se gardant bien de le découvrir. Le
Néant.
Lucidité éthique et négation
esthétique fusionnent chez quelques éternels adolescents, androgynes sans
âge, qui scrutent à travers des nostalgies de mots les tréfonds ludiques du
non né. Non pour en rapporter dans le monde quelques « brins arrachés
à l’invincible chose en soi », comme l’écrivait jadis le poète roumain
Leonid Dimov, brins impossibles d’un soi atteint d’aucun combat – ce qui
évoque par ailleurs l’indicible « Das Wort », la Parole
pressentie et perdue comme en rêve par Stefan George – mais pour quêter,
dans les labyrinthes de ses propres illimitations, l’œil aveugle, illuminé
et enténébré en même temps par le refus absolu du regard : the Eye
Wide Shut comme a dit, me semble-t-il, Samuel Beckett, suivi par le
bien plus populaire Stanley Kubrick. L’Œil dont les profondeurs sombres ont
sans doute, jadis, caressé Homère et, auditivement parlant – car l’Œil n’est
pas limité par les sens – Beethoven. L’Œil qu’ont entrevu Hölderlin,
Novalis et Eminescu, l’Œil devant lequel disparaissent les mirages et les
ombres du spectacle. Ce n’est qu’en tuant en nous – par fermeté éclatante
ou par grâce, la grâce du dégoût et de la haine du monde – les oubliettes
pleines de secrets du regard, que nous pouvons parfois, par quelque nuit
étrangère aux accouplements et au réveil importun des autres, quand
solitaires et uniques nous nous attardons aux portes du mésonge,
l’apercevoir, lui, limpide et aveuglant, tel un double sphérique de notre
visage, voire même sentir sur notre peau profane sa coruscance
incombustible, ou monter avec lui à travers d’épaisses paupières de nuages
vers une autre lumière, plus grande – d’en haut. Ou bien, parfois, le
découvrir à travers des strates géométriques de couleurs, sous d’étranges
couvertures de lassitude, au noyau labyrinthique du cerveau.
Mais, au-delà de cette fonction de
déstructuration des offres aliénantes du monde – pas autant des choses que
des sentiments et relations dont le monde nous appâte, à savoir ce qu’on
pourrait appeler l’état de réalité – la poésie joue, elle, un double
et indispensable rôle, comme toutes les formes démodelantes de la
connaissance. Celui d’anamnèse d’abord, celle qui nous plonge dans la
synchronie pure de l’esprit, témoin d’éternelle nitescence d’une
extériorité inaccessible que nous pouvons seulement deviner par
l’intuition, et ne pouvons éventuellement atteindre, de manière séminale, qu’en
nous supprimant nous-mêmes – bien que l’esprit séminal, avec tous ses
étages, ne soit pas encore l’esprit de l’extériorité absolue du néant. Mais
aussi, le rôle, plus intime, de récupération psychologique, temps retrouvé
du temps perdu, ou, mythiquement parlant, paradis perdu en lequel nous
retournons par récurrente, souriante chute. Entre les deux, plus étrangère
ou plus familière, selon l’angle de vue, se trouve la contemplation
apocalyptique de l’histoire, que le poète déteste mais dont il ne peut complètement
se déprendre, et dont il se venge en la capturant dans les labyrinthes
catoptriques de son œuvre. Ici, dans cette zone précisément interactive de
la démarche poétique, se manifestent d’ailleurs le plus intensément ces
offres psychiques dont il a été question plus haut – non seulement les
tentations du simple désir, mirages coloriés dans le désert des égarements,
mais, plus subtilement, la tentation de l’anxiété et peut-être plus
profondément encore, celle du danger, avec son masque double de salut et de
mort. Ou le sentiment de l’urgence, par lequel nous devenons si étrangers à
nous-mêmes, en nous incrustant généreusement dans les désespoirs du monde.
La compassion, oui, celle qui ajoute une infinie durée à la superfluité.
Sans doute, la relation du poète
moderne ou post-moderne avec l’histoire prend, le plus souvent, la forme
d’un court-circuit interactif qui connecte, pour la durée d’un texte
seulement, la subjectivité créatrice à la diachronie extérieure du monde.
D’autres fois, l’effort déstructurant se manifeste pourtant plus
durablement, soit par une séquence de moments interdépendants qui peuvent
s’étendre sur le territoire d’un volume entier – expériences à la limite du
supportable, traversées par une idée – soit sous la forme plus traditionnelle
de l’épique ludique, jouant de l’impossible quelque part entre mythe,
symbole, et parabole.
Mais à cette interaction avec les
diachronies de l’extérieur, propre plutôt au roman, on peut en ajouter une
autre, que le roman, contaminé par la poésie, a découvert aussi – voir le
cas en quelque sorte classique de Marcel Proust : l’interaction avec
soi-même. Nous entrons alors sur les terres dévastées de la recherche du
temps perdu ou, plus bizarrement, d’un temps complètement autre que celui
où, dans notre méconnaissance de nous-même, nous avons jadis compté nous
trouver. Concrètement, les choses se présentent, hélas, de manière bien
plus imprévisible, faisant de notre destin héroïque, l’expression d’une
ironie, et de l’option la plus profonde, une sorte d’étrange valeur refuge.
Nous plongeons de la sorte dans notre destin comme dans une découverte et
dans un échec. Ainsi, tel grand critique littéraire rêvait d’être historien
ou architecte – plutôt architecte d’ailleurs qu’historien – et pourtant il
n’est devenu que cela : un très grand critique littéraire. Ou
peut-être quelque philosophe dans les profondeurs du temps aspirait à
devenir un second Homère, éventuellement même supérieur au premier – mais
nous ne pouvons être en même temps un autre, et pourtant plus que lui – et
il a fini par échouer sur ce qu’il était en réalité : un très grand
philosophe, doté en plus avec une tenace antipathie à l’encontre des
poètes ! Et pourtant, les vocations multiples ne sont pas
impossibles ; avec la précision que si elles se manifestent dans
l’étroitesse d’un individu et dans le désespoir d’une finitude, elles
deviennent tout aussi désespérément concurrentes, les plus fortes ou,
peut-être, les mieux servies par la politique du hasard ou de l’illusion –
que les Indiens, comme on le sait, appellent māyā – finissant par
vaincre.
Par exemple, l’auteur de ces lignes
et de ces pensées mélancoliques n’a pas eu l’intention de devenir poète, pour
lui, initialement, la poésie étant plutôt un hobby persistant et même un
peu obsessionnel. Poétiquement, il était donc, ce qu’on pourrait appeler un
hobbit. Et pourtant, la même māyā pour laquelle, à la
différence de Mircea Eliade, il n’avait, lui, le moindre respect, qu’il
considérait et la considère toujours comme une irréalité hostile (ce qui,
évidemment, constitue un insupportable paradoxe), l’a poussé avec une sorte
de cynisme vers cette vocation que lui-même ignorait. Autre paradoxe !
Car comment saurions-nous être poussés vers nous-mêmes, tel du bétail dans
l’enclos ? Voilà de quoi ruiner toute conception romantique. Tout
serait-il écrit par avance, pourtant non, comme se l’imaginent les
islamiques, par Dieu, mais par le diable ? Et notre liberté moult
vantée, ne serait-elle que l’amusement d’un destin hostile ? Voilà
aussi ce qui pulvériserait en d’amers sourires notre fameux « libre
arbitre », mais, fait consolant, notre responsabilité morale
également. En effet, si le mal nous écrit – vers le bien ou vers le mal –
cela veut dire que nous ne sommes libres qu’en commettant le destin pré-écrit,
qu’il n’existe donc pas de libre arbitre – libre arbitre identique
d’ailleurs, à une analyse attentive, au péché originaire – mais seulement
le libre arbitraire, patrie sans bornes de tous les crimes et tous
les abus. Raison supplémentaire pour aspirer à la déstructuration de tous
les dogmes de l’illusion (car, bien entendu, l’illusion est dogmatique).
Alors, si en partageant le paradoxe
structurel de la langue, la poésie – qui n’est qu’un genre hétérodoxe de la
métaphysique – s’avère simultanément, bien que non concomitamment,
synchronique et diachronique, le volume de poésie, lui, comme
document par le moyen duquel le poète des souterraines devient personne
publique (non acceptée ou acceptée, et en quelle mesure, ou selon quels
critères, c’est une toute autre question), représente une sorte de
chronographie intime par laquelle la trajectoire d’une conscience se
retrouve et se dévoile.
La mise du volume ne se résume donc
pas à un projet euristique et esthétique par lequel le poète, en fonction
de son génie et ingénie, court-circuite éventuellement les consciences par
une électricité de signes, qui n’est au fond que la négation même comme
surprise, mais risque de vouloir dire autre chose aussi : une sorte de
bilan personnel, une voie bizarre faite de ratés qui l’a conduit d’une
certaine manière dans un nulle-part de toutes les interrogations ; non
le dévoilement mais la trahison d’une anabase agonique qui s’est effectuée
en partie à son insu, d’une montée faite d’obstacles, une ascension de
dépressions qui ne s’accomplit qu’en en acceptant comme unique sens
l’inutilité. Une inutilité insondable.
 Car qu’est-t-il de plus inutile que
l’échelle qu’on a montée – échelle dont il faut inévitablement se séparer,
comme il faut se séparer à un moment donné de soi-même. Étrangers – mais
libres et seuls – nous nous laissons alors embrasser par le néant que nous
sourions. Car qu’est-t-il de plus inutile que
l’échelle qu’on a montée – échelle dont il faut inévitablement se séparer,
comme il faut se séparer à un moment donné de soi-même. Étrangers – mais
libres et seuls – nous nous laissons alors embrasser par le néant que nous
sourions.
|