|
Le
Sahara
Pourquoi le Sahara ?
Quand
on posait la question à Eva, elle pensait au tableau.
Au
tableau du Sahara qui ornait l’affiche d’une exposition sur les peintres orientalistes.
Elle l’avait longuement regardé alors qu’elle attendait Antoine devant le
musée d’Orsay.
« Tu
comptais amener Antoine dans un musée ? » avait ironisé
Joséphine, lorsqu’elle lui avait appris l’anecdote.
Tout
le monde savait que les plaisirs d’Antoine se situaient ailleurs.
Eva
se rappelait très bien la photo du tableau qui l’avait interpellée,
happée. L’arrivée d’Antoine avait brusquement rompu le charme.
Elle
s’était alors promis de retourner au musée, de retrouver le tableau. Et ne
l’avait jamais fait.
C’était
ce jour-là que Joséphine avait décidé : « Mais la voilà, notre
destination : le Sahara »
Eva,
avant d’acquiescer, avait pensé qu’elle allait, d’une certaine manière,
rentrer dans un tableau aperçu par hasard.
L’affaire
fut vite conclue : il avait déjà été décidé, peu de temps auparavant,
qu’elles avaient besoin de partir quelques jours- pour une parenthèse –
disaient elles.
À
Tamanrasset, ce furent leurs vies d’avant qui furent tout de suite mises
entre parenthèses.
Leur
présent désormais était envahi de chaleur, de poussière et de
couleurs : de l’ocre des murets, au bleu du ciel en passant par les
noirs des robes des femmes.
Et
par les silhouettes fugitives des Touaregs se faufilant dans les ruelles
étroites.
À
l’arrivée, Ahmed, leur chauffeur, les attendait. Il n’était pas seul, deux
garçons et deux filles l’accompagnaient : un jeune couple, plus
Fabien et Marie, deux amis. Le 4*4 était déjà prêt, chargé de tout son
barda : jerricans, tentes et provisions.
Les
kilomètres s’étaient étirés sur les pistes tracées au milieu de
roches, de cailloux, de dunes de sable : l’Assekrem, l’ermitage du père de Foucauld, In Salah, le
plateau du Tademaït…
Et
partout la même magie : l’étendue à perte de vue, le silence, la
chaleur. La sensation de l’infini et de l’éternité. L’implacable certitude
d’en faire partie.
Et,
sous les doigts comme sur la peau, les vibrations silencieuses de l’air.
Ils
croisèrent parfois quelques Touaregs et leurs chameaux et partagèrent avec
eux l’eau d’un puits, au milieu de nulle part.
Avec
quelques sourires, quelques gestes, mais sans parole.
À
El Goléa, Eva avait changé de tente. Et changé sa
place contre celle de Marie.
A
Ghardaïa l’histoire était entendue : elle ne retournerait pas avec
Antoine, ni même à Paris.
Finalement
elle était passée des tableaux orientalistes aux tableaux de Cézanne.
Fabien
habitait dans le Sud près de la montagne Sainte-Victoire. Il avait déjà
décrit à Eva l’odeur des pins, les fleurs des amandiers au printemps et les
couleurs des ciels en automne.
Sans
oublier l’odeur des ruchers quand il s’occupait de ses abeilles.

Gustave Guillaumet, Laghouat,
Sahara algérien, 1879 (Musée d’Orsay, Paris)
***
Le
gardien de musée
Il
habitait dans mon quartier et j’avais pris l’habitude de le croiser à la
boulangerie. Nous avions fini par nous saluer, en voisins.
J’avais
des horaires capricieux mais, lui semblait opposer au temps une rigueur
implacable : je ne le croisais que si je me levais assez tôt pour être
à la boulangerie à 8 heures tapantes.
C’était
devenu un jeu, et j’y pensais parfois en entendant sonner mon réveil.
Muriel
avait rigolé lorsque je lui avais raconté mes rendez-vous boulangers
« J’espère
qu’il est beau gosse ? »
« Euh !
peut-être l’a-t-il été… Autrefois... ».
« Tu
veux dire... Il a plus de 40 ans ? »
« Tu
peux en ajouter 30 de plus… »
Bien
sûr, elle a ri jusqu’à s’en étouffer.
J’habitais
alors dans une chambre de bonne et j’essayais de finir avec peine quelques
études littéraires. J’avais des amis, quelques amours et des examens en
vue.
Mais
j’étais intriguée par la densité de cet homme, sa silhouette massive, son
pas lent, contredits par le regard rapide, incisif ; Aussi, chaque
fois que je le croisais, je ne pouvais m’empêcher d’imaginer sa vie.
Peut-être,
depuis des années, rentrait-il chaque soir dans un petit appartement
vieillot où sa défunte femme avait laissé quelques napperons sous des
plantes séchées. Auprès de quelque
compagne de passage ? Ou bien avec sa vieille mère ?
Mais
son regard ouvrait d’autres pistes.
« Celle
d’un serial killer », avait ironisé Muriel.
Un
jour où je le croisai une fois de plus devant la boulangerie, je crois,
qu’en entrant, j’ai volontairement laissé la porte se refermer sur lui.
Sûrement pour provoquer une réaction.
Je
n’ai pu m’empêcher de rougir quand j’ai vu son demi sourire.
La
boulangère s’est retournée :
«
Pas de mal monsieur Dippel ? Toujours le pied marin hein ? »
Je
me suis excusée sous son regard amusé mais je n’ai pu m’empêcher de relever
les paroles :
« Vous
êtes marin ? »
C’est
elle qui a renchéri « et comment donc !... il a longtemps vécu
sur un bateau, hiver comme été… »
Lui
s’est contenté d’un sourire et est reparti, sa baguette sous le bras.
Désormais
lorsque je le croisais, j’arrivais à lui arracher quelques mots, à partir
desquels je lui inventais, plus que jamais, des vies au bout du monde -
dûment encouragée par les bavardages de la boulangère.
Le
bateau m’avait ouvert mille horizons : Une péniche en eau calme ?
Un tanker dans le canal de Panama ? Ou un paquebot en
Méditerranée ?
C’est
finalement la boulangère qui, au milieu d’un flot de paroles, a tranché le
débat « il a longtemps passé sa vie sur des cargos à arpenter toutes
les mers du monde… jusqu’à… »
Bien
sûr, je ne me suis pas contentée de ses points de suspension et, à ma
demande, elle a fini sa phrase :
« Jusqu’à
la mort de son fils… mort à vingt ans... noyé… »
Quelques
jours plus tard, alors qu’un ami de passage m’avait entraînée au musée de
la ville, je me suis arrêtée dès l’entrée, sidérée.
Il
était là mon voisin-marin, assis, un livre à la main. Gardien de musée.
Je
lui avais prêté mille vies et il en avait encore une autre.
En
m’apercevant, il me fit un clin d’œil, et reprit sa lecture.
À
la fin de notre visite, il vint vers moi :
« Vous
avez été étonnée n’est-ce-pas ? Et pourtant, c’est seul endroit
où j’ai pu retrouver un peu de calme après la mort de mon fils. A seulement
rester là, immobile, au milieu de toutes ces traces humaines, tous leurs
échos. »
Il
avait bourlingué sur tous les océans, avait connu toutes les escales, les
ports, leurs bars, leurs filles.
Mais
lorsqu’ il avait été blessé –irrémédiablement- il était venu s’asseoir au
milieu de tableaux peints par d’autres hommes et d’autres femmes. En
d’autres temps. En d’autres lieux.
Ultime
escale qui les résumait toutes.
Et
il a conclu avant de regagner sa place :
« Regardez
bien : il y a dans ces tableaux tous les éclats de nos vies ».
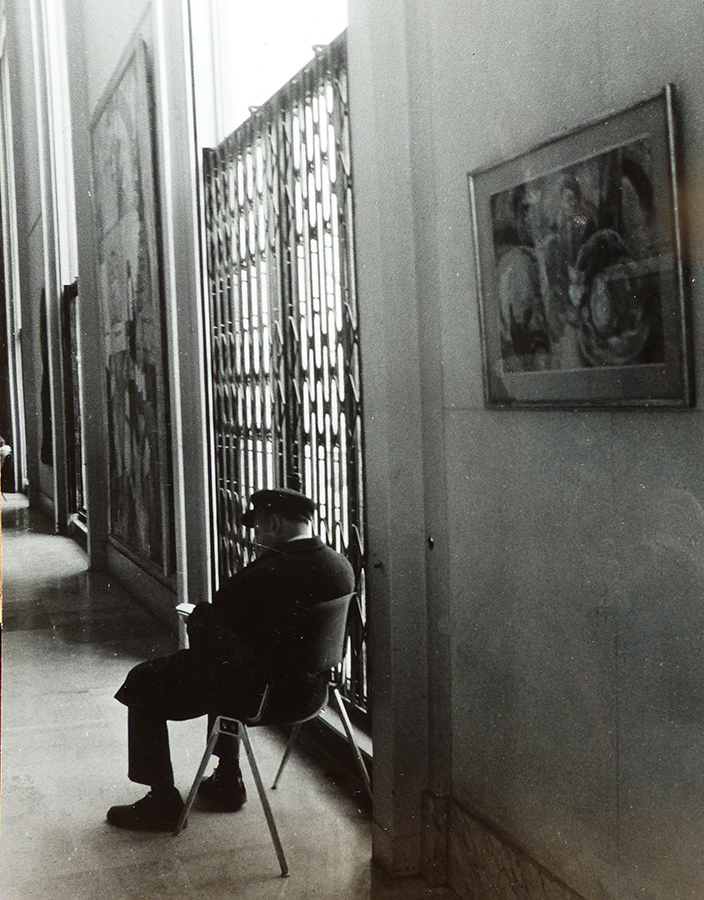
Claude Ivert,
Le gardien du musée (photographie)
***
La
voisine
Elle
était immobile sur le perron de la maison familiale.
La
robe était courte et seyante, la silhouette fine, et ses longs cheveux
blonds étaient à moitié cachés par un chapeau de paille.
Son
visage était tourné vers la rue.
C’était
l’heure de la sieste : plus rien ne bougeait dans le village.
Aucune
voiture, aucun passant : la chaleur recouvrait tout, interdisait le
moindre mouvement, le moindre bruit.
De
ma fenêtre, j’avais l’impression que la vie s’était arrêtée sur l’image.
Elle
était là debout, ne bougeait pas, ne manifestait aucun signe d’impatience.
Un
tout petit moment qui avait un goût d’éternité et qui s’étirait,
s’allongeait, envahissait l’espace.
La
moiteur de l’été rajoutait à l’immobilité de la scène.
Attendait-elle
un ami ? Des amis ? La promesse d’un amour ? D’une
aventure ?
Elle ne manifestait aucun signe de
fébrilité.
Peut-être
trop certaine du rendez-vous prévu. Aucune trace d’inquiétude sur de
potentielles promesses non tenues. Aucun doute.
Elle
attendait.
Cinq
minutes, un quart d’heure, une demi-heure. Nous étions maintenant deux à
attendre.
Elle
fit quelques pas, reprit la pose au bas des marches, la main posée sur un
muret.
À
aucun moment elle n’avait regardé sa montre.
Mais
depuis qu’elle avait bougé, c’était moi maintenant qui m’impatientait.
Peut-être
son téléphone avait-il sonné, j’étais, de toutes façons, trop loin pour
l’entendre : Mais je la vis chercher quelque chose dans la poche de sa
robe, sortir son portable, le regarder rapidement avant de le remettre à sa
place.
Sans
réaction visible.
Il
faut dire que, de ma fenêtre, je ne pouvais distinguer clairement les
traits de son visage.
Je
sus cependant – à ce moment là – que l’attente était finie. Quelle qu’en
ait été l’issue : un report, une annulation, un adieu…
Et
effectivement en un mouvement brusque, elle tourna le dos à la rue et rentra dans la maison.
Le
texto avait peut-être été anodin ou brutal, Il avait peut-être changé sa
vie ou réglé une affaire banale.
Mais
je ne pouvais m’empêcher de penser qu’elle s’était juste échappée, pour
quelques instants, d’un tableau peint en Amérique il y a plusieurs dizaines
d’années. Par un peintre nommé Edward Hopper.
©Alice
Bernat
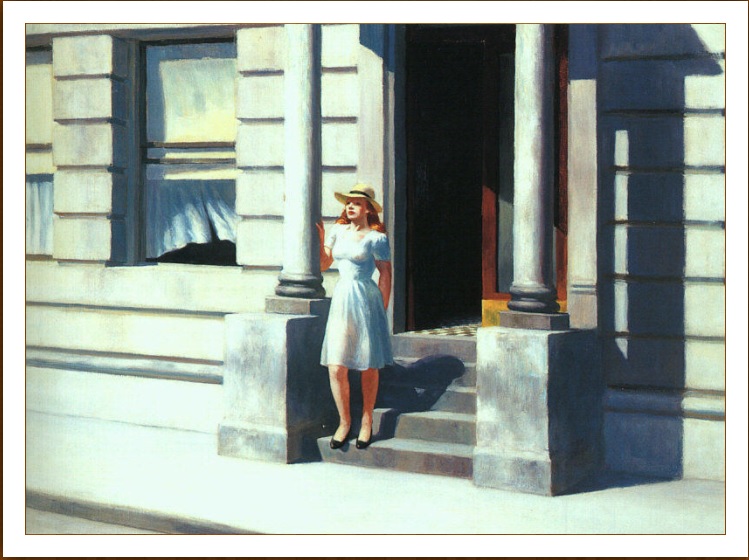
Edward Hopper, Été, huile 1093 (Delaware
Art Museum – Wilmington, reproduit d’après le site wahooart.com)
|