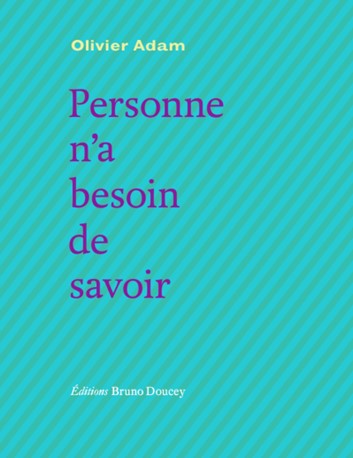|
LECTURE - CHRONIQUE Revues papier ou
électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |
|
|
LECTURES – CHRONIQUES – ESSAIS Septembre-octobre 2023 Olivier Adam : Personne n’a besoin
de savoir. Éditions Bruno Doucey, août 2023, 123 p. 15€ Lecture par Dominique Zinenberg |
|
L’art de dire et de taire Personne n’a besoin de savoir est un recueil qui joue avec ce que
Louis Aragon a appelé « le mentir vrai ». Quelque chose est
affirmé, raconté, énuméré tout au long d’un poème - et le lecteur y croit,
car pourquoi ne croirait-il pas à ce qui est décrit, affirmé, loué, regretté
etc. -, mais il arrive toujours un moment où le narrateur-poète
« déconstruit » (selon le langage de Derrida) ce qu’il a lui-même
mis en place et soutenu. À la toute fin du poème, la vérité vacille, tout ce
qui s’est ouvert – un paysage, un souvenir, un état d’esprit – s’effondre,
est nié ou tout au moins devient incertain, est mis en doute, n’a pas eu lieu
ainsi, n’est plus qu’un langage codé auquel seule l’intéressée, la
destinataire du poème aura accès. « Il y avait un chien ou pas et le taxi sur les graviers ça aussi je l’ai inventé ? »
(p.37) Olivier Adam aime à frustrer son
lecteur, à lui faire comprendre que les mots sont des leurres, que l’art
d’écrire est sans doute aussi de la duplicité, de la capacité à faire croire
quelque chose qui n’est probablement pas la vérité, que tout est fiction, que
les souvenirs, les émois sont reconstruits, sujets à caution, illusoires,
improbables ou vertigineusement peu sûrs. « chacun
sait que je joue faux qu’il ne faut pas s’y fier que tout est calculé répété mal restitué » (p.90) La plupart des poèmes du recueil
offrent un travail de déréliction, un travail de sape, une mise à mort de
l’idéalisation, du poétique, du lyrisme. « tu
voudrais tout retenir et tout me file entre les doigts comme le sable des sabliers les souvenirs ou l’enfance mais ne crois pas que je m’en foute bien sûr que j’ai des regrets tout ce que j’ai perdu j’aurai dû mieux le ranger il faudrait tout classer épingler graver dans le marbre (mais j’ai
tout inventé) » (p.
25) Que reste-t-il du poème quand le
poète vide ses poèmes de tout ce qui, d’ordinaire, remplit la poésie ? Il reste une forme, une mise en page
qui dit clairement : « je suis en train de lire un poème avec le
passage à la ligne qui ne ressemble pas à celui de la prose, avec les espaces
qui séparent une strophe d’une autre ». N’y a-t-il vraiment que cela ? Olivier Adam, avec ce recueil,
publie pour la première fois de la poésie ; habituellement il écrit des
romans. Et l’on n’est donc pas étonné que le recueil tout entier ressemble à
de l’autofiction avec en corollaire son déni (« mais j’ai tout
inventé »), que les poèmes sont très souvent narratifs, qu’ils
retracent l’enfance, l’adolescence du narrateur et de sa fratrie, qu’on y
trouve pêle-mêle des sorties ou vacances avec les parents, des promenades
avec le grand-père comme dans le poème « La forêt » (p.45), des
moments de vie scolaire, de vie à Nantes dans un quartier populaire, des
rappels musicaux, sportifs ou littéraires (un des poèmes par exemple
s’appelle »Modiano »p.27), un sentiment d’ennui,
d’indifférenciation, de vague frustration. Comme dans un roman, le je
peu à peu se dessine. Un je qui se dénigre, prend un malin plaisir à
se saisir comme quelqu’un de morose, qui n’est jamais content, qui ne sourit
pas, qui, à l’adolescence s’habille toujours en noir, qui est perçu comme
prétentieux (un des poèmes s’intitule « Pour qui je me prends », p.
113) : « te
souviens-tu seulement du jour où tu as décidé d’être triste du jour où tu as décidé d’endosser ce costume d’accueillir le chien jaune la hyène le yack de leur laisser toute la place te souviens-tu seulement du jour où tu as décidé de jouer ce rôle et du moment où cette écorce est devenue ta propre peau par accoutumance ou parce que tu avais imaginé un jour que ça te donnerait l’air intéressant tu t’es infecté toi-même tu t’es inoculé ton propre malheur à force de te scruter à force de creuser ta propre tombe de papier quand vas-tu enfin passer à autre chose (mais il
est trop tard Depuis si longtemps déjà) » (p.51-54) On voit bien dans ce poème appelé
« La complaisance » que le poète cerne le je du protagoniste
du recueil comme celui d’un personnage avec lequel il entretient sans doute,
mais est-ce si sûr que cela, un lien de parenté. N’entend-on pas à côté de la
voix du narrateur qui semble déplorer la mentalité de son personnage ou de
lui-même jouant un personnage, la voix de ceux qui lui ont fait maintes fois
ce reproche d’inauthenticité, de comédien ? Et ne sent-on pas par la
même occasion l’idée que l’écrivain, le poète ne peuvent faire autrement que
« creuser leur tombe de papier » et que c’est toujours déjà trop
tard pour changer de destin ? Autour du je évoluent des
personnages secondaires : les parents, les frères, les grands-parents,
la femme aimée par laquelle s’ouvre et se ferme le recueil. Comme dans « Zone » de
Guillaume Apollinaire, le pronom tu fonctionne comme une projection du
moi, un double à qui l’on s’adresse, sauf bien sûr dans le poème liminaire et
le poème final où le tu est clairement adressé, dédié à la femme
aimée. Un récit troué s’élabore, discret,
larvé, mais bien qu’en sourdine, il tend sa trame du début à la fin du
recueil. Les poèmes retracent des épisodes qui ressemblent par endroits aux Années
d’Annie Ernaux et aussi aux romans de Nicolas Mathieu par leur réalisme,
par l’impression de désœuvrement, de non-singularité, de monotonie et
Olivier Adam en rend compte par de longues vagues d’énumérations qui
pourraient ne pas prendre fin, qui s’étendent, prolifèrent, saturant le poème
d’impressions tristes, d’un spleen sans grandeur : « centre-ville
endormi deux ou trois boutiques le marché couvert un bar-tabac PMU plus loin l’école la cour et le préau plus haut le collège les tennis au loin les tours les pelouses défoncées guetto-blasters cages d’escalier puis la forêt les pneus dans la terre cliquetis du dérailleur sous les grands arbres des sous-bois silencieux » (extrait de « Trinité » p.
61-67) Narration, cadre, personnages et un
certain climat et le tout non pas décliné en chapitres mais en poèmes qui
permettent de couper court, de se passer de liens narratifs (que le roman
rend quasi incontournables) ce qui creuse le mystère, agrandit l’espace
imaginaire des lecteurs, laisse à chacun le soin de combler les vides, de
superposer ses propres souvenirs à l’aune de ceux distillés dans les poèmes. Et pour en revenir à la forme
spécifique du poème, au fait que ce que l’on découvre dans le recueil est bel
et bien de la matière poétique et non un roman déguisé, on ajoutera que
chaque poème se suffit à lui-même, qu’il est entité ou cadre unique, fresque
ou tableau, avec souvent son premier vers qui devient leitmotiv, fait
ritournelle, crée un rythme propre et donne le la du poème. Il en est ainsi
du premier poème qui donne son titre au recueil et dont le premier vers
« personne n’a besoin de savoir » revient cinq fois et reviendra
deux fois dans la reprise finale, tandis que dans ce même dernier poème ce
qui fait antienne sera la formule « ça reste entre nous »
reproduite cinq fois là encore. On trouvera dans « Trinité » le
vers inaugural « je n’en reviens pas » qui sera redonné sept fois,
créant un effet lancinant, obsédant proche de la chanson, renforcé par le
deuxième vers qui revient lui aussi dans le poème « je n’en suis pas
revenu ». Parfois comme dans
« Alsace blues » la plupart des strophes commencent par
« on » plus un verbe à l’imparfait itératif suggérant la
répétition année après année du même rituel des vacances. Il peut y avoir
alternance entre deux formules : « À présent/ maintenant ».
Cette technique du rappel du même a un fort pouvoir d’envoûtement sur le
lecteur. Il s’unit, dans la subtilité poétique aux contrastes entre les
énumérations à teneur réaliste et fortement prosaïques avec, l’accès à
quelque chose d’élégiaque à quoi on n’était plus préparé et qui fait tout à
coup rêver : « je n’en
reviens pas je n’en suis pas revenu pas encore des sentiers en plein ciel de la lande et des genêts mûriers perce-pierres champs de bruyère vallées de fougères et l’eau qui bat en contrebas accueille la lumière variable zinc aluminium ou bleu crème turquoise émeraude » (p.64-65) De la même façon c’est tout un art,
tout un charme poétique que de faire vaciller le réel, de placer un filtre,
de faire jaunir les photos, faire peser un doute sur le vécu, faire ressentir
la part fantasmée de l’existence comme si le passé que l’on tente de recréer
tenait plus du rêve que de la réalité, plus de la fiction que du réel, et
qu’ainsi tombé dans l’abîme du temps, il ne pouvait plus être qu’une réalité
floue, invérifiable et d’autant plus incertaine que d’autres ne s’en
souviennent pas de la même façon ou pas du tout. Et enfin, malgré le désenchantement,
la déréliction à l’œuvre, il y a l’amour, en arrière-plan pour la famille et
au premier-plan, quoique discrètement, l’amour pour celle à qui s’adresse le
premier et le dernier poème. Cette boucle bouclée, amoureuse, érotise
l’ensemble du recueil, avec pudeur, clandestinement et réussit à créer cette
aura mystérieuse de l’intimité où lire comme aimer « ça reste entre
nous ». ©Dominique Zinenberg |
Note de lecture de
Dominique Zinenberg
Francopolis, septembre-octobre 2023
Créé le 1 mars 2002