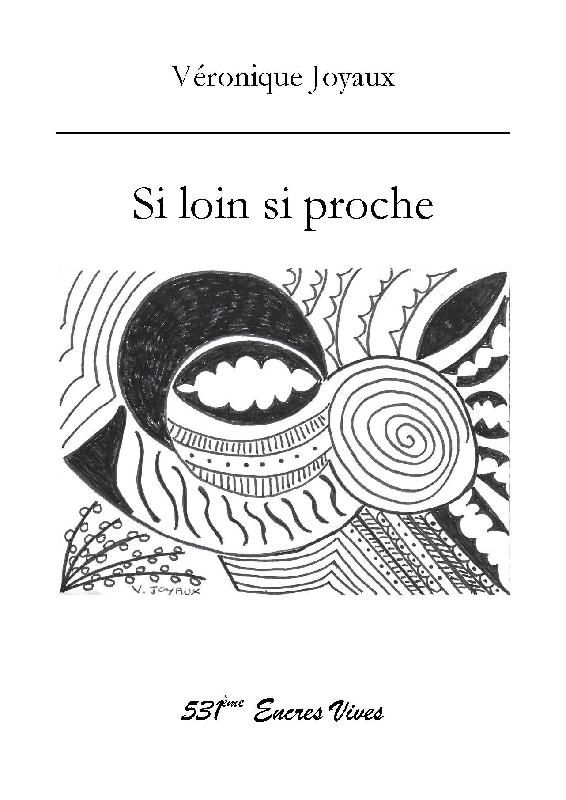|
LECTURE - CHRONIQUE Revues papier ou
électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |
|
|
LECTURES – CHRONIQUES – ESSAIS Été 2024 Véronique
Joyaux : Éditions Encres Vives, 2024 (32 p., 6,60 €) Recension par Dominique Zinenberg |
|
Si, dans le titre, il n’y a pas de
virgule, entre « si loin » et « si proche » c’est sans
doute parce que le proche et le lointain sont réversibles, de même que le
dedans et le dehors, qu’il peut même arriver que se confondent le corps et
des éléments du paysage, que le sang qui circule dans les êtres se répande à
l’extérieur, que tout se métamorphose en signes, en retrouvailles, en
effleurements quasi charnels malgré l’absence, malgré le deuil. Comment
retrouver la personne aimée qui s’en est allée ? On la cherche dans la
nature : le ciel, les arbres, la mer, les sentes, la neige, le vent, les
feuilles et au retour de la promenade où l’espace a parlé, l’écriture devient
empreinte qui chasse l’oubli : « Dans la rue des mots / des
oiseaux qui murmurent ton nom. » Écrire reste le seul geste possible pour
maintenir présent ce qui s’est enfui : l’enfance, l’être aimé, les
choses éphémères et précieuses de la vie : « Je recopie ce qui
prend souffle » ou bien la poète comme pour justifier son travail
d’écriture dit : « Que restera-t-il de nous après la mort si ce
ne sont ces mots écrits ? » Si la première partie du recueil
appelé « Vagues toujours » rend compte d’une réalité ambiguë, donc
« vague » qui contient toute la sensualité du désir de l’autre,
alors même qu’il est déjà parti ; la seconde semble avoir intégré le
non-retour ce qui rend la poète plus sensible aux « Instants » qui
épinglent la force du présent et suggèrent cependant la profondeur de la
douleur et du manque. Dans « Vagues toujours »,
il faut que l’autre prenne corps à tout moment de façon fragmentée, mais de
façon concrète sous forme comparative « comme ta peau »,
mais surtout dans l’énumération des parties du corps, de celui qui n’est pas
là, comme de celui qui a « vendangé la grappes de tes mots. » Le
corps comme dispersé dans le paysage se reconstitue par morceaux : peau,
mains, reins, paume, yeux, bras, hanche, visage, voix, doigts, veines etc.
Et pour mieux le faire renaître, pour que la vie le pénètre de nouveau, le
sang se répand dans les pages, dans le paysage, dans les personnifications
multiples qui le convoquent : « Cautérisons la
plaie » ; « Tu marches dans le sang des vignes » ;
« Mon corps demande un peu de bleu pour raviver les veines » ;
« On dirait des arbres qui saignent » ; « les mots
circulent dans les veines couleur de cernes » ; « A voix basse le poème s’étale / flaque de
sang » ; « une étoile de sang » ; « ne
serait-ce qu’une étoile de sang sur ton épaule. » ;
« Reviennent pourtant le sang la sève ». La poète instaure un dialogue où
« je » et « tu » tour à tour se disputent la première
place. Il y a aussi un « nous » qui abolit l’angoisse de la
séparation. Quand c’est le « je » qui intervient c’est que le souci
de trouver la personne en allée force la poète à
recueillir sa présence au dehors : « je n’ai pas besoin de lever
les yeux/ pour savoir qu’un instant tu m’as regardée. » ; elle
dit aussi : « j’ai vendangé la grappe de tes mots. » Quand
c’est le « tu » c’est comme si un échange verbal avait lieu, la
continuation d’un dialogue, le déni de l’interruption du dialogue par la
disparition, le don d’une conversation secrète offerte à l’autre, et aussi
une manière de donner des nouvelles, de tenir l’autre au courant du
quotidien : « Surtout ne pas égarer la page/ Une brèche s’y
ouvre/ Se tenir au flanc du rocher/ et tisser pour toi ce poème. »
Enfin il y a le « nous » qui abolit dans le temps de l’énonciation
la dureté de son impossibilité : « Reçois mon visage comme une
obole/ Cache-moi à l’ombre de ton corps/ là où le mur a ses secrets/ là où
court la flamme incessante/ Au creux de nos draps nos voix se sont tues/
effacées par le sommeil/ demain l’aube sera bienveillante. » La deuxième partie
« Instants » est plus ample que la première (20 pages contre 11
pour « Vagues toujours »). Les dialogues se sont tus.
Désormais le neutre domine même si un « je » parfois se manifeste,
discret, mélancolique, ne déniant plus le deuil : « Soudain je
m’en vais dormir dans l’oubli de tout. » La plupart du temps la
poète lance ses strophes par des infinitifs injonctifs ou des
« on » indéfinis ; parfois par des impératifs à la première
personne du pluriel. Cette forme énonciative permet la mise à distance
anesthésiante du deuil. Ces injonctions sont une manière de lutter contre la
mélancolie, elles dynamisent le texte, deviennent ordre intérieur, impératif
catégorique pour secouer la torpeur du deuil qui freinerait le faire,
l’observation, le lien à la nature et aux humains. Voici un exemple page 13
(début de la seconde partie) : « Mener le jour de l’autre côté du
ciel/ là où les vagues se brisent/ aux premières ondées de septembre/ Écouter
les hêtres bruissant/ les drisses dans le port/ archets du vent/ Monter sur
la digue/ et regarder la mer. » et voici une autre strophe page 28 qui
fonctionne de la même manière : « S’en aller vers la tiédeur du
soir/ Passer sur l’autre rive/ Se perdre sur la route/ Marcher dans les
herbes hautes/ Plonger nu dans les étoiles/ Se frotter à l’écorce des arbres/
reprendre sa place/ Quelques heures s’oublier/ se plier aux sources du
silence/ Se dire que l’on est heureux/ au risque du mensonge. » Une des variantes est l’utilisation de
l’impératif présent qui ne leurre pas le lecteur qui ne l’assimile pas aux
« nous » de la première partie : « Reprenons la phrase
où nous l’avons laissée/ dans le remous des saules/ les pas lourds de la
mémoire/ Glissons-nous là où tout est limpide/ pour que la mort n’ait pas de
prise. » On l’aura compris, à ce stade, la poète ne vit plus son
deuil de la même façon que naguère, elle est dans l’invention d’autres ruses
pour y survivre. Elle aura recours à la force de la mer, et de la nature en
général, aux oiseaux en tant que tels et comme métaphore de son désir de s’évader,
de sortir du carcan de l’angoisse : ils sont plumes, duvet, ailes,
envol. Ils ont nom : moineaux, hirondelle, et même quand on ne les nomme
pas, les oiseaux traversent les strophes, les saisons, les horizons du poème.
Ce qui protège aussi c’est la maison et l’évocation de l’enfance :
garde-fou au spleen trop violent. Ainsi page 17 la poète réunit en une
strophe les thématiques qui adoucissent les jours d’un trop long hiver. Elle
suggère alors la force apaisante du nid, de l’intime : La maison
dort dans la plaine assoupie Elle plonge
ses racines dans le sol aorte vive
volets adossés au vent lueur dans
la nuit trait de
crayon La maison
j’y plonge mes doigts J’y cache
mes tendresses Elle se
dresse tel un phare Un oiseau
de bonne augure Elle brille
dans l’ombre lieu de
l’enfance Ses rideaux
bruissent et se plient La maison
est douce sous la paume comme un édredon de plumes. Le recueil se termine sur une note
d’espoir comme si la vie reprenait ses droits, que le futur redevenait
possible et qu’il fallait continuer d’interroger les élans vitaux, le désir
d’écrire car dit la poète « Nos vies s’allument comme des
lampes ». En tout cas la trajectoire de
douleur, d’épreuves et de courage, à travers ses poèmes à vif, nous émeuvent
par leur sensibilité à fleur de peau, leur sensualité, leur justesse. ©Dominique Zinenberg |
Véronique Joyaux
Lecture par Dominique Zinenberg
Francopolis, Été 2024
Créé le 1 mars 2002