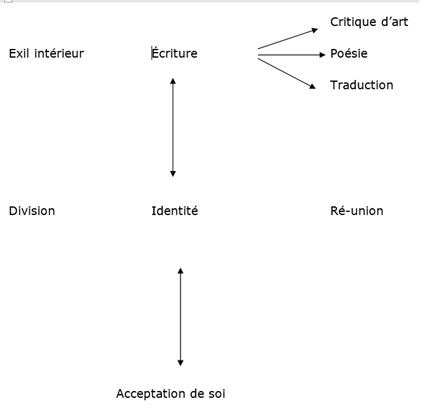|
LECTURE - CHRONIQUE
Revues
papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de
livres... |
|
LECTURES
–CHRONIQUES-ESSAIS
Pascal
Hermouet :
La question du bonheur chez Claude Esteban
|
« Tant pis ! vers le bonheur
d’autres m’entraîneront » Stéphane Mallarmé, L’après-midi d’un faune, 1876 Étudier la place du bonheur dans
quelques œuvres du poète, essayiste, traducteur et critique d’art Claude
Esteban (1935-2006) peut sembler paradoxal de prime abord. En effet, il est
surtout connu pour, d’une part, des écrits liés au deuil, comme c’est le cas
pour le recueil de poèmes Élégie de la mort violente, paru en 1989,
soit trois ans après le décès accidentel de sa compagne Denise Esteban
(1925-1986) et, d’autre part, des textes sur la souffrance et l’approche de
la mort, évoquées dans la série de poèmes en prose Trajet d’une blessure (2006) puis dans le recueil La mort à distance (2006). Claude
Esteban ne serait-il que le poète du malheur, en quelque sorte ? Pourtant,
le poète est un passionné et ses centres d’intérêt sont multiples (peinture
figurative et non-figurative, photographie, cinéma, musique de chambre,
théâtre du dix-septième siècle en Espagne et en Angleterre). Cet intellectuel
à la curiosité insatiable et à l’enthousiasme contagieux aime enseigner la
littérature espagnole à la Sorbonne, voyager (Espagne, Grèce, Iran) ainsi que
faire découvrir des artistes et des écrivains de tous milieux et de toutes
disciplines, en particulier comme fondateur puis comme directeur de la revue Argile (1973-1981). Une
telle énergie est significative d’un appétit de vivre et de
transmettre ; un tel éclectisme mérite qu’on s’y attarde un peu. Le fait
d’analyser la conception du bonheur chez Claude Esteban pourrait peut-être
apporter un nouvel éclairage à la compréhension de ses œuvres, à condition de
trouver quelques axes d’étude. Nous en avons identifié deux, à savoir :
le goût de la contemplation, de la méditation et du retour sur soi (axe
réflexif) ainsi que la recherche d’une dynamique dans l’écriture (axe
poétique). C’est ce que nous nous proposons de développer maintenant. * *
* 1.
Axe réflexif :
de la contemplation du monde au retour sur soi. Dès
ses premières œuvres, Claude Esteban observe et questionne les rapports entre
l’homme et la nature. Il en est ainsi avec des recueils comme La Saison dévastée en 1968 (1)ou Terres, travaux du cœur en 1979 (2). Avec Conjoncture du corps et du jardin,
publié en 1983 (3), le poète proclame son amour de la terre :
« Je mourrai d’avoir trop aimé la terre » (4). La nature
est peu détaillée ; seule compte le passage des saisons, avec comme
repère la « sentinelle soleil » (5). Déjà, l’univers
paraît fragile. Pourtant,
le recueil en prose Janvier, février,
mars, publié en 1999 (6) met en valeur plusieurs petits
bonheurs quotidiens que le narrateur décrit depuis sa fenêtre, à savoir la
vision d’un vieil arbre personnifié (« je voudrais, même aujourd’hui,
être un arbre »), « artisan de l’infime » à la fois noble et
modeste (« Mon honorable voisin »), l’attention portée à des
oiseaux comme le « merle » ou les « moineaux »
(« L’oiseau qui chante la nuit ») ou encore l’émerveillement
ressenti en mars devant « l’éclosion de la première fleur sur le
cerisier » (« L’insaisissable »). L’œuvre en prose s’apparente
à une éphéméride poétique, conçue comme la somme d’impressions fugaces et de
sensations tenaces. Si
on peut parler de contemplation active de la part du narrateur, la communion
avec la nature est encore plus prégnante dans son ultime recueil La mort à distance, paru en 2007 (7),
avec notamment l’évocation d’un « chêne roux, majestueux » que le narrateur
salue avec respect mais aussi effusion : « moi, si pudibond, je
m’enhardissais, et j’effleurais d’une main furtive cette monstrueuse patte
posée là pour toujours sur la pelouse » (8). Il y a ici
l’expression d’un changement avec ce déplacement du narrateur dans un
parc ; d’observateur statique depuis la fenêtre de son appartement comme
dans Janvier, février, mars, il est
maintenant passé au statut de visiteur-acteur qui communique sensoriellement
avec le chêne, d’autant plus que, comme dans « Mon honorable
voisin », l’arbre est personnifié, telle une « personne
mémorable » : « Je croyais pourtant qu’il vieillirait sans
fin » (9). Quand il écrit La
mort à distance, Claude Esteban est alors âgé de soixante-et-onze
ans ; le narrateur-auteur utilise la mémoire comme preuve de fidélité
envers un environnement familier qui disparaît ou qui a déjà disparu, à
l’image de cet arbre déraciné par une tempête : « L’arbre
est intact dans notre mémoire. C’est à nous, maintenant, qu’il appartient de
veiller sur lui, de l’enraciner dans ce temps que nous inventons ensemble » (10). Cette
ouverture au monde favorise également la méditation et le retour sur soi,
avec par exemple le souvenir d’un voyage en Corée ; au cours de son
voyage, l’écrivain visite un monastère isolé, en pleine montagne ; le
temps y est discontinu, non linéaire et suspendu car « il
s’approfondit, se love sur soi-même. Tout semble s’apaiser et ce n’est
pourtant qu’une pause intime » (11). De fait, ce texte est
moins un récit de voyage qu’une réflexion sur les apparences et le sens
à donner à son existence ; il ne comporte pas de nombreuses indications
référentielles, à l’exception de la mention d’un pays asiatique (la Corée,
probablement la Corée du Sud) et d’un cadre naturel indéterminé (une montagne).
L’absence de plus amples détails met en valeur une visée signifiante du
texte, à savoir un dialogue éclairé entre deux amoureux de la solitude, en
l’occurrence ici le narrateur et un moine. En effet, le narrateur fait la
rencontre d’un jeune moine bouddhiste, d’origine canadienne ; l’échange
porte non pas sur la spiritualité bouddhiste mais bien plutôt sur la vie,
illustrée par des « choses simples, des gestes quotidiens, des nuits de
veille, du travail de la terre, bien plus que de prières et de cérémonial »
(12). Le choix du présent de l’indicatif (« il est si
proche », « il me parle », « le jeune homme sourit, je
lui demande son âge, il sourit encore ») (13) quasiment
utilisé du début à la fin de ce texte qui évoque des souvenirs anciens,
souligne la volonté du narrateur d’aller à l’essentiel. Le « travail de
la terre » du moine fait écho au recueil du poète « Terres, travaux
du cœur », déjà mentionné. Dans les deux cas, le bonheur n’est pas
transcendant mais plutôt immanent, modeste et dépouillé. De
plus, la figure même du moine anonyme est signifiante, en tant que reflet
d’un double exil : exil linguistique d’une part car le moine canadien et
francophone connaît, comme Claude Esteban, la problématique des langues et du
bilinguisme ; exil intérieur d’autre part car, dans sa quête d’une voie
spirituelle, le moine s’est abstrait d’une réalité matérielle et profane – de
même, on peut établir un parallèle avec la démarche du poète qui cherche lui
aussi à se détacher des apparences afin de saisir un sens caché du commun des
mortels. Quant au travail, c’est celui de l’artisan, humble menuisier évoqué
dans « Mon honorable voisin » ; le labeur prime, bien avant
tout salaire ou toute récompense. En effet, l’important est d’agir et de
sans cesse remettre son œuvre sur le métier. Cela nous évoque également le
travail poétique d’un autre artisan qui a connu Claude Esteban, à savoir le
poète inspiré mais laïc qu’est René Char (1907-1988), lequel écrit en 1950
dans Rougeur des matinaux (14) :
« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque ». Par
ailleurs, un autre élément entre en jeu comme préalable à tout travail
poétique, dans l’esprit de poètes comme René Char ou Claude Esteban : le
silence, source de paix intérieure. De fait, l’acte poétique nécessite une
ascèse permanente et une concentration renouvelée. Le silence permet
d’établir des conditions favorables à la création, à condition d’être
lui-même désiré et conquis par le poète, comme le rappelle Esteban dans
« Un doigt posé sur la bouche »: « Le
silence n’est pas un don du ciel, c’est pour chacun une conquête. Il est
exclu du temps et de l’espace, et cependant il cherche à y trouver son lieu(15) ». Le
silence créatif a d’autant plus de valeur qu’il est difficile à obtenir et à
conserver. Bien immatériel, il annonce une richesse intérieure mais tangible,
comme le suggère la métaphore de l’abeille « qui butine patiemment son
nectar et le dépose, au soir, dans une ruche invisible » (16). Outre
la contemplation de la nature et un goût pour le silence, la voix poétique
affectionne à plusieurs reprises l’aube ou le petit matin, comme un nouveau
commencement où tout paraît possible, dans un temps en apparence suspendu.
Ainsi par exemple ces vers, extraits du recueil Morceaux de ciel, presque
rien (2001) : « ce sera comme si le matin s'attardait dans une chambre et qu'il
n'y ait plus, tout un instant, ni d'ombre ni de malheur ». De même, on retrouve cette affection intense pour les toutes premières
heures du jour dans les vers suivants, extraits de son anthologie Le jour
à peine écrit : 1967 – 1992 (2006) : « Donnez-moi ce matin, ces heures encore du petit matin quand tout commence donnez-moi, je vous prie, ce mouvement léger des branches, un souffle, rien de plus ». Quoi
qu’il en soit, le bonheur dans l’œuvre de Claude Esteban n’est qu’une
hypothèse, à ce stade de notre réflexion. Il s’agit plus d’une attitude que
d’un concept. Cet état d’esprit positif, s’il est confirmé ultérieurement, ne
peut tout simplement pas se résumer à un lien très fort à la nature ou au
retour sur soi. La question est plus complexe. D’autres éléments sont à
prendre en compte, à commencer par le rapport aux mots, à l’écriture et à la
poésie. 2.
Axe poétique :
synthèse de langues, traductions et projet du Livre. Tout
écrivain développe avec le temps un goût particulier pour les mots. Cet
intérêt pour le mot et cet amour du livre peuvent remonter à l’enfance. C’est
le cas pour Sartre avec son autobiographie Les Mots(17) (1964) ;
c’est aussi le cas pour Claude Esteban avec Le partage des mots, œuvre-clé à mi-chemin entre l’essai et
l’autobiographie linguistique. Dans cet ouvrage, très court (il fait à peine
166 pages), Claude Esteban décrit non pas les joies mais les affres du
bilinguisme, depuis l’indécision et le doute jusqu’à un sentiment
d’inadaptation au monde et d’identité contradictoire (18): « Cette
infirmité (…) était bien, en vérité, au sens forme du terme, une absence de
fermeté que je ressentais tout à la fois dans la consistance du monde et dans
l’emprise verbale que je pouvais avoir sur lui. » (19) De
cette souffrance récurrente perçue durant toute l’enfance et l’adolescence du
narrateur naît pourtant à l’âge adulte, à l’occasion d’une première prise de
poste d’enseignant d’espagnol à Tanger en 1959, une prise de conscience plus
sereine des avantages et des inconvénients de sa situation
« hybride » : « J’ai
compris (…) que le bilinguisme pratiqué durant ma petite enfance avait été à
la fois un moteur et un frein dans mon expérimentation du langage. [ …] Il avait provoqué en moi le besoin
de m’approprier, dans l’une ou l’autre langue, les mots qui me paraissaient
les plus adéquats à évoquer, par leur texture sonore même, la nature et les
qualités propres à tel ou tel objet. Ce désir d’appropriation, je l’avais
poursuivi tout empiriquement, sans me soucier des frontières linguistiques,
ne retenant pour seul critère que cette sensation indéfinissable mais bien
réelle qui fait d’un mot, plus que l’équivalent de la chose, son double,
solide et savoureux, dans la bouche. » (20) De
fait, ce goût sensuel et profond pour les mots va, pour le bilingue qu’est
Claude Esteban, susciter une « révélation » (21) d’ordre
presque mystique, à savoir « une remise en cause des catégories de
l’intelligible, un commerce comme illicite avec l’unité primitive, avec l’âme
inentamée du cosmos » (22). Ce « commerce » et
cette recherche d’unité expliquent sa vocation de créateur et de passeur de
mots. Autrement dit, la jouissance permise par les mots est à l’origine de
son activité de poète mais aussi de traducteur littéraire, sans oublier ses
écrits en tant que critique d’art (23). En effet, l’écriture
estebanienne accorde autant d’importance à sa propre production poétique qu’à
celle d’autres poètes. Dans les deux cas, il s’agit de partager et de faire
partager car l’acte de traduire participe d’une « nécessité
intérieure » (24). Sa traduction d’œuvres du poète mexicain
Octavio Paz (1914-1998) en est un bon exemple, avec notamment le recueil Le singe grammairien (25). Traduit
en français en 1972, soit avant même sa publication en espagnol en 1974, Le singe grammairien (El mono gramático) est une œuvre
atypique et multigénérique, à la fois récit de voyage, essai sur le langage
et poème. Le cadre référentiel est celui de l’Inde rurale du vingtième
siècle, avec l’évocation d’une méditation et d’une marche effectuées par le
narrateur, en route vers Galta, lieu de pèlerinage hindou situé à dix
kilomètres de la ville de Jaipur dans l’état du Rajasthan, au nord-ouest de
l’Inde. Le site de Galta comprend en particulier un temple dédié au
dieu-singe Hanuman, connu dans la mythologie hindoue du Ramayana comme le
singe savant, dieu de la sagesse et seigneur des signes. On connaît la
fascination d’Octavio Paz pour l’Orient et ses cultures (26),
en particulier celle du Japon qu’il visite en 1952 et celle de l’Inde où il
réside de 1962 à 1968 en tant qu’ambassadeur du Mexique. Avec Le singe grammairien, Octavio Paz part
d’une poésie elliptique et centrée sur l’instant présent pour aboutir à un
discours métapoétique : « Il
faut détisser même les phrases les plus simples pour découvrir ce qu’elles
renferment (…) et de quoi et comment elles sont faites (de quoi est fait le
langage et, surtout, est-il fait ou est-il quelque chose qui ne cesse de se
faire ?). Détisser le tissu verbal : la réalité apparaîtra. » (27) Là
est l’enjeu du verbe travaillé par le poète, autre singe savant et
« seigneur/serviteur de la métamorphose universelle » (28) :
il s’agit de percevoir et de traduire une réalité changeante et authentique,
dans un refus de toute transcendance, car « la sagesse ne réside pas
dans la fixité ni dans le changement, mais dans la dialectique qui les relie.
Constant aller et retour : la sagesse est dans l’instantané » (29).
Ce voyage à la fois éphémère et signifiant est celui de l’écriture, signe de
vitalité mais aussi marqueur de finitude : « L’écriture
est une recherche du sens qu’elle-même rejette. À la fin de la quête le sens
se dissipe et nous révèle une réalité proprement insensée. Que
reste-t-il ? Le double mouvement de l’écriture : cheminement vers
le sens, dissipation du sens. Allégorie de la mortalité : ces phrases
que j’écris, ce chemin que j’invente ici pendant que je tente de décrire
l’autre chemin de Galta s’effacent, se défont alors même que je les écris
(…). Il n’y a pas de fin, tout n’a été qu’un perpétuel recommencement. »
(30) Ces
quelques phrases rappellent le concept d’impermanence bouddhique : rien
ne dure et tout évolue sans cesse, non d’un point de vue chronologique mais
plutôt dans une dimension circulaire. Octavio Paz va plus loin, en évoquant à
la fin de son texte la dynamique à l’œuvre dans la poésie : « La
vision de la poésie est celle de la convergence de tous les points. Fin du
chemin. C’est la vision d’Hanumān sautant (geyser)
du fond de la vallée au sommet du mont ou se précipitant (aérolithe) du haut
de l’astre jusqu’au fond de la mer ; vision vertigineuse et transversale
qui révèle l’univers non pas comme une succession, un mouvement, mais comme
une assemblée d’espaces et de temps, une quiétude. La convergence est
quiétude car en son faîte, les différents mouvements, en se confondant,
s’annulent ; en même temps, du haut de cette cime d’immobilité, nous
percevons l’univers comme un ensemble de mondes en rotation. » (31).
Dans
ce passage, on remarque plusieurs substantifs qui renvoient à des concepts
(« convergence », « univers », « assemblée d’espaces
et de temps », « quiétude ») et donc à un champ lié à
l’abstraction, qu’elle soit spatiale (« univers »,
« espaces »), temporelle (« temps ») ou intime
(« quiétude »); on note également l’emploi de participes présents
(« sautant », « se précipitant ») qui soulignent une
action réalisée dans un moment de présent indéterminé. Pour le narrateur, la
spatialité, plusieurs fois soulignée dans des termes soutenus (« astre »,
« aérolithe », « fond de la mer », « faîte »,
« cime »), permet d’accéder à une autre dimension, élevée et
personnelle, « spirituelle » mais laïque. Cette
dimension est attestée par la « quiétude ». Si cette dernière n’est
pas synonyme de bonheur au sens strict du terme, elle réfère néanmoins à un
état de sagesse et de ré-union. Empreint de sérénité et de réconciliation
(avec soi, l’univers et les autres), cet horizon poétique renvoie non
seulement à la quête du sens mais aussi à la quête d’identité, chère à Claude
Esteban. De plus, il souligne une même perception immanente et dépouillée,
commune aux deux poètes, lesquels partagent un intérêt renouvelé pour
l’Orient, sa littérature et son système de croyances, comme par exemple le
bouddhisme (32) et le zen ; il en est de même avec le goût
pour les « haïkus ». En effet, Octavio Paz a traduit le poète zen
Bashô (1644-1694). Quant à Claude Esteban, il a traduit les 17 haïkus de Borges, publiés dans le
recueil de poèmes Le chiffre (La cifra, 1981) (33);
enfin, Esteban choisit d’employer le terme d’ « écorces » au
lieu du mot japonais « haïku » pour qualifier quelques-uns de ses
derniers poèmes, très brefs (34). D’emblée,
on ne peut qu’être frappé par les deux derniers recueils de poèmes en prose
de Claude Esteban, aux titres sobres mais signifiants, qu’il s’agisse de Morceaux de ciel, presque rien (2001) (35)
ou de La mort à distance, publié à
titre posthume en 2007. Généralement considéré comme le livre-testament de
Claude Esteban, on peut lire La mort à
distance comme le court récit autobiographique d’une longue journée
découpée en cinq parties, en partant d’un soir (« Une journée déjà
vieille ») pour arriver finalement à l’aube (« Au matin »).
Tantôt courts, tantôt longs ou semi-longs, les poèmes, souvent denses, font
rarement plus d’une page, ce qui donne au recueil un rythme nerveux, voire
accéléré : pour le narrateur, le temps presse, car le décompte final a
commencé... Pourtant, comme chez Octavio Paz, on retrouve chez le traducteur
du Singe grammairien l’expression
inchangée d’un émerveillement devant le mystère du monde (voir par exemple
cette ouverture dépouillée : « Elle est sublime, la petitesse / d’une
goutte de rosée ») (36), qui s’accompagne d’une acceptation
sereine de la vie et de la fin de vie : « C’est la fin des querelles
entre la chair et l’âme » (37). L’humilité
naturelle du poète se voit renforcée dans La mort à distance, avec ces
vers à la fois lucides et brûlants, où le bonheur serait fait de choses
simples mais pourtant essentielles :
Donnez-moi, je vous prie, ce que je refusais hier, un rayon de soleil, un
regard, quand j'étais riche. Enfin,
le poète met en valeur l’idée d’un livre ultime, à la fois passé et à venir
mais surtout ouvert à tous : « On
ne sait rien de ce livre, sinon qu’il fut écrit dans une langue inconnue et
c’est dans cette langue qu’il faudrait le lire (…). Les phrases qu’on y
découvre sont à la fois les plus simples et les plus obscures, les plus
pauvres d’enseignement et les plus riches de sens. On y parle de trésors
cachés, de lampes dans la nuit, de sources vives. On y pénètre sans crainte,
ainsi que dans une maison amie. On s’y repose, on a derechef tout l’avenir
devant soi, on y retrouve la saveur des choses. Ce livre n’appartient à
personne, et chacun peut le prendre et le faire sien. » (38) La
temporalité dans cet extrait de clôture de la partie éponyme (la seconde) de
l’œuvre est significative : après un présent introducteur (« On ne
sait »), la phrase bascule sans transition dans un passé révolu
(« il fut écrit ») pour mieux revenir dans la même phrase à un
présent de définition et d’exposition d’un nouvel environnement accueillant
(« C’est », « On y parle », « On s’y repose »).
De plus, l’alternance des adjectifs « simples »/ « obscures »
d’une part et « pauvres »/ « riches » d’autre part
souligne l’amplitude signifiante du texte évoqué, lequel convoque un
environnement à la fois matériel (« lampes »,
« sources ») et immatériel (« langue inconnue »,
« phrases »). La référence énigmatique au livre (« ce
livre ») renvoie au projet de Livre total de Mallarmé(39); en
effet, la tension esthétique recherchée par le maître des Mardis de la rue de
Rome est celle d’une économie de moyens mise au service d’une continuelle
recherche de l’unité dans les lettres et dans les arts, gage de vérité. De même,
avec la mention d’un livre destiné à « ceux qui ne désespèrent pas de la
beauté du monde » (40), Claude Esteban semble manifester le
désir d’en finir avec son exil intérieur et de (littéralement) tourner la
page en s’ouvrant encore davantage au lecteur dans son altérité et sa
diversité. * *
* Comme
on vient de s’en rendre compte, la question d’un livre inconnu, à la fois
révolu et à venir, n’est pas anecdotique du point de vue de la poétique de
Claude Esteban. Le poète privilégie un présent instantané et un futur
immédiat. Son œuvre s’inscrit non dans un ressassement stérile, source de
confusion, mais bien plutôt dans un renouvellement créatif et tourné vers
autrui. On retrouve ici la dimension généreuse du passeur. Cependant, si Claude Esteban n’est pas le poète du
malheur, il n’est pas pour autant le poète du bonheur au sens plein du terme.
Il se situe plutôt dans un espace à la fois immanent(41) et
indéterminé, fragile et variable, entre ombre et lumière. Là
réside selon nous l’originalité d’une poésie inclassable, subtilement marquée
par la recherche formelle, une écriture en mouvement et la quête
d’authenticité, comme chez Mallarmé ou, plus près de nous, Octavio Paz. Le
poète ne réussit pas à atteindre l’étoile d’un
« bonheur » fugace ; pourtant, il s’en approche pour, peu à
peu, assimiler une certaine sagesse nourrie
par l’ « harmonie » et l’ « immédiateté de
l’instant », comme il l’écrit dans Los
pícaros en Arcadia (Les gueux en
Arcadie), à l’occasion d’une conférence donnée en espagnol à la Casa de
Velázquez en
mai 1999 et avec pour thème le commentaire du tableau de Velázquez El triunfo de Baco o Los Borrachos (Le triomphe de Bacchus ou Les Ivrognes, 1628-1629, Musée du
Prado) : Pues estamos, no
lo olvidemos, en Arcadia, el paraje fabuloso donde todos los conflictos se
deshacen, donde la armonía, aun reducida a sus elementos más simples, se
impone. Y que existan allí borrachos, ladrones sin duda, quizás asesinos a
sueldo – ¿por qué esa nefasta espada a la cintura del
soldado? –, no entraña consecuencias. (…) No pongamos cara de ofuscarnos. Et
in Arcadia ego, la célebre frase está apenas formulada (…) y, claro, recuerdo
el cuadro de Poussin, para enunciar una idea nueva, a saber, que la muerte no
viene a oponerse a la existencia sobre la tumba, que es posible y
deseable vivir en la inmediatez del instante.Y que esa cohorte de mendigos,
esos pícaros, si se les quiere llamar así, participan de una suerte de
sabiduría. (42) La
mention de l’Arcadie est signifiante, dans la mesure où cette région grecque
située en plein Péloponnèse est aussi pour des poètes de l’Antiquité comme
Virgile dans Les Bucoliques ou
Ovide dans Les Fastes une contrée
mythique, à la fois sauvage et idyllique, seulement peuplée par des bergers
vivant en communion avec la nature ; à cet égard, le tableau de Nicolas
Poussin auquel Claude Esteban fait allusion s’intitule justement Les bergers d’Arcadie (1637-1638,
musée du Louvre). Du point de vue de la mythologie antique gréco-latine et de
la peinture classique européenne, l’Arcadie serait donc le lieu du bonheur et
de la sérénité (« donde la armonía, aun reducida a sus elementos más simples,
se impone »), mais aussi, pour Claude Esteban, celui d’un dépassement de
l’idée de finitude (« la muerte no viene a oponerse a la existencia
sobre la tumba ») ; à cet égard, la finitude est concrète avec
l’emploi du présent de l’indicatif (« viene »), tout comme elle est
niée de par l’emploi de la forme négative (« no viene a
oponerse »). Pétri d’humanités classiques, Claude Esteban semble voir
dans le tableau de Velázquez
non seulement la représentation de l’Arcadie mais également, dans une
perception plus moderne, le signe d’une fraternité très concrète, bien
qu’atypique (les dieux se mêlant à de simples mortels), « como si fuera
posible entenderse, con medias palabras, sobre los valores simples de la
vida » (43). De
plus, comme on l’imagine, la référence à la Grèce antique est tout sauf
fortuite chez Esteban. Pour le poète, elle renvoie aux charmes d’une culture
disparue mais qui persiste grâce à l’élan de la raison et du logos ; on pense notamment au
titre de son essai Critique de la
raison poétique (1987) (44), où il analyse brièvement
l’évolution de la poésie, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Pour l’auteur des Gueux en Arcadie, les dieux, bien
qu’ils soient morts depuis longtemps(45), ont néanmoins transmis à
l’homme le goût de la beauté et la recherche de la sérénité dans l’instant
présent, en particulier grâce aux ressources offertes par les sens, l’art et
les mots. Autrement dit, si le bonheur est peut-être irrémédiablement perdu,
il en reste pourtant une indicible saveur qui pousse l’homme, bien que se
sachant mortel, à continuer sa quête. L’œuvre estebanienne reflète ce désir
de vie dans une trajectoire de plus en plus épurée et incisive, à l’image de
la clôture de son texte D’une couleur
qui fut donnée à la mer (1997), brillante réflexion sur le pouvoir du
langage et de la poésie, en l’occurrence ici celle de l’Odyssée : « De
ces alliances, de ces connivences ombreuses du sens et des sens, il se peut
que nous ne voulions rien entendre dans notre hâte à nous croire neufs, sans
attaches avec la durée et le lent parcours de la langue. Mais qu’un seul
vers, et pourquoi pas celui qui m’habite depuis si longtemps, surgisse à
l’improviste dans la mémoire, (…) voilà que la langue se souvient, qu’elle
chasse le marmonnement des phrases vaines, qu’elle retrouve cet instant où
dans l’éclat matinal de la lumière, elle célébrait la mer couleur de vin. Et
c’est alors qu’une fraîcheur nous enlève (…) et, tel Ulysse, le vieux
voyageur, découvrant Nausicaa sur la rive, nous pressentons que le monde n’a
pas fini de naître, et que les mots, les mots d’un poème, peuvent le dire
encore. » (46) Annexe
1. Le triomphe de Bacchus ou Les Ivrognes
(Los Borrachos
o el triunfo de Baco), 1628-1629, Diego Velázquez (Musée du Prado). Source : Wikimedia Commons. Annexe
2. L’œuvre
estebanienne, entre expression du malheur et quête d’une sagesse : représentation spatiale de quelques
mots-clés comme axes de recherche. Notes 1.
Éd. D. Renard,
Paris. 2.
Éd. Flammarion,
Paris. 3. Éd. Flammarion. 4.
Ibid., p. 65. 5. Ibid., p. 49. 6.
Éd. Farrago,
Tours, 1999 7.
Éd. Gallimard,
Paris. 8.
Ibid., p. 87-88. 9.
Ibid., p. 87. 10.
Ibid., p. 88. 11.
Ibid., p. 89. 12.
Ibid., p. 90. 13. Op. cit., p. 90. 14.
Cf. Les Matinaux, éd. Gallimard, Paris. 15.
Cf. Janvier, février, mars, p. 97. 16.
Ibid., p. 98. 17.
Éd. Gallimard. 18.
Cette perception
d’une identité contradictoire est probablement liée avant tout à ses origines
familiales, dans la mesure où Claude Esteban est issu d’un père espagnol et
d’une mère française. Par ailleurs, né et décédé à Paris, il passera la plus
grande partie de sa vie en France. 19. Ibid., p. 38. 20.
Ibid., p. 148-149. 21.
Ibid., p. 139. 22.
Ibid., p. 129. 23.
Cf. la remarque de
Dominique Viart quant aux nombreuses activités de Claude Esteban :
« Traducteur, essayiste, critique autant que poète, Claude Esteban est
l’homme des médiations. Il les pratique constamment » (« Un peu de
réel dans la bouche » : le vœu d’immédiat de Claude Esteban, in
Collectif, L’espace, l’inachevé. Cahier
Claude Esteban, éd. Farrago ; Léo Scheer, Tours, 2003, p. 271).
Quant à sa réflexion sur l’art, elle a fait l’objet d’un colloque qui s’est
tenu en 2011 sous l’égide de Paris IV, puis d’une publication d’études, comme
prolongement au colloque (cf. Collectif, Le
travail du visible : Claude Esteban et les arts plastiques, éd.
Hermann, Paris, 2014). 24. Cf. Claude Esteban, Traduire,
in Poèmes parallèles, éd. Galilée, Paris, 1980, p. 38. 25.
Cf. Octavio Paz, Le singe grammairien (El
mono gramático, éd. Seix Barral,
Barcelone, 1974), traduit par Claude Esteban, coll. «Les sentiers de la
création», éd. Albert Skira, Genève, 1972. 26.
Cf. Hervé-Pierre
Lambert, Octavio Paz et l’Orient,
coll. « Perspectives comparatistes », éd. Classiques Garnier,
Paris, 2014. 27. Ibid., p. 23. 28.
Ibid., p. 130. 29.
Ibid., p. 15. 30.
Ibid., p. 134. 31.
Ibid., p. 152-153. 32.
Dès
1979, Paz développe sa préférence intellectuelle pour le bouddhisme: « Je
crois que la pensée la plus radicale, la plus salutaire dans son pessimisme
foncier, est le bouddhisme. L’humanité, pour son salut, devra, selon moi,
éviter l’athéisme et le monothéisme. (…) Le bouddhisme, c’est le sacré sans
Dieu. L’humanité a besoin, si elle veut se régénérer, échapper à la
destruction, d’une longue cure de bouddhisme. De cela, je suis intimement
convaincu » (Le Monde,
« Rencontre avec Octavio Paz », entretien avec André Laude,
10.08.1979). 33.
Cf. Jorge Luis
Borges, Les conjurés / Le chiffre,
Gallimard, 1988. 34.
Cf. le commentaire de Laure Helms et de
Benoît Conort, à l’occasion d’un entretien avec Claude Esteban : "Sur la
page, le vers semble alors s’inscrire en filigrane, à travers des « écorces »
(titre d’une partie de Morceaux
de ciel) de poèmes proches du haïku." ("Entretien avec Claude
Esteban", in Le nouveau recueil,
71, éd. Champ vallon, Seyssel, juin 2004). 35.
Éd. Gallimard. 36. Ibid., p. 119. 37.
Ibid., p. 210. 38.
Ibid., p. 107. 39.
Cf. notamment la
référence à son « Grand Œuvre » : «J’ai
toujours rêvé et tenté autre chose, avec une patience d’alchimiste, prêt à y
sacrifier toute vanité et toute satisfaction (…) pour alimenter le fourneau
du Grand Œuvre. Quoi ? c’est difficile à dire : un livre, tout
bonnement, en maints tomes, un livre qui soit un livre, architectural et
prémédité » (Mallarmé, Stéphane, Correspondance complète 1862-1871. Lettres sur la poésie 1872-1898,
coll. Folio classique, Paris, 1999 [1995], p. 585). Quant à Esteban, s’il
s’est souvent intéressé au projet du Livre mallarméen, il a poursuivi sa
réflexion dans Critique de la raison
poétique (Flammarion, 1987), en mentionnant le « souci du poète » : « Le Livre est l’ennemi
du temps, qui divise, qui diminue et qui disperse » (p. 57). 40.
Ibid., p. 104. 41. Cf. Sa traduction de ces quelques vers extraits du Cantique (Cántico, in Revista de
Occidente, Madrid, 1928) de
Jorge Guillén, parue chez Gallimard, coll. « Du monde entier » en
1977puis reprise dans Poèmes parallèles,
éd. Galilée, Paris, 1980, p. 155 : Être,
rien d’autre. Assez. / Mais l’absolu bonheur. (Ser,
nada más. Y basta. / Es la absoluta dicha.) 42.
Cf. Los pícaros en Arcadia (Les gueux en Arcadie, Casa de Velázquez, Madrid, 2000),
p. 52-54, texte bilingue avec la traduction espagnole de Ferdinand Arnold en
regard : « Nous sommes, ne l’oublions pas, en Arcadie, la contrée
fabuleuse où tous les conflits se défont, où l’harmonie, même réduite à ses
éléments les plus simples, s’impose. Et qu’il y ait là des ivrognes, des
voleurs sans doute, peut-être des spadassins – pourquoi cette épée dans le
dos du soldat – ne prête pas à conséquence. (…) Ne faisons pas mine de nous
offusquer. Et in Arcadia ego, (…)
et, bien sûr, je me souviens du tableau de Poussin, pour énoncer une idée
neuve, à savoir que la mort ne vient pas contrecarrer l’existence sur un
tombeau, qu’il est possible et même désirable de vivre dans l’immédiateté de
l’instant.» (p. 53). 43. Ibid., p. 58-59avec comme traduction espagnole :
« Comme si l’on pouvait s’entendre, à demi-mot, sur les valeurs simples
de la vie ». 44.
Cf. Claude Esteban,
Critique de la raison poétique,
Flammarion, coll. « Critiques », 1987. 45. Cf. en particulier dans la Critique de la raison poétique le commentaire estebanien d’Hypérion d’Hölderlin, avec comme titre
de chapitre la mention « Ces dieux que tu pleures toujours… » et,
en ouverture, les phrases suivantes : « Le lieu où l’âme se
retrouve, où la parole interrompue tente du moins, au soir, un essentiel
recueillement, reste lié, pour certaines voix qui nous sont chères, à une
architecture en ruine. Là, parmi les colonnes brisées, dans le délabrement
des stèles et des temples, il semble, mystérieusement, que la paix puisse
naître et, au cœur même de l’abandon des pierres, une présence ancienne se
donner. » (Critique de la raison
poétique, p. 65). Le « recueillement » favorisé par la
contemplation de ruines antiques semble favoriser l’expression d’une paix
intérieure non seulement chez Hölderlin mais aussi chez Esteban (cf. l’emploi
inclusif du pronom personnel « nous »), qui conclut : « Hanter la terre où les dieux ont marché est peut-être la voie qui
s’offre à nous vers l’antique demeure d’où nous fûmes exclus » (ibid.). 46. Éd. Fourbis, Paris, 1997, p. 32-33. © Pascal
Hermouet |
Essai de Pascal
Hermouet
Recherche Dominique
Zinenberg
Francopolis,
septembre-octobre 2021
Créé le 1 mars 2002