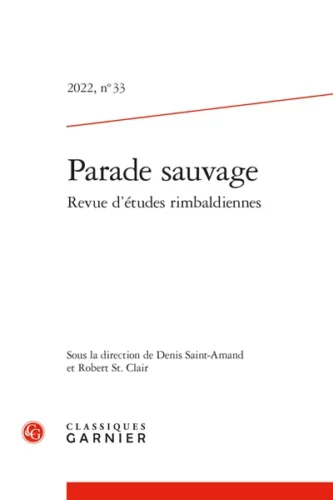|
LECTURE - CHRONIQUE Revues papier ou
électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |
|
|
LECTURES – CHRONIQUES – ESSAIS Novembre-décembre 2023 Rimbaud à la
loupe : la dernière livraison de la revue Parade sauvage Chronique par Michel
Herland Parade
sauvage – Revue d’études rimbaldiennes, 2022, n° 33,
sous la direction de Denis Saint-Amand et Robert St. Clair. Paris,
Classiques Garnier, 2023, 384 p., 42 €. |
|
Parade sauvage – Revue d’études
rimbaldiennes a été
créée en 1984 sous les auspices du musée Arthur-Rimbaud à Charleville-Mezières.
Désormais reprise par les Éditions Garnier, elle paraît annuellement sous la
forme d’un gros ouvrage au format 15x22 cm et bénéficie d’une belle impression.
Le numéro 33 publié en 2023 bien que daté de 2022 rassemble sur 384 pages
seize contributions dont une recension et un in memoriam. Rimbaud, ce météore des lettres
françaises, n’est plus aussi lu qu’il le fut et l’on ne voit plus guère sa
photo en poster affichée sur les murs de nos villes. C’est bien dommage mais
n’est-ce pas le sort de tous les poètes en un temps où tout doit aller très
vite. Contrairement au roman qui, s’il est réussi, nous emporte – et cela
même s’il est écrit dans une prose exigeante – la poésie réclame de
s’arrêter, de prendre son temps pour savourer un passage particulièrement
bienvenu, quitte à passer plus vite sur ce qui nous semble plus faible, ou,
simplement, qui nous touche moins. Tel est le plaisir de l’admirateur
« ordinaire ». Mais le passionné en veut davantage. Il veut tout
savoir sur son héraut des lettres, sa vie et son œuvre. Les deux, chez
Rimbaud, contiennent suffisamment de mystère pour attiser la curiosité de l’amateur
passionné. Quand ce dernier est un professeur de littérature spécialiste de
Rimbaud, cela lui ouvre un champ de recherches quasi infini et fournit la
matière à d’infinies controverses. On en trouve maints exemples dans ce
numéro de Parade sauvage. Le titre de la revue n’y étant pas
explicité, rappelons que c’est sur cette expression que s’achève le passage
des Illuminations intitulé lui-même « Parade » :
« J’ai seul la clef de cette parade sauvage ». Si Rimbaud ne
précise pas qui sont ces gens qu’il décrits paradant et si la réponse n’est
pas apportée dans ce numéro, ce dernier envisage bien d’autres questions à
propos desquelles sont avancées nombre d’hypothèses, conclusives ou pas. On ne pourra donner ici que quelques
indications sur le contenu de ce savant numéro. Ainsi, Steve Murphy, dans un
nouvel examen du poème « Le Cœur volé » (que les exégètes
s’accordent à considérer comme un remake de « L’Albatros »
de Baudelaire » et/ou de la scène du pélican dans « La Nuit de
mai » de Musset), après avoir explicité certains termes (le désormais
fameux abracadabrantesque, ityphallique, pioupiesque), revient-il sur la manière
dont il faut interpréter le mot « cœur », contestant qu’il soit pris
au sens univoque de sexe masculin. Par ailleurs, tandis que ce poème se
comprend spontanément en première lecture comme le récit du viol d’un marin
(un mousse) par d’autres marins, Murphy rend la chose plus compliquée
puisque, selon lui, « sur le plan textuel, le poète semble avoir tout
fait pour que l’on soit incapable de trancher » [s’il décrit une scène
réaliste ou non], … en dépit des nombreux termes dont la connotation sexuelle
(bave, bachique, chique, couvrir, jets) est explicitée dans l’article. Gilles Lapointe s’interroge pour sa
part sur la signification du H qui sert de titre au morceau XXXV des Illuminations.
Si de nombreuses clés ont été proposées, l’explication la plus convaincante,
à savoir la masturbation, fut avancée par Étiemble et Yassu
Gauclère en 1936, une interprétation qui convient
parfaitement pour la deuxième ligne du texte : « Sa solitude est la
mécanique érotique », pour l’avant-dernière « Ô terrible frisson
des amours novices » et au milieu du texte pour « elle a été, à des
époques nombreuses, l’ardente hygiène des races ». Cependant le texte
fait apparaître deux fois le prénom Hortense ; soit dès la première ligne
(« les gestes atroces d’Hortense – ce qui ne contredit pas
l’interprétation la plus évidente), et se termine par cette injonction :
« Trouvez Hortense ». Faut-il alors chercher une femme derrière
Hortense ? Certains s’y sont employés en vain. Faut-il accorder plus
d’importance à ceux qui voulurent déchiffrer le dessin formé par la lettre
H ? Tentative encore plus vaine. Lapointe, quant à lui, plaide en faveur
de deux interprétations du H très éloignées de celle d’Étiemble et Gauclère : H comme Hercule et/ou H comme (Victor) Hugo.
Il insiste sur la seconde : selon lui, Rimbaud, dans « H », ne
ferait que pousser plus loin la satire de Hugo amorcée (de l’avis général)
dans le poème « L’Homme juste ». Cette très riche livraison comporte
encore, par exemple, une étude détaillée (32 pages) d’Une saison en enfer
par Victoria Zurita, laquelle met justement en
évidence « la permanence de l’attente eschatologique, malgré les
déceptions dont elle est porteuse ». Contrairement à ce que pourrait
laisser croire le titre de son article, l’auteure conclut qu’il est, selon
elle, vain de chercher un témoignage autobiographique dans cet ouvrage. Ainsi
récuse-t-elle comme sans intérêt la lecture des pages de « Délires -
I » comme un récit de la relation amoureuse tumultueuse entre Rimbaud
(la « vierge folle ») et Verlaine (« l’époux infernal »).
Alain Bardel,
centre pour sa part son article sur « Délires - II » où Rimbaud
semble se moquer de sa poésie. Or Une saison en enfer est l’unique
ouvrage publié par la volonté de l’auteur, dès 1873, bien avant les Poésies
dont la première édition, ignorée de Rimbaud, date de 1891. Que Rimbaud ait
tenu à reprendre dans « Délires II – Alchimie du verbe » certains
poèmes de l’année précédente (en les tronquant ou les modifiant quelque peu)
fait inévitablement penser que le poète leur accordait plus d’importance
qu’il ne le dit. La lecture mot à mot d’A. Bardel
en apporte la démonstration convaincante contre ceux qui, prenant certaines
expressions au pied de la lettre, ne veulent voir dans Une saison
qu’un acte de contrition sincère. Cyrille Lhermellier
et Yalla Seddiki revisitent la question de la
paternité éventuelle (partielle ou totale) de Germain Nouveau dans les Illuminations.
Le dossier est loin d’être fermé puisque la thèse suivant laquelle Nouveau
serait l’unique auteur des Illuminations a toujours ses partisans. Il
est avéré, en tout cas, que Rimbaud et Nouveau furent amis et que le second
fut également un grand poète bohème, par ailleurs l’auteur du premier poème
en vers libres (« La Chasse aux cygnes refaite par Charles Monselet », 1877), comme le rappelle Pedro Vianna
dans deux articles très documentés consacrés à Nouveau de cette revue (Francopolis
n° 175, janvier-février 2023). Tenons-nous en pour finir aux deux
articles concernant le poème « Les Mains de Jeanne-Marie ». Un
poème de jeunesse (Rimbaud a dix-sept ans en 1871) des plus classiques :
seize quatrains d’octosyllabes avec rimes croisées alternativement féminines
et masculines. Pas question, dans ce cas, de chercher à savoir qui est cette
Jeanne-Marie : on s’accorde à y voir un type, une icône de la Commune de
Paris. Ce qui n’empêche que le poème soulève nombre de difficultés. Marc Dominicy s’attarde, entre autres, sur ces deux
vers : « Mains chasseresses des diptères / Dont bombinent les
bleuisons ». Diptères, bombinent, bleuisons, autant de termes à décoder
mais tout le poème est à l’avenant. L’un des articles plus brefs de la
rubrique de la revue intitulée « Singularités » revient sur ce
poème. Signé par Alain Chevrier il s’intitule « Qu’est-ce qui fait
saigner les doigts de Jeanne-Marie ? ». L’auteur voit à juste titre
une contradiction entre l’avant dernier quatrain où se lit « À vos
poings […] Crie une chaîne aux clairs anneaux » et le dernier quatrain
qui se termine par « En vous faisant saigner les doigts ». Une
chaîne aux poignets ne saurait en effet avoir ce résultat. Chevrier apporte
la solution de cette énigme : un instrument de torture nommé
« poucettes », utilisé en particulier à l’encontre des bagnards et
bien décrit dans le Journal officiel militaire (1873), permettait de
serrer les pouces dans une sorte de doigtier articulé, en fer. On comprend
ainsi pourquoi les doigts de Jeanne-Marie pouvaient saigner ! ©Michel Herland |
Michel Herland
Francopolis, novembre-décembre 2023
Recherche Dana Shishmanian
Créé le 1 mars 2002