|
|
|||||
|
|
||||||
Naître
en automne dans la « douce bourgade de Iasi » ressemble à
un signe d’harmonie de la part du destin.
Chère Marlena Braester, vous avez eu la chance de naître dans cette belle ville de Iasi. Au sujet de cette authentique capitale culturelle, vous avez récemment affirmé : « J’ai du mal à l’imaginer sans ses étudiants »… Avec quels souvenirs de cette « douce bourgade de Iasi » vous êtes-vous lancée dans la vie ? Naître en automne dans la « douce bourgade de Iasi » ressemble à un signe d’harmonie de la part du destin. Les nuances de l’automne, caressantes, profondes, persévérantes, caractérisent tous les aspects de la vie de Iasi. Je suis née à Iasi, où mes parents étaient étudiants en 1953, j’ai ensuite passé mon enfance à Tecuci * (1), et je suis revenue à Iasi à 18 ans, en tant qu’étudiante. Je me souviens des deux premières maisons où j’ai habité : l’une existe encore, l’autre non. Je les ai revues pendant ma vie d’étudiante. La première, qui suivait pour la démolition, se trouve juste à côté du Palais de la Culture. L’horloge du Palais a marqué les premières heures de ma vie, l’entrée dans le temps, consolant mes pleurs d’heure en heure pendant mes promenades quotidiennes autour du Palais. Mon premier hiver a été un hiver difficile, à ce qu’on m’a dit, spécialement pour deux étudiants de vingt et quelques années qui doivent se débrouiller seuls. Puis a suivi la période à Tecuci, entourée de gens extraordinaires, amis et collègues de ma mère – professeur en lycée, et de mon père – procureur à Tecuci, donc par la force des choses, respirant l’atmosphère intellectuelle de cette ville. Maintenant, dans cette perspective, j’apprécie particulièrement l’apport de mes années de scolarité dans ma formation professionnelle : une base sérieuse, informative, éducative, culturelle dont j’ai pris conscience pour la première fois à l’examen d’entrée de la faculté, sous forme de concours, (en 1972, il y avait 11 candidats participants à la Faculté de Philologie, section français-anglais) et où j’ai été acceptée, grâce à une préparation sérieuse, aux lectures et à la capacité d’expression acquise au lycée. La vie culturelle, scientifique et universitaire à Iasi a été également extrêmement riche. Y avez-vous participé avec plaisir ?Avez-vous connu des figures qui illuminent la spiritualité, tant dans la culture moldave que dans la culture roumaine ? Iasi nimbe encore mes années d’études de son atmosphère qui irradiait chaleur, richesse et sensibilité. J’ai eu la chance et le plaisir d’avoir comme professeurs de littérature Valeriu Stoleriu, Alexandru Călinescu, Luca Pîţu, et en langue française et sémiotique Maria Carpov. Leur personnalité a été décisive en ce qui me concerne. Les premiers contats avec des poètes ou des écrivains, je pense à Mihai Ursachi, mais aussi à mon milieu ordinaire de cette époque lorsque nous nous retrouvions plusieurs fois à la Casa Vasile Pogor, là où travaille une de mes meilleures amies (qui fut d’abord professeur de littérature), ou au Palais de la Culture, au musée d’Archéologie, où travaille le mari de cette amie comme conservateur. Je me souviens parfaitement de la bibliothèque Mihai Eminescu avec cette paix qui émane de ces livres, tel le paradis, et je l’ai revue ces dernières années avec joie en y retrouvant mon ancien professeur Alexandru Călinescu en tant que directeur. Une vie estudiantine bien remplie, théâtre, concerts hebdomadaires au Philarmonique, mais aussi les discothèques, les films, et même des films français à l’université en provenance directe, grâce à la filière du Lectorat français qui nous ouvrait alors une toute petite fenêtre, nous reliant à l’Occident. Parce que c’est vrai, au fond, nous souffrions de cette rupture d’avec le reste du monde, du manque d’information et de la désinformation quant à tout ce qui se passait au-delà des frontières de la Roumanie. Pendant cette période, j’ai connu mon mari, étudiant en médecine, originaire de Piatra- Neamţ. Ensemble avec nos amis, nous essayions de nous maintenir à la surface, car nous nous considérions comme faisant partie des jeunes citoyens d’un vaste monde et non pas d’un régime qui étouffe en premier lieu les intellectuels. D’un point de vue culturel, l’ambiance des années 70 devenait de plus en plus irrespirable, sans effacer les valeurs dont nous avions conscience, mais à leur côté se développaient des anti-valeurs de plus en plus nombreuses, telles des mauvaises herbes qui envahissaient tout. Etant très jeunes, nous ne saisissions pas encore le tragique des dérives sociales, économiques, politiques, mais nous pressentions cette tragédie inacceptable et frustrante avant tout sur le plan intellectuel. La solution qui se présentait alors était on ne peut plus simple et radicale pour nos 27 ans... en un mot : quitter notre pays. «Le lien entre la culture israélienne et la culture roumaine se réalise aussi par l’intermédiaire des traductions de leurs deux littératures… » Comment avez-vous ressenti le détachement d’avec la langue et la culture roumaine, en ce début du mois de juin 1980, lorsque vous avez émigré en Terre Sainte ? Je pense ici aux effets que ces importants changements apportent tant sur le plan de la personnalité que sur celui des paradigmes existentiels et comment ils peuvent être ressentis dans l’esprit et la conscience d’intellectuels … Juin 1980 a donc marqué la séparation certes traumatisante d’avec la famille, les amis, les lieux familiers. Mais il n’est pas question de détachement d’avec la langue roumaine ni d’avec la culture roumaine. Une communauté d’origine roumaine nous a accueillis en Israël, surtout à Haïfa où nous nous sommes établis dès le début et où nous demeurons. La transition s’est faite au fur et à mesure : le processus d’acquisition de la langue hébraïque, si différente des langues romanes, ou de l’anglais avec lequel nous étions familiarisés, a été un processus lent , mais sûr. La formation de linguiste m’a beaucoup aidée, une attitude face à une nouvelle langue dans un milieu où nous nous sommes réveillés tout d’un coup étant ceux qui observent en profondeur, qui étudient en détail les nuances et les possibilités de s’exprimer. Intellectuellement, la révélation a été énorme, l’absence des frontières auxquelles nous avions été habitués nous a permis de « respirer » tout à fait autrement… Premier voyage à Paris, immédiatement, le retour en Roumanie, et ceci répété ensuite à peu près annuellement, les liens étroits avec ceux de Roumanie, les visites fréquentes en Israël de ceux restés en Roumanie, ont rendu cette transition facile à supporter. Et les succès sur le plan professionnel se sont succédés : l’inscription en octobre 1980 à une nouvelle maîtrise – en littérature française- à l’université de Haïfa, mes diplômes de Iasi étant alors reconnus comme une équivalence de maîtrise en linguistique, la soutenance d’un mémoire de maîtrise en 1982, la nomination en tant qu’assistance à l’université de Tel-Aviv, mais aussi à Haïfa, pour enseigner la langue et la littérature française, l’inscription en doctorat de linguistique à l’université de Paris VIII (Vincennes – Saint Denis) Dans quel état avez-vous trouvé la culture israélienne de langue roumaine dans l’Israël des années 80, et comment a t-elle évolué dans l’ensemble jusqu’à l’heure actuelle ? Il existait depuis une trentaine d’années une association d’écrivains israéliens de langue roumaine, dont la renommée s’étendait jusqu’en Roumanie et à l’activité riche. Des écrivains de renom continuent d’écrire aussi en langue roumaine en Israël : Sebastian Costin, Sandu David (mort il y a peu), Alexandru Mirodan (qui publie la revue littéraire „Minimum” ), Eugen Campus, Elena Tacciu, Alexandru Strihan, Mirel Brateş. A cette époque, quelques écrivains avaient commencé à écrire aussi en parallèle en langue hébraïque, et étaient publiés par de prestigieuses maisons d’éditions israéliennes, comme Andrei Fishof par exemple. L’association mentionnée ci-dessus publie également une revue au nom révélateur : „<i> Sources </i>” et garde une étroite relation avec le public roumain, publiant une partie des livres chez des maisons d’éditions de Bucarest ou d’autres villes en Roumanie. Quel genre de dialogue partenaire ont aujourd’hui ces deux cultures roumaine et israélienne ? La culture roumaine est-elle un « liant » pour celle-là ? Aujourd’hui, il existe aussi un Centre Culturel Roumain, fondé en 2004 à Tel Aviv, où se déroulent de nombreuses activités artistiques, littéraires, abritant des expositions, des récitals de poésie, des conférences. Le lien entre la culture israélienne et la culture roumaine se réalise aussi au moyen des traductions entre les deux langues, car elles s’adressent à un public plus large, et non pas seulement aux locuteurs des langues respectives. J’ai personnellement eu l’honneur et le plaisir de traduire deux romans de Amos Oz, publiés en Roumanie aux Editions Univers. « L’approche de la culture et de la sensibilité française, qui a caractérisé le monde intellectuel roumain, est une chose très bien connue, et je n’y fais pas exception ». Universitaire, poète, traductrice prestigieuse…vous avez récemment reçu de la part du premier ministre de la France le titre de « Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques » pour services rendus à la culture française. Vous êtes également la présidente de l’Association des Ecrivains Israéliens de Langue Française. Quelle place occupe la langue française dans le concert des langues majeures de la culture actuelle ? Quelle langue peut être déclarée langue dominante dans ces conditions de compétition qui semblent se développer pour que l’une d’elles occupe une telle place ? Dans la même mesure que la langue roumaine, la langue française a été un point de passage, un fil continu qui m’a soutenue et a atténué les ruptures que l’on ressent alors inévitablement lorsque l’on s’installe dans un pays différent de celui où l’on est né. Davantage encore, car étant ma profession, également « profession de foi », et une langue d’expression poétique, la langue française occupe, de fait, la première place pour moi. L’approche de la culture et de la sensibilité française, qui a caractérisé le monde intellectuel roumain, est une chose très bien connue, et je n’y fais pas exception. Néanmoins, j’ai eu la chance de pouvoir établir de multiples relations directes avec des écrivains, des éditeurs, des linguistes, des gens de théâtre, des chercheurs dans divers domaines en France et je considère que je suis heureuse d’avoir pu intégrer la vie culturelle francophone. Bien-sûr, on ne peut nier le fait que l’anglophonie domine – spécialement en Israël- ce qui éclipse la manifestation d’une forte présence française inscrite dans la vie culturelle ou scientifique israélienne. Le nombre des lycée où l’on enseigne le français a décliné. Les universités en pâtissent, car les départements de langue et de littérature française ont de moins en moins d’étudiants. Je sais qu’en Israël, et ceci à la différence d’autres pays, il existe un grand institut pour les traductions littéraires hébraïques en langues de circulation courante. Comment appréciez-vous l’avancement de ce projet en ce qui concerne les traductions des livres hébreux en français et leur édition en France ? Avec quels éditeurs collabore t-on le mieux ? De nombreux auteurs israéliens sont traduits et publiés en pays francophones chez de grands éditeurs : des écrivains tels Amos Oz, A.B. Yeoshua, David Grossman, Aron Appelfeld, Yehuda Amihai, Israel Eliraz, Haim Guri sont publiés chez des éditeurs comme Gallimard, José Corti, Calmann-Levi, Caractères, J. Brémond, l’Harmattan. En Suisse, les éditions Metropolis ont récemment publié une trilogie de l’écrivain francophone Esther Orner. Vous êtes membre du Comité de Direction du Centre de Recherches sur la Poésie Francophone Contemporaine de l’Université de Haïfa et vous dirigez également l’Atelier de Traduction de ce même centre universitaire. Dans quel état se trouve la poésie francophone aujourd’hui ? Dans le monde, en Israël, en Roumanie... bien-sûr, du point de vue critique d’un bon diagnosticien... Justement, la poésie se porte bien, particulièrement la poésie française et francophone. J’ai hébergé dans le cadre de nos activités dans le domaine francophone en Israël des poètes parmi les plus remarquables : Michel Deguy, Jean-Michel Maulpoix, Philippe Beck, Marie-Claire Bancquart, Henri Meschonnic, Pierre Oster, ainsi que d’autres poètes francophones tels Eric Brogniet, Christian Hubin, Pierre-Yves Soucy de Belgique, ou Nimrod, originaire du Tchad; j’ai organisé un colloque international consacré à l’écrivain de langue française originaire du Liban Andrée Chedid. Un poète à l’oeuvre extrêmement intéressante et que j’ai eu le plaisir de traduire en langue hébraïque est Abdul Kader El-Janabi, poète irakien qui vit depuis quelques décennies à Paris et qui écrit aussi en arabe et en français. Au Forum International des Poètes, qui a eu lieu en avril 2005, a participé de Roumanie le poète Persida Rugu, qui écrit aussi en roumain et en français. En Israël, il existe de nombreux francophones : l’Association des Ecrivains Israéliens de Langue Française se compose d’écrivains originaires de France – le plus connu étant Claude Vigée, d’Algérie- le poète et traducteur bien connu de la Bible et du Coran en français, André Chouraqui, de Belgique, du Maroc, de Roumanie. Originaire de Roumanie, justement de Tecuci, il faut mentionner la poétesse Bluma Finkelstein qui a récemment reçu le Prix du Président de l’Etat d’Israël pour l’ensemble de son oeuvre. «Fondane est considéré par certains comme un écrivain français, oubliant l’existence de Beniamin Fundoianu ». Attachée au nom de Benjamin Fondane, vous avez traduit une grande partie de son œuvre. Je dirais que c’est seulement maintenant que l’on ouvre grand les portes pour le recevoir. A Royaumont, en 1998, à l’occasion de la Conférence Internationale « Benjamin Fondane », vous avez démontré l’existence d’une série d’avatars « de Benjamin Fundoianu à Benjamin Fondane ». Qu’est-ce qui vous lie si profondément à son œuvre et quelle perspective s’offre à vous, en tant que traductrice ? Revendiqué autant dans la littérature roumaine que dans la littérature française, Benjamin Fondane suscite un intérêt de plus en plus grand, du fait de son oeuvre poétique, théâtrale, du fait également de ses essais et de ses activités dans le domaine cinématographique. Des spécialistes de plus en plus nombreux étudient et traduisent l’œuvre de Fondane. En traduisant en français ses poèmes de jeunesse ainsi que ses fragments de journal écrit en roumain, j’ai constaté que l’œuvre écrite en langue française est la suite naturelle, non factice, de l’œuvre écrite en langue roumaine, le passage d’une langue à l’autre se faisant – bien-sûr pas sans moments de crise- avec une subtilité et une perfection en ce qui concerne le maniement de ces langues dites « étrangères » tout à fait frappante. En fait j’ai trouvé une réponse aux questions que je me posais moi-même quant au choix de la langue poétique, chemin que j’ai suivi également tout comme nombre d’autres écrivains nés en Roumanie, mais « adoptés » par la langue littéraire française. Votre nom est également lié à la parution de la revue « Continuum » (la revue des Ecrivains Israéliens de Langue Française) tout comme à celle des revues „ Approches. Cahiers israéliens de poésie, de critique, d’art”, “Sources – Europoésie”, revue de la Maison de la Poésie (Namur, Belgique). Comment évoluent ces revues dans l’espace francophone et quel intérêt spécial représentent-elles dans la constellation des problèmes de la francophonie actuelle ? Sont-elles inscrites parmi les récentes et prioritaires questions de crise de la francophonie dans lesquelles l’état français s’est engagé au plus haut niveau ? En créant la revue Continuum, j’ai évidemment pris en considération les difficultés objectives, comme le simple fait qu’Israël n’est pas considéré officiellement en tant que pays francophone, ou la difficulté de la distribution par-delà les frontières israéliennes. D’un autre côté, paradoxalement, les écrivains israéliens francophones sont mieux connus en France qu’en Israël, étant insuffisamment traduits en langue hébraïque. J’ai assumé, en premier lieu, une connaissance plus large de ces deux écrivains considérés de par l’ampleur respective de leurs travaux comme étant les deux plus importants à l’heure actuelle dans la francophonie israélienne : Claude Vigée et André Chouraqui. J’ai donc organisé avec le soutien de l’Institut Français de Tel-Aviv, en même temps que le lancement du premier numéro de Continuum en 2003, un hommage à André Chouraqui, auquel j’ai consacré une grande partie de ce numéro – en présence de l’auteur qui vit à Jérusalem. Le résultat immédiat a été la présentation en face d’un très large public de cet auteur presque ignoré dans son pays. Le second hommage – cette fois-ci au poète Claude Vigée- je l’ai organisé à l’occasion de la présentation du second numéro de la revue Continuum qui lui est consacré, au Salon International de la Revue à Paris, en octobre 2004. A cette occasion, j’ai présenté Claude Vigée au public parisien – non plus en tant qu’écrivain français, ainsi qu’on le croit en général, mais bien en tant qu’écrivain israélien francophone. Cette même confusion se répète dans le cas de Fundoianu- Fondane: Fondane est considéré par certains comme un écrivain français, oubliant l’existence de Beniamin Fundoianu. La revue Poésie & Art ( nouvelle version de la revue Approches que j’ai publiée dans les années 80) est d’une autre facture : elle est basée plus spécifiquement sur la recherche, comme les traductions de textes poétiques et critiques. La publication de cette revue est le résultat en fait des activités organisées par le Centre de Recherches sur la Poésie Francophone à côté de l’université de Haïfa. L’une des activités permanentes du Centre est le fonctionnement d’un Atelier de Traduction de Poésie, que je dirige depuis 1998, dans le cadre duquel des traducteurs-chercheurs ou des traducteurs- écrivains se réunissent tous les lundis, traduisant soit d’hébreu en français, soit de français en hébreu, en vue de préparer des rencontres avec des poètes invités d’Israël ou d’autres pays. Vous avez traduit Amos Oz. Vos participations n’ont-elles pas été assez peu nombreuses aux colloques internationaux, axés sur l’œuvre de cet écrivain important ?Entre autres, celui de Beersheva, en 1997,avec les travaux “Traduire Amos Oz”… Ainsi, quelle est la portée de cette traduction d’ Amos Oz, d’autant plus en langue latine ?(avec ou sans „boîte noire”)... Ma trajectoire en tant que traductrice a trouvé son point de départ dans la traduction roumain- français- roumain. Le premier roman que j’ai traduit est celui de l’écrivain Catherine Durandin, qui est en réalité historienne mais aussi romancière. Le roman s’intitule Une mort roumaine et est paru aux éditions « Portofranco ». En même temps, j’ai commencé à traduire des poésies roumaines de Fundoianu, à la demande de Monique Jutrin, professeur de littérature à l’université de Tel-Aviv, actuellement Présidente de la Société Internationale Benjamin Fondane. Traduisant, dans un certain sens, en « cercle fermé », c’est-à-dire sans sortir du cadre familier des langues romanes, je me sentais encore « chez moi »… En même temps, la langue hébraïque s’imposait de plus en plus, la tentation d’essayer une nouvelle piste devenait de plus en plus grande. Le premier roman d’Amos Oz que j’ai lu intégralement en hébreu fut : « Tu ne prononces pas le mot : nuit ». Un roman né dans le désert, où tout a lieu dans le désert. La décision a été prise spontanément, et la traduction a été publiée à Bucarest aux Editions Univers « Le roman du xx° siècle », en 1997. Transgressant les frontières des langues auxquelles j’étais habituée, le travail de traduction a été complètement autre. La transposition des rythmes, des harmonies ou des disharmonies, des sonorités et des registres, des constructions syntaxiques totalement différentes en langue roumaine, a été une expérience absolument nouvelle : les équivalences n’étant pas évidentes, la réécriture d’un texte aux résonances provenant d’une zone extrêmement éloignée de l’essence du langage, a été une lourde charge. Avec bien plus que le seul texte, c’était un texte en grande partie poétique, lorsque je pense aux longues descriptions du désert avec son rythme propre, avec tous les moments et toutes les nuances cachées. Il n’était plus question de continuité comme pour la traduction de Fondane en français, ou de Catherine Durandin en roumain. La rupture était profonde, la distance sur le plan linguistique, immense. « La boîte noire » a été une expérience différente. Un texte plus dynamique, dominant, épique, un échange épistolaire ; déjà familiarisée avec le style d’Amos Oz, la tâche était moins difficile. Le roman a été publié chez le même éditeur en 2002. « La poésie israélienne actuelle est extrêmement variée dans son inspiration et riche au premier rang du fait qu’il existe au moins 13 langues d’expression » Pouvez-vous nous donner un point de vue critique sur la poésie israélienne ? Passé, présent, avenir…de la perspective d’un poète qui construit aujourd’hui aussi le Neghev des Lettres, comme une entité immortelle de cette vieille culture, mais d’une perspective d’un thème abordé avec les armes de la langue française ? La poésie israélienne actuelle est extrêmement variée dans son inspiration et riche au premier rang car les langues d’expression poétique sont très variées : il existe en Israël à l’heure actuelle 13 Associations d’écrivains qui écrivent en 13 langues : hébraïque, arabe, roumaine, française, anglaise, russe, yiddish, polonaise, espagnole/latino, etc. La poésie écrite en hébreu appartient soit au nouveau lyrisme- Rahel Halfi, Maya Bejerano, soit est d’inspiration religieuse– Admiel Kosman, Haya Esther, soit est innovatrice au maximum et surprenante dans l’adhésion de son public – Ronny Someck. Des auteurs très marquants sont Yehuda Amihai, Nathan Zah, Haim Guri, Meir Wieseltier, Dalia Rabicovici – qui représentent un pont avec la génération précédente. Parallèlement, il existe une poésie moderne en langue arabe: - Samih El-Kasem, Naim Araidi, en langue roumaine: - Luiza Carol, Sandu David, Andrei Fischof, en anglais: - Karen Alkalay-Gut, en français: - Claude Vigée, Esther Orner, Bluma Finkelstein. C’est une mosaïque intéressante et dynamique. Vous êtes, sans doute, le plus important écrivain connu dans le monde qui a transformé le désert en un grand thème littéraire. Les images poétiques, construites avec une grande maîtrise, tant verticales qu’horizontales, témoignent d’un raffinement ainsi que d’une envergure sémantique et stylistique impressionnante. Votre rencontre avec le désert a t-elle été une grande chance et un grand amour ? La rencontre avec le désert a été décisive – une sorte de chute dans l’essentiel: chute dans le sens de disperser l’inutile, le superficiel, qui se faufile parfois dans ce que l’on écrit, y compris dans la poésie. Une leçon, nécessaire, peut-être, pour chaque poète, pour tout replacer dans la véritable perspective, pour récupérer le véritable équilibre des choses, des valeurs, de la vie. Vos livres déjà publiés (dont un déjà primé): „La Voix, Elle”, poèmes, Paris, Ed. Caractères, 1993), „Absens”, poèmes, Paris, Ed. Caractères, 1996, „Oublier en avant”, poèmes, Paris, Ed. Jaques Brémond, 2002 (Prix „Ilarie Voronca”- Rodez, 2001), „La lumière et ses ombres”, poèmes, à paraître, vous mettent brillamment au premier rang dans la poésie israélienne, en langue française, dans ce langage qui fascine et crée un monde inouï. Que signifie la poésie pour vous ? En réalité, le désert est une métaphore de la poésie – les poètes du jury de Rodez m’ont ainsi motivée en m’accordant le prix pour le volume Oublier en avant. J’avoue que je n’avais pas cette idée en tête en écrivant ces poèmes du désert; pas dans une zone consciente du cerveau, mais probablement dans le seul subconscient, là où naît la poésie, là où naissent les sens que j’ai définis dans mon précédent volume ab-sens , à savoir que tout provient d’en deçà et d’au-delà du sens, étant en même temps également „l’absence” . La préposition latine „ab” m’a arrêtée, m’a séparée du sens, m’obligeant pendant un moment à le contempler en profondeur – une autre métaphore de la poésie que l’on pourrait qualifier de critique à nouveau. De toutes façons, il en a résulté un court-circuit de chaque discours logique, de chaque tentative d’explication, d’effort d’observation et d’analyse. D’une manière très simple et directe : une non-construction de ce que nous appelons : poème. 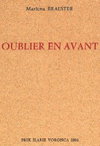
"La dérive homme-machine ne peut saper la sensiblité de l’entité corps- esprit dont parlent les psychologues aujourd’hui” Les écrivains israéliens, surtout ceux de langue roumaine, ont eu en général de bonnes relations avec les écrivains roumains... Il semble que la langue roumaine, l’inspiration roumaine, la matrice spirituelle roumaine sont des coordonnées difficilement changeables, tout au moins difficiles à oublier. Eprouvez-vous de la nostagie en ce sens ? Les écrivains israéliens, surtout ceux de langue roumaine, conservent des liens permanents avec les écrivains de Roumanie, publiant, traduisant, participant aux festivals de poésie, aux diverses manifestations littéraires. Récemment, on a décerné en Roumanie le prix Ovide à l’écrivain Amos Oz. En ce qui me concerne, émouvant est le fait que j’ai reçu en France le prix Ilarie Voronca * (2), étant lui aussi un poète né en Roumanie et ayant également choisi le français comme langue littéraire. Coïncidence ou non, ce genre d’évènement marque symboliquement le parcours d’un écrivain . Le lien avec la langue et la littérature dans laquelle nous „naissons” est évident, même si, à un certain moment de notre évolution sur le plan de l’écriture, nous choisissons, pour divers motifs, de nous exprimer également dans une autre langue, et seulement dans une autre langue. Personnellement, je suis de près tout ce qui se publie en Roumanie, et tout ce qui se passe dans la littérature roumaine m’est très proche. Pourtant, la définition d’une identité poétique est en fin de compte moins importante que le désir d’universalité. Dans un monde saturé par l’art consumériste et où l’on savoure uniquement de la prose courte ou quelques romans, croyez-vous encore en l’avenir de la poésie ? Oui, catégoriquement, car les sens qui naissent en poésie ne sont pas les mêmes que ceux avec lesquels on crée, on „construit” en prose. La dérive homme-machine ne peut saper la sensiblité de l’entité corps- esprit, dont parlent les psychologues aujourd’hui . La poésie se goûte en petite quantité, elle ne doit pas aspirer à être „consommée”. Je me rappelle cette phrase de mon premier éditeur en France – le poète Bruno Durocher qui voulait me prévenir d’une éventuelle déception due à la diffusion réduite des ouvrages de poésie : „comme vous le savez bien, la poésie n’est pas une marchandise” . © Angela Furtuna. Interview parue dans la revue littéraire "Hypérion”. Traduction française réalisée par Nicole Pottier
pour Agonia France, en partenariat avec Francopolis, juin 2005. Nota : (1) Tecuci : ville d’Estrie, jumelée avec les Sables d’Olonne. Situé à proximité de la Moldavie et de l’Ukraine, le département inclut 4 localités urbaines (Galati, Tecuci, Beresti et Târgu Bujor) et 56 localités rurales avec 180 villages. (2) Prix Ilarie Voronca : Quelques amis réunis à Rodez autour de Jean Digot fondent les prix Artaud et Voronca ; nous sommes en 1951, au lendemain de la guerre, de l'occupation allemande, d'Hiroshima…
Vous voulez nous envoyer vos images de francophonie? Vous pouvez les soumettre à Francopolis?
|
||||||
Créé le 1 mars 2002
A visionner
avec Internet Explorer


