|

«Je ne voulais pas débuter par un
générique qui fasse
« cinéma », je voulais un début de film sans
fioriture,
sans pour autant que cela fasse documentaire, le film
reste une fiction.» Roman Polanski
Le pianiste,
un film de Roman Polanski sorti en salle en 2002 (USA), avec Adrien
Brody dans le rôle de Szpilman, pianiste juif polonais à
Varsovie, pendant la seconde guerre mondiale.
Ici tout est sobre et signifiant. Les images tendent
vers le gris, le rouille, le sépia ; Polanski travaillant son
film dans la complexité des comportements humains, il lui est
nécessaire de simplifier l'impact des couleurs.
Avec ce long métrage, on pourrait s'adonner
à l'envie de parler de Roman Polanski ; de sa vie, de son
enfance en Pologne et de son vécu personnel de gamin juif dans
le ghetto de Varsovie. Mais... non. Le réalisateur, en
professionnel capable de surprendre le public et de ne pas verser dans
l'auto-dolorisme, propose l'histoire d'un autre homme ayant connu le
ghetto - évitant ainsi de nous abreuver d'un film personnel. En
effet, Polanski a adapté le récit que le pianiste
Wladyslaw Szpilman a écrit en 1945.
Dans Hors Champ (décembre 2002) Yannick Rolandeau sous-titre son
article sur Le Pianiste, Humiliation, humilité
; L'humilité du réalisateur qui décide de
s'effacer derrière sa caméra, derrière les images
percutantes mais sans tapage de l'histoire vécue par un autre.
Il y réussit jusqu'à nous saisir comme rarement.
Même avec Tess en 1979, Polanski n'était pas allé
aussi loin, aussi fort, aussi universellement. Et c'est la valse
macabre de la rue Chlodna, les cadavres qui se décomposent sur
le trottoir du ghetto, l'enfant contrebandier tué à coups
de crosse alors qu'il tente de s'échapper... Et c'est le
père qui s'efface pour laisser passer les officiers nazis...
puis ce vieil homme handicapé que les mêmes jettent du
haut de la fenêtre, car il ne s'est pas levé quand ils
l'ont ordonné. Nous sommes dans l'humble humilié par la
barbarie, nous sommes dans la terre (l'humus), là où la
transformation s'opère, là où l'air manque ainsi
que la lumière, là où ça fait peur,
froid... et mal.
« ... rappeler que l'homme est humble1, c'est
rappeler qu'il est né de l'humus. Humilier autrui, c'est en
revanche non seulement le ramener à l'humus, le réduire
à l'humilité de la poussière, des feuilles, du
fumier, mais c'est le traiter « plus bas que terre »,
l'enfoncer dans cette couche primitive où le sol est pourriture
et décomposition et dont la vie l'a dégagé. C'est
réduire l'être humain à ce qui n'est pas de l'ordre
du vivant mais de l'inerte et de l'inanimé, le dépouiller
de sa forme et de sa contenance, c'est le mortifier, lui faire sentir
les affres de la mort alors qu'il est encore en vie. »
Jean Clair (La Barbarie ordinaire)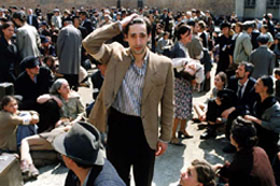
L'histoire raconte comment naît le ghetto de
Varsovie, comment les Allemands parquent les juifs en ce lieu où
les conditions de vie sont effroyables, où la faim et le froid
rivalisent, ou les artistes deviennent des esclaves et où chacun
porte le brassard qui le tatoue et l'isole de l'humanité. C'est
la vie d'un musicien de 28 ans qui devient le témoin de son
époque et qui va la traverser en résistant à sa
façon, dans sa détermination intime à poursuivre.
Contrairement à sa famille, il n'est pas déporté ;
avant que les Russes entrent dans Varsovie, à la fin de la
guerre, un officier allemand mélomane, l'entendant jouer
divinement, lui apporte à manger et lui offre son manteau. Le
message est clair : l'officier allemand prisonnier par la suite ne s'en
sortira pas. Rares sont les « sensibles » qui en
réchappent... justement pour cette raison.

Enfin, le film ouvre sur le pianiste jouant le nocturne
de Chopin dans le studio de Radio-Pologne, quand les bombardements
éclatent. Les Allemands sont là. Chacun s'enfuit sauf le
musicien qui persiste sous le bruit énorme des attaques. Cette
obstination, cette résistance intime et presque effrayante
donnent le ton de ce qui va suivre. Si le pianiste n'est pas un «
résistant » au sens historique du terme, il l'est dans sa
nature, dans sa capacité à tenir, à aller
très loin dans « la terre » (humiliation et
humilité mêlées), sans jamais se perdre, encore
moins mourir. Ce n'est pas un héros, c'est un homme. Un humain
avec un regard que le cinéaste nous rend pour que le partage
soit possible dans l'intimité de chacun. C'est à cet
endroit que nous sommes le plus à même de comprendre
l'histoire des hommes.
Mireille Disdero.
Notes
1. Homme : Famille d'une racine indo-européenne "ghyom", terre.
En grec khthôn, "terre" et "souterrain"
En latin "humus"
Homo, hominis : homme, créature née de la terre.
(Robert, dictionnaire étymologique)
Mireille
Disdero pour Francopolis,
octobre 2007.
|