|

Photographie
par Étienne Carjat (cca. 1873), dédicacée par Germain Nouveau à Stéphane
Mallarmé (reproduite d’après Wikipédia)
En effet, à son époque, Nouveau était
assez connu dans les cercles poétiques d’avant-garde et après sa mort, en
1920, les milieux littéraires se sont intéressés à lui et à son œuvre, à
preuve l’intérêt porté au poète par les surréalistes. Par ailleurs, on doit
signaler la publication irrégulière (1967, 1976, 2008) des Cahiers Germain Nouveau, ainsi que
des études universitaires, des articles spécialisés, des revues de poésie
qui s’intéressent à l’auteur. La consécration vient en 1970 avec la
parution d’un volume de La Pléiade partagé entre Lautréamont, qui n’occupe
qu’environ un quart de l’ouvrage, et Nouveau.
Peu à peu, l’édition s’épuise, mais,
en 2009, quand Gallimard décide de rééditer le volume, oh surprise !,
Germain Nouveau ne figure plus dans la nouvelle édition : quelque 800
pages, dont la moitié environ est composée de textes… sur Lautréamont.
Aucune explication n’a été donnée à ce cas unique d’évincement d’un auteur
publié dans cette collection prestigieuse. (1)
Malgré cela, par-ci, par-là, on
continue de s’intéresser au poète, comme le montrent un colloque en deux
volets en avril et novembre 2021, une exposition en octobre-décembre 2021 à
la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, des études universitaires et un
documentaire cinématographique.
Rappelons que le premier poème en
français en vers libres connu a été écrit par Nouveau en 1877, dix ans
avant son “invention officielle”, et c’est son seul poème de ce type…Titré La Chasse aux cygnes refaite par Charles
Monselet, il figure dans une lettre à Verlaine du 7 novembre 1877 et
est faussement signé Charles Montselet, critique dramatique au Figaro, journal qui avait publié
deux jours auparavant, une article du baron Platel, signé, Ignotus, sur une
chasse aux cygnes à laquelle il avant participé.
Voici quelques éléments relatifs à
l’enfance et à la jeunesse de Nouveau, qui nous semblent avoir eu une
influence marquante sur son œuvre.
Il est né le 31 juillet 1851 à
Pourrières (Var) d’un père propriétaire et d’une mère femme au foyer, qui
auront six enfants, dont trois meurent en bas âge. Nouveau passe ses
premières années à Paris où son père avait, sans succès, tenté de monter
une fabrique de nougats.
Sa mère décède en 1859 et son père se
remarie en 1862. L’année suivant, il entre au petit séminaire comme élève
externe.
En 1864 sa sœur puînée meurt à l’âge
de 7 ans, puis son père décède, sans qu’il y ait de lien entre ces deux
disparitions.
En 1866, Nouveau participe à une
retraite organisée pour les élèves que voudraient devenir prêtres, mais
l’année suivante il entre au lycée et en sort bachelier ès lettres en 1870.
En 1871 il est maître d’études au lycée de Marseille puis, à sa majorité en
1872, il entre en possession de l’héritage des parents et part pour Paris,
où il est introduit dans les milieux littéraires par son “pays” Raoul Gineste. Il est apprécié par ses
talents de dessinateur et de poète mais aussi par sa prodigalité. Il fréquente
le Groupe des “Vivants” (Maurice Bouchor, Raoul Ponchon, Léon Valade,
Jean-Louis Forain, Henri Mercier, Jean Richepin), rencontre Charles Cros et
Paul Bourget, vit une vie de bohème, boit beaucoup, notamment de absinthe,
et commence à publier.
Nous
allons maintenant suivre le fil de sa vie et nous reproduirons quelques-uns
de ses textes, présentés dans un ordre essentiellement chronologique.
Pour commencer, son premier poème
connu, signé P. Néouvielle (publié dans la revue “parnassienne” La Renaissance littéraire et artistique,
30.XI.1872).
Sonnet d’été
Nous
habiterons un discret boudoir,
Toujours
saturé d’une odeur divine,
Ne laissant
entrer, comme on le devine,
Qu’un jour
faible et doux ressemblant au soir.
Une blonde
frêle en mignon peignoir
Tirera des
sons d’une mandoline,
Et les blancs
rideaux tout en mousseline
Seront
réfléchis par un grand miroir.
Quand nous
aurons faim, pour toute cuisine
Nous
grignoterons des fruits de la Chine,
Et nous ne boirons
que dans du vermeil ;
Pour nous
endormir, ainsi que des chattes
Nous nous
étendrons sur de fraîches nattes ;
Nous
oublirons tout, — même le soleil !
Richepin critique le pseudonyme
considérant que le nom Nouveau est tout un programme. Il va donc signer
souvent les poèmes de son vrai nom, sans cependant abandonner les
pseudonymes, qu’il affectionne énormément. Voici son premier poème signé
Germain Nouveau (La Renaissance, 24.V.1873).
Un peu de
musique
Une musique
amoureuse
Sous les
doigts d’un guitariste
S’est
éveillée, un peu triste,
Avec la brise
peureuse ;
Et sous la
feuillée ombreuse
Où le jour
mourant résiste,
Tourne, se
lasse, et persiste
Une valse
langoureuse.
On sent, dans
l’air qui s’effondre,
Son âme en
extase fondre ;
— Et parmi la
vapeur rose
De la nuit
délicieuse
Monte cette
blonde chose,
La lune
silencieuse.
Et voici un autre poème des débuts
(peut-être des premiers mois de 1873, révélé par Richepin en 1927).
Chanson de
mendiant
Je fais mon train
En
mendiant mon pain.
Là-bas
sur la montagne
Je
bâtis ma maison
Avec
du blanc d’Espagne
Et
des petits bâtons.
Je fais mon train
En
mendiant mon pain.
Je
n’ai qu’une chemise
Pour
mon équipement
Et
quand vient la lessive
Je
la sèche au beau temps.
Je fais mon train
En
mendiant mon pain.
Quand
je vais à l’église,
On
me fait comme au roi :
Tout
le monde s’empresse
De
s’éloigner de moi.
Je fais mon train
En
mendiant mon pain.
Ce
qu’on voit à ma suite
À
mon enterrement,
Ce
sont les poux, les puces
Qui
s’en vont en pleurant.
Je fais mon train
En
mendiant mon pain.
Et un autre (1872 ? 1873 ?,
révélé par Richepin en 1927)
Sans titre
Sans verte
étoile au ciel, ni nébuleuse
Sur je ne
sais quel Styx morne, au centre de l’O
Magnifique
qui vibre autour de lui sur l’eau,
Mélancoliquement
mon esprit fait la planche.
Certains voient dans ce quatrain un
lien avec Voyelles de Rimbaud,
mais les dates d’écriture des deux poèmes sont incertaines et ils peuvent
ne pas être liés.
D’ailleurs, on discute beaucoup des
dates, notamment au sujet de la participation de Nouveau à L’Album zutique. Ce dernier a été
écrit essentiellement entre l’automne 1871 et l’automne 1872. Même s’il n’y
a pas de certitude absolue, il semble fort probable que Nouveau y a
contribué, mais vers la fin de 1872 et le début de 1873, après donc que
Verlaine et Rimbaud eurent cessé d’y collaborer en février-mars 1872. Voici
l’une des contributions de Nouveau à l’Album,
signée “Paul Verlaine / G. N.”.
Fêtes galantes
Votre âme est
un Colbert à deux louis,
Que, loin de
l’œil mauvais des maquerelles,
Charment, la
nuit, des anges inouïs
Dont un fard
sombre allume les prunelles ;
Tout en
gardant le calme des Indous
Chacun, parmi
les claires mousselines,
Vous en taille
une avec un geste doux,
Et leur
parfum se mêle au jet des pines,
Au brusque
jet des pines, si savant
Qu’il fait
tomber les âmes en extase
Et s’humecter
d’amour chaque divan,
Et se pâmer
les fleurs au bord des vases !
Paul
Verlaine
G.
N.
Probablement en mars 1874, Germain
Nouveau rencontre Rimbaud. Quelques-uns ont émis de doutes et reculent la
date de la rencontre en raison de la participation de Nouveau à L’Album zutique, mais, pour toute
une série de raisons que nous n’avons pas la place pour les exposer ici,
cela semble impossible. Quoi qu’il en soit, c’est le coup de foudre et les
deux poètes deviennent amants. Rimbaud partant pour Londres, Nouveau, à
l’improviste, l’accompagne. Bien entendu, il continue d’écrire ; voici
un des poèmes datant de son séjour londonien (envoyé à Mallarmé en
septembre 1874, publié pour la première fois dans Les lettres françaises, 7.X.1948 et repris dans Le calepin du mendiant, que nous
évoquerons plus loin).
Janvier
Dans le
palais d’Hiver, écoutez bien, c’est l’aube
Et la
Saint-Valentin entrebâillant les portes,
Et, par les
escaliers en velours, toutes sortes
D’éveils,
soupirs de pas et musiques de robes.
L’Enfant, si
frêle sous d’énormes cheveux d’ambre,
Assise au lit,
de ses deux yeux trop grands dévore
Les joujoux
monstrueux que la nuit fit éclore.
Son âme en
fête a parfumé toute la chambre.
La servante,
jolie Abyssinienne, rêve
Et s’afflige
aux carreaux, car la neige sans trêve
A tué le
jardin, que c’est à n’y pas croire !
Et le rire
ébloui de l’une ne s’achève
Encore, et
l’autre enfant, petite Idole noire,
Se dresse
étrangement sur la Saison d’ivoire.
En juin 1874, Nouveau rentre à Paris,
car il ne supporte plus la vie misérable que les deux amis mènent à Londres.
Il rencontre enfin Mallarmé, dont il devient un grand admirateur.
En 1875 il voyage beaucoup (nord de
la France, Ardennes, Belgique, Londres). Verlaine, qui sort de prison, lui
écrit pour lui faire savoir qu’il a des “poèmes en prose” de Rimbaud, que
celui-ci lui a remis à Stuttgart pour être imprimés. Cela montre que
Nouveau et Rimbaud restent en contact, même si une seule lettre du premier
au second nous est connue et dont nous parlerons par la suite.
Après un aller-retour à Marseille,
Nouveau rencontre, à Londres, Verlaine, qui s’est installé en Angleterre.
Ils deviennent très amis, et il semblerait que l’influence de Verlaine,
alors très porté sur la religion, a été importante dans le développement du
mysticisme chez Nouveau.
Il va à Charleville, sans doute
pensant y trouver Rimbaud. Pendant un mois, il travaille comme surveillant
d’internat, mais comme il fait la noce avec les élèves, il est congédié. Il
revient à Paris et fréquente assidûment le salon de Nina de Villard(2), où probablement
Charles Cros, amant de Nina, l’avais introduit ; avec les deux, il
participe à l’écriture de la pièce Le
Moine bleu. Il reprend la vie de bohème et côtoie le groupe qui
deviendra celui des Hydropathes (Goudreau, Rollinat, Bourget, Ponchon, Arène,
Gill, Valade, Mendès, Mérat…)
En 1876, aux côtés de divers autres
habitués du salon de Nina de Villard, il contribue aux pastiches nommés Dixains réalistes, destinés à venger
le refus de publier dans le troisième Parnasse
contemporain les contributions proposées par Mallarmé Verlaine Charles
Cros et Villard ; le jury était composé d’Anatole France, François
Coppée et Théodore de Banville. Voici deux de ces dizains, le deuxième
étant signé “François Coppé / (G. N)”.
Dixain réaliste VI
On m’a mis au collège (oh! les parents, c’est
lâche!)
en province, dans la vieille ville de H...
J’ai quinze ans, et l’ennui du latin
pluvieux !
Je vis fumant d’affreux cigares dans les
lieux ;
Et je réponds, quand on me prive de sortie :
« Chouette alors ! » préférant le bloc
à la partie
d’écarté chez le maire, où le soir, au salon,
honteux d’un liséré rouge à mon pantalon,
j’écoute avec stupeur ma tante (une
nature !)
causer du dernier bal à la sous-préfecture.
Dixain réaliste X – Après-midi d’été
Dans ce bordel provincial plein de fraîcheur,
Attendant le sonneur, Martin, pauvre pêcheur,
Qui vient tirer son coup entre deux sons de
cloche
Si son gland violet sur sa poche baloche,
Trois filles dorment. — Ah! doux repos
vaginal ! —
Et leur rêve est bercé par le chant virginal
Des enfants de Marie, au jardin de la Cure :
Mais c’est le sacristain qui leur bat la mesure
(Car tout se mêle en songe) et le vit de lilas
Saccade en le rythmant l’Ave Maris Stella.
François
Coppée
(G.
N.)
Nouveau passe l’été, l’automne et
l’hiver 1876-1877 dans le Midi, notamment pour le mariage de sa sœur
Laurence. Il recueille des chansons populaires qu’il envisage de publier,
ce qu’il ne fera jamais, écrit des poèmes sur la famille et sur la région,
des textes qu’il retouchera certainement plus tard, du moins ceux ayant été
publiés de son vivant. Son mysticisme se fait plus présent. Voici deux
poèmes de cette époque, signés Duc de la Mésopotamie.
Fille de
ferme (publié dans La Lune
rousse, 10.XI 1878)
À
André Gill.
En court jupon de laine, et les bras nus, elle
est
Très rose, avec l’œil brave, et sa toison filasse
S’ébouriffe sous sa marmotte, non sans grâce.
Elle va, tord sa hanche, et montre son mollet.
Jouasseuse, et le poing terrible, elle se plaît
Aux bourrades. Sa lèvre éclate en rise grasse.
Et là-bas, dans les foins, le grand brun qui
l’embrasse,
Marche, hanté par ses tétons couleur de lait.
Cette garce pourtant, le soir, devient un ange
Pour les maigres petiots qui couchent dans la
grange.
Quand, pour les endormir dans un signe de croix,
Elle monte baiser au front cette marmaille,
Sa chemise est un rêve, et sainte entre ses
doigts
Sa chandelle met des étoiles dans la paille.
Duc
de la Mésopotamie.
Enchères (publié dans
La Lune rousse, 17.XI 1878)
Au marché de
Saint-Paul j’irai,
Ma petite, et
je te vendrai.
Je vendrai
tes yeux effrontés
Cent beaux
écus fort bien comptés.
Et je vendrai
tes doigts rusés,
Ces oiseaux
mal apprivoisés,
Et ta lèvre
qui toujours ment
Quatre-vingts
doublons seulement
Je vendrai
tes bras fins et longs
Et les roses
de tes talons,
De tes genoux
et de tes seins
Vingt mille
francs napolitains.
Je vendrai le
jour de Saint-Paul,
Et la raie
autour de ton col
Et les jolis
plis de ta chair
Un million,
ce n’est pas cher.
Et ton
chignon tordu, pareil
À l’or
flambant dans le soleil,
Et tes
baisers je les vendrai
Aux enchères
que je tiendrai.
Aux
enchérisseurs les plus forts
Je vendrai
ton âme et ton corps,
Et ton cœur,
s’il est recherché,
Sera
par-dessus le marché.
Duc
de la Mésopotamie.
On peut se demander si le poème Pour toi mon amour de Prévert ne
fait pas écho à ce dernier texte.
Nouveau s’intéresse aussi aux faits de
société, aux personnages populaires et aux questions politiques, comme le
montre cet extrait du long poème Cadenette,
paru dans La Lune rousse du 9.II
1879.
Cadenette
(extrait : vers 1 puis vers 82-126)
Oui, je sais
bien, c’était une grue, et vulgaire !
[…]
Cependant
l’Empereur se jetait dans des guerres !
Puis la
Commune vint.
Alors, — vous
savez bien ! —
Le voyou
blond — celui qui fit d’elle son chien! —
Elle l’a
repris — car, au fond, c’est lui qu’elle aime,
Qu’elle nomme
en pleurant par son nom de baptême
Un nom qui
vous a l’air de faire des façons,
Et dont on
rit — pourquoi ? — quand nous le prononçons.
Oscar, sans
doute, ou bien Arthur ! Elle le gobe,
Ce monsieur,
après tout !
Or un matin, qu’en
robe
De nuit elle
attendait (on était au printemps,
Tout
éclatait, obus et fleurs en même temps)
Elle aperçoit
soudain un grand remue-ménage
Dans la loge de
la maison, puis dans la cage
De
l’escalier. — Elle a deviné : c’est son pas !
Il monte
prestement avec un gai fracas
D’éperons
argentins à ses bottes, il braille
Elle ne sait
quels mots que couvre la mitraille,
Faisant avec
son sabre un affreux bacchanal.
Enfin, grimpé
près d’elle, il parle :
Général !
Ils m’ont
élu ! je suis général ! c’est comm’ Hoche !
Elle le
contempla dans les yeux. Puis : approche !
Fit-elle; Et
le baisant gentiment sur le front,
« Veux-tu
m’emmener ? »
/…
Bah! où,
dit-il ;
Ils
iront,
Comme posant
le pied sur la roue, ô fortune !
Lui, le beau
général de la jeune Commune !
Elle, sa
femme à lui, pleins d’aise et tout effroi
De se savoir
grandis, sans bien savoir pourquoi
Ni
comment ; mais sûrs d’être une pierre qui roule
Délicieusement
à l’abîme ! à la foule
Qui
s’écartait pour eux, semblant dire : Voici !
C’est
nous ! comme c’est beau, hein ! Ils iront ainsi
Jusqu’aux
fusils de la prochaine barricade,
Dans l’odeur
du printemps mêlée à l’odeur fade
Des roses
dont le sang a fleuri les pavés,
Près des
ruisseaux vermeils et des héros crevés,
Des gens qui
vont mourir les deux mains dans leurs poches.
Dans la
terreur montée au cœur des grandes cloches
Qui hurlent
la défaite aux toits de la cité,
Ils iront
dans l’extase et la légèreté
Du
cœur ! jusqu’à ce qu’une escouade versaillaise
L’étende
roide mort.
Ce dont il parut
aise !
Alors voyant
un homme à terre : « attends un peu ! »
Elle prit son
fusil, et fit le coup de feu,
Superbe,
dilatant des prunelles étranges !
Mauvais,
soit, mais tous les révoltés sont des anges !
[…]
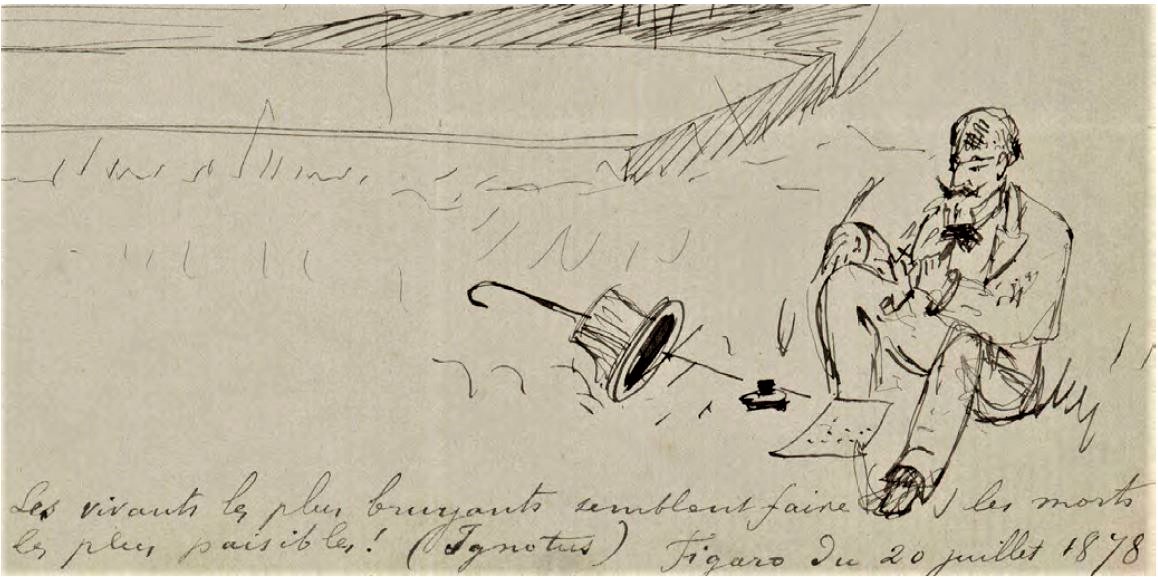
Germain Nouveau, Les
vivants les plus bruyants… [À] Sainte-Hélène. Dessin, juillet
1878 (reproduit d’après le site Cité du livre-Aix-en-Provence dédié au
poète : Jean
Richepin et les Vivants - Germain Nouveau (citedulivre-aix.com)).
En 1877, va à Guernesey et à Arras où
Verlaine et sa mère sont installés. Avec ce dernier, il visite la maison de
saint Benoît Labre, moine mendiant du XVIIe siècle, qui va
devenir son modèle spirituel. Il rencontre Ernest Delahaye chez Verlaine.
L’année suivante, il est nommé
employé temporaire à la division de la Comptabilité du ministère de
l’Instruction publique ; il hypothèque ses biens de Pourrières,
participe aux Hydropathes et noue des liens d’amitié avec Camille de
Sainte-Croix et Léonce de Larmandie ses collègues de travail et aussi
poètes.
Entre 1873 et 1883, il écrit pour des
périodiques de petites proses dont le style est bien caractérisé par cet
extrait de Le manœuvrier, publié
dans La Lune rousse,
11.VIII.1878.
Le manœuvrier (extrait)
Quelle drôle
d’idée a eu son père de lui ouvrir un wagon de troisième sur Paris, comme
s’il ouvrait un coffre-fort avec des piles de louis ; comme il
regrettait déjà les petites maisons blanches du pays, qu’on bâtissait
gaiement, où l’on mettait, avec du beau plâtre, des chemises sur les
cloisons légères, en buvant, en fredonnant. Tandis qu’ici !
Il veut dire
tout ça à son pays qu’il va voir. Après deux heures de marche, il monte
enfin l’escalier, frappe à la porte, refrappe, personne ! sorti !
Dans la
chambre voisine, une voix de femme chante : Anna donna la canne à Canada !
Un enfant
miaule, puis tout se tait. Il se laisse tomber sur les marches, stupide,
vide.
« Qu’est-ce
que vous faites là ? »
C’est le
concierge. Il se lève sans répondre ; le voilà de nouveau dans la rue,
et comme un peu plus seul qu’auparavant. Six heures du soir s’allument au
cadran d’une église neuve, la nuit arrive, plus élégante, plus riante, plus
claire presque que le jour, avec les lumières des voitures, des
restaurants, des théâtres, des concerts, des bals ; une grande envie
de dormir le prend. Il ne dînera pas ; il retournera au petit hôtel
borgne, à son cinquième étage. Dormir ! II va devant lui...
dormir ! II ne sait plus, il s’égare ; il est tard, où est-il
maintenant ? Il s’est perdu dans une rêverie lourde ; il a
traversé tant de quartiers sans voir, sans entendre, somnambule ! Ce
n’est plus la rue ; une espèce de route noire avec des trottoirs et
des becs de gaz, et pas de maisons encore ; les souffles sauvages de
la campagne, et voilà la Seine ! Il entend l’eau, C’est la seule bonne
chose qu’il retrouve, la seule chose qui lui rappelle « chez
nous ! »... C’est comme une amie d’enfance !...
……………..
Il s’est
endormi dans l’herbe : l’eau le berce ; les étoiles le veillent.
En 1879, Nouveau est titularisé au
ministère. Il pense partir en Angleterre avec Verlaine, mais se brouille
avec lui à Arras et revient à Paris ; c’est toujours la vie de
bohème ; il fréquente Mallarmé et est assidu au salon de Villard.
Néanmoins, c’est de cette année 1879 que date le plus ancien poème du
recueil mystique qu’il intitulera La
Doctrine de l’amour, dont nous parlerons tout de suite.
En 1880, il renoue avec Verlaine et
fait pour lui une copie du Christ de saint Géry d’Arras. Son mysticisme
s’accentue.
En 1881, il vit à Paris, est fait
officier d’Académie, termine La
Doctrine de l’amour qu’il envisage de faire éditer avec une préface de
Léonce de Larmandie, mais ne trouve pas d’éditeur. Par la suite, il
abandonnera le projet considérant que le tout ne correspond pas à une
vision théologique correcte. Ce sont souvent des poèmes très longs. Voici
quelques poèmes ou extraits de poèmes du recueil.
Cantique
à la Reine (II)
Aimez : l’amour vous met au cœur
un peu de jour ;
Aimez,
l’amour allège ;
Aimez, car le bonheur est pétri dans
l’amour
Comme
un lys dans la neige !
L’amour n’est pas la fleur facile
qu’au printemps
L’on
cueille sous son aile,
Ce n’est pas un baiser sur les lèvres
du temps,
C’est
la fleur éternelle.
Nous faisons pour aimer d’inutiles
efforts,
Pauvres
cœurs que nous sommes !
Et nous cherchons l’amour dans
l’étreinte des corps,
Et
l’amour fuit les hommes.
Et c’est pourquoi l’on voit la haine
dans nos yeux
Et
dans notre mémoire,
Et ce vautour ouvrir sur nos fronts
soucieux
Son
affreuse aile noire ;
Et c’est pourquoi l’on voit jaillir
de leur étui
Tant
de poignards avides ;
Et c’est pourquoi l’on voit que les
cœurs d’aujourd’hui
Sont
des sépulcres vides.
Voilà l’éternel cri que je sème au
vent noir,
Sur
la foule futile ;
Tel est le grain d’encens qui fume en
l’encensoir
De
ma vie inutile.
Fraternité
Frère, ô doux mendiant qui chantes en plein vent,
Aime-toi, comme l’air du ciel aime le vent.
Frère, poussant les bœufs dans les mottes de
terre,
Aime-toi, comme aux champs la glèbe aime la
terre.
Frère, qui fais le vin du sang des raisins d’or,
Aime-toi, comme un cep aime ses grappes d’or.
Frère, qui fais le pain, croûte dorée et mie,
Aime-toi, comme au four la croûte aime la mie.
Frère, qui fais l’habit, joyeux tisseur de drap,
Aime-toi, comme en lui la laine aime le drap.
Frère, dont le bateau fend l’azur vert des
vagues,
Aime-toi, comme en mer les flots aiment les
vagues.
Frère, joueur de luth, gai marieur de sons,
Aime-toi, comme on sent la corde aimer les sons.
Mais en Dieu, Frère, sache aimer comme toi-même
Ton frère, et, quel qu’il soit, qu’il soit comme
toi-même.
Humilité (IV)
Humilité !
loi naturelle !
Parfum du
fort, fleur du petit !
Antée a mis
sa force en elle,
C’est sur
elle que l’on bâtit.
Seule, elle rit
dans les alarmes.
Celui qui ne
prend pas ses armes,
Celui qui ne
voit pas ses charmes
À la clarté
de Jésus-Christ,
Celui-là, sur
le fleuve avide
Des ans
profonds que Dieu dévide,
Aura fui,
comme un feuillet vide
Où le destin
n’a rien écrit !
Ce recueil se termine pas des
aphorismes, dont nous vous livrons ici quelques-uns
I
Aimer la
Vérité,
C’est aimer
dans son cœur une Naïade blanche.
Le peintre la
demande aux rires des couleurs.
IV
Souvent sous
un méchant se cache un malheureux.
Soyez
doux ; pardonnez. Vos pardons, Dieu les compte.
V
Seigneur !
Amour terrible et Bonté redoutable !
Que l’Esprit
de Bonté nous rassemble à sa table,
Et qu’il
partage à tous le vin et le froment.
VI
Riches, rappelez-vous
les paroles divines ;
Couronnés
d’or, songez aux couronnes d’épines.
VII
Je n’ai pas
tenu sous mes doigts
Une lyre
orgueilleuse et rare,
Mais un
pauvre instrument
Taillé dans
l’arbre de la croix.
En 1882, Nouveau demande au ministère
un congé de trois mois avec traitement complet en raison d’une « convalescence d’une affection
diathésique qui a fortement ébranlé sa constitution », selon le
certificat médical produit. C’est aussi cette même année que paraît pour la
première fois, le sonnet Poison perdu (Le Gaulois, 15 mars 1882), signé Gardéniac (repris sans
signature, dans La Cravache
parisienne, 27 octobre 1888), qui a été tantôt attribué à Rimbaud,
tantôt à Nouveau, mais aujourd’hui il y a un certain consensus pour en
attribuer la paternité à ce dernier.
Poison perdu
Des nuits du
blond et de la brune
Pas un
souvenir n’est resté
Pas une
dentelle d’été,
Pas une
cravate commune ;
Et sur le
balcon où le thé
Se prend aux
heures de la lune
Il n’est
resté de trace, aucune,
Pas un souvenir
n’est resté.
Seule au coin
d’un rideau piquée,
Brille une
épingle à tête d’or
Comme un gros
insecte qui dort.
Pointe d’un
fin poison trempée,
Je te prends,
sois-moi préparée
Aux heures
des désirs de mort.
Il nous semble qu’il est permis de
penser que dans ce texte le blond et
la brune renvoient à Rimbaud et à Nouveau…
En 1883, Germain Nouveau demande un
congé d’un an car il envisage de partir enseigner le français et le dessin
au Liban ; le congé lui ayant été refusé, il cesse de travailler et démissionne
en décembre. En avril 1884, il part pour Beyrouth afin d’y assumer un poste
de professeur de français et de dessin ; c’est un échec. Il n’est plus
payé et se fait rapatrier à Marseille par le consulat de France, mais passe
par Jérusalem et Alexandrie. Il va à Pourrières et à Rousset dans sa
famille. En 1885, paraissent les Sonnets
du Liban, publiés certains dans Le
Chat noir, d’autres dans Le Monde
moderne.
Musulmanes (Le Monde moderne, 28.III.1885)
À Camille de
Sainte-Croix
Vous cachez
vos cheveux, la toison impudique,
Vous cachez
vos sourcils, ces moustaches des yeux,
Et vous
cachez vos yeux, ces globes soucieux,
Miroirs
pleins d’ombre où reste une image sadique ;
L’oreille
ourlée ainsi qu’un gouffre, la mimique
Des lèvres,
leur blessure écarlate, les creux
De la joue,
et la langue au bout rose et joyeux,
Vous les
cachez, et vous cachez le nez unique !
Votre voile
vous garde ainsi qu’une maison
Et la maison
vous garde ainsi qu’une prison ;
Je vous
comprends : l’Amour aime une immense scène.
Frère,
n’est-ce pas là la femme que tu veux :
Complètement
pudique, absolument obscène,
Des racines
des pieds aux pointes des cheveux ?
Nouveau reprend la vie de bohème
notamment en compagnie d’Alfred Valette, Charles Morice, Paul Morisse,
Moréas et surtout Verlaine. Il semble avoir délaissé le mysticisme. Il fait
la connaissance de Valentine Renault, phtisique, probablement prostituée,
dont on ne sait pas grand-chose, sauf ce qu’en dit Nouveau dans son recueil
Valentines (1885-1887).
On discute de la raison de ce
titre : des poèmes à Valentine Renault ou aux Valentines en général,
un terme en vogue en Angleterre avec lequel il était familiarisé ?
Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’ils ont vécu ensemble durant un an et demi.
À la fin de 1885, Nouveau prend des
cours de dessin et en 1886, il exécute une copie d’un tableau de David, qui
est acceptée par le musée de Versailles ; il obtient un poste de
professeur de dessin à Bourgoin, dans l’Isère. En 1887, il fait l’objet d’un
très mauvais rapport du recteur d’Académie : « manque d’exactitude, de méthode, aucun résultat ».
Au printemps, il essaie de faire éditer Valentines,
mais le projet ne se réalise pas. En juillet, il échoue au certificat
d’aptitude et en octobre est envoyé à Remiremont (Vosges), où tout se passe
bien, avec un très bon rapport du recteur de l’Académie de Nancy en juillet
1888. En décembre, il obtient un poste de suppléant à Janson-de-Sailly, à
Paris, où les choses se passent bien dans un premier temps, puis se
dégradent.
En 1889, Nouveau lance le processus
d’édition de Valentines, mais
arrête tout, car il doute de la qualité de ses vers et car aussi il trouve
ces vers frivoles et peu en accord avec sa religiosité. Jusqu’à la fin de
ses jours, de manière obsessionnelle, il tentera de récupérer toutes les
copies et épreuves de ce recueil.
Ces poèmes, sous le titre Valentines et autres vers, seront
édités en 1922 par Messein à l’initiative et par les soins de Delahaye,
mais avec des mutilations et des censures dues, semble-t-il, à la famille.
Les textes originaux ont pu être rétablis grâce à des épreuves de 1889,
revues par l’auteur et qui ont pu être retrouvées. Voici quelques poèmes ou
extraits de poèmes issus de ce recueil.
Vilain
J’ai connu,
Madame, une Dame,
Moi vilain
petit paysan,
Aussi grande
de cœur et d’âme
Que la plus
grande et… fine lame
Et… pleine
d’esprit… jugez-en.
Un soir, mon
âme était complète,
Comme dit,
après avoir bu,
Le jeune
homme qui fait la fête ;
De vrai, je n’avais
plus ma tête,
J’étais
totalement fourbu.
J’avais
l’esprit un peu morose ;
Je ne sais ce
qui traversa
Ma cervelle,
pour quelle cause...
« Comment
perdîtes-vous.., ta rose ?
Oui, Madame,
contez-nous ça. »
Ah ! que
notre bêtise est grande !
Doux Jésus !
Amour de Sion !
Ma langue à
vous se recommande...
Oui,..,
car... pourquoi cette demande,
Ou plutôt.
cette question ?...
Comment
perdîtes-vous... Ta rose ?
Et
j’attendais, me tenant coi.
Alors, tout
doucement, sans pose,
Comme on dit,
hélas ! quelque chose
En songeant à
n’importe quoi.
« Bien
simplement », répondit-elle.
N’est-ce pas
céleste et charmant ?
Cette réponse
est immortelle.
Je voudrais
d’un flot de dentelle
Encadrer
ce : Bien simplement !
Le refus
(extrait : vers 1-5 et 76-95)
Je suis
pédéraste dans l’âme,
Je le dis
tout haut et debout.
Assis, je
changerais de gamme,
Et, couché
sur un lit, Madame,
Je ne le
dirais plus de tout
[…]
Oui, ce
vilain soupçon nous gêne
Et pourrait
submerger un jour,
Près de la niche,
avec la chaîne,
L’Amitié,
cette belle chienne
Qui hurle à
sa lune d’amour.
Pour moi,
vous remarquerez comme
J’ai quelque
grâce à protester :
Passant pour
la moitié d’un homme,
N’aurais-je
pas le droit, en somme,
De chercher à
me compléter ?
Bien mieux,
tiens ! je ne suis pas large,
Mais le plus
raide des paris,
Qu’on me le
tienne, et je me charge
Sous les yeux
du public, en marge,
Du plus vieux
mouchard de Paris !
Or, je ne
suis pas pédéraste ;
Que serait-ce
si je l’étais !
Voyez, Madame,
quel contraste !
Ah ! par
la perruque d’Éraste !
Et
maintenant, si je pétais !
Le baiser III
« Tout
fait l’amour. » Et moi, j’ajoute,
Lorsque tu
dis : « Tout fait l’amour »
Même le pas
avec la route,
La baguette
avec le tambour.
Même le doigt
avec la bague,
Même la rime
et la raison,
Même le vent
avec la vague,
Le regard
avec l’horizon.
Même le rire
avec la bouche,
Même l’osier
et le couteau,
Même le corps
avec la couche,
Et l’enclume
sous le marteau.
Même le fil
avec la toile,
Même la terre
avec le ver,
Le bâtiment
avec l’étoile,
Et le soleil
avec la mer.
Comme la
fleur et comme l’arbre,
Même la
cédille et le ç,
Même
l’épitaphe et le marbre,
La mémoire
avec le passé.
La molécule
avec l’atome,
La chaleur et
le mouvement,
L’un des deux
avec l’autre tome,
Fût-il
détruit complètement.
Un anneau
même avec sa chaîne,
Quand il en
serait détaché,
Tout enfin,
excepté la Haine,
Et le cœur
qu’Elle a débauché.
Oui, tout
fait l’amour sous les ailes
De l’Amour,
comme en son Palais
Même les
tours des citadelles
Avec la grêle
des boulets.
/…
Même les
cordes de la harpe
Avec la
phalange du doigt,
Même le bras
avec l’écharpe,
Et la colonne
avec le toit.
Le coup
d’ongle ou le coup de griffe
Tout, enfin
tout dans l’univers,
Excepté la
joue et la gifle,
Car… dans ce
cas l’est à l’envers.
Et (dirait le
latin honnête
Parlant des
choses de Vénus)
Comme la
queue avec la tête,
Comme le
membre avec l’anus.
Dernier
madrigal (extrait : vers 71-100)
Ah ! comme
je vais bien m’entendre,
Avec ma mère
sur mon nez.
Comme je vais
pouvoir lui rendre
Les baisers
qu’en mon âge tendre
Elle ne m’a
jamais donnés.
Paix au
caveau ! Murez la porte !
Je
ressuscite, au dernier jour.
Entre mes
bras je prends la Morte,
Je m’élève
d’une aile forte,
Nous montons
au ciel dans l’Amour.
Un point…
important… qui m’importe,
Pour vous ça
doit vous être égal,
Je ne veux
pas que l’on m’emporte
Dans des
habits d’aucune sorte,
Fût-ce un
habit de carnaval.
Pas de suaire
en toile bise…
Tiens !
c’est presque un vers de Gautier
Pas de
linceul, pas de chemise ;
Puisqu’il
faut que je vous le dise,
Nu, tout nu,
mais nu tout entier.
Comme sans
fourreau la rapière,
Comme sans
gant du tout la main,
Nu comme un
ver sous ma paupière,
Et qu’on ne
grave sur leur pierre,
Qu’un nom, un
mot, un seul, GERMAIN.
Fou de corps,
fou d’esprit, fou d’âme,
De cœur, si
l’on veut de cerveau,
J’ai fait mon
testament, Madame ;
Qu’il reste
entre vos mains de femme,
Dûment
signé : GERMAIN NOUVEAU.

Germain Nouveau, La
Lectrice. Huile sur bois, 1885, représentant probablement Valentine
Renault, qu’il a rencontrée en juin 1885, l’inspiratrice probable des
poèmes du recueil Valentines (reproduit d’après le site Cité
du livre-Aix-en-Provence dédié au poète : Valentines
- Germain Nouveau (citedulivre-aix.com)).
Notes
©Pedro
Vianna
Voir la
suite dans ce même numéro: 2e
partie
|