|
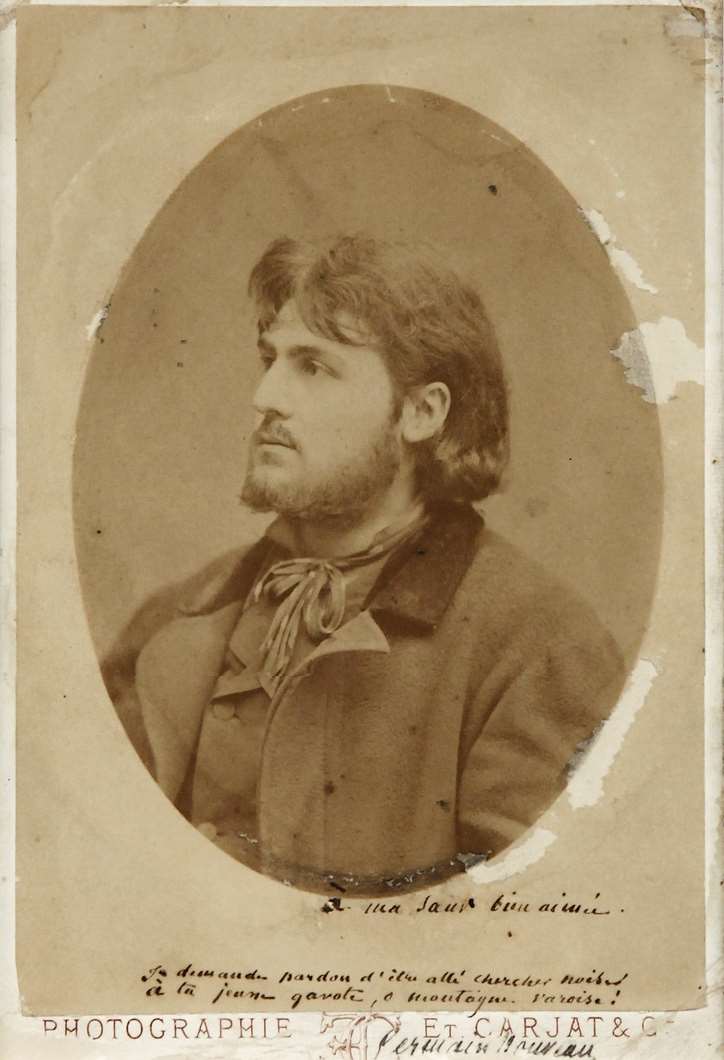
Photographie
par Étienne Carjat (cca.
1873) (reproduite d’après Wikipédia)
En janvier 1890, à sa demande,
Nouveau est en congé pour des raisons de santé. En mars, il reprend un
poste à Janson-de-Sailly, mais son travail est critiqué par l’inspection de
dessin.
Le 15 mai 1891, c’est le grand délire
mystique, qui commence en classe : il se déchausse, se met à genoux,
prie, part dans la rue où il se met à quatre pattes, priant et faisant avec
la langue le signe de la croix sur le trottoir. La consommation d’absinthe
semble y être pour beaucoup, bien plus que son mysticisme. Il est envoyé à
Sainte-Anne puis le lendemain à Bicêtre, où il reste cinq mois. Ses amis,
notamment Camille de Sainte-Croix, tentent en vain de faire publier ses
recueils, mais Noveau lui-même s’y oppose. Après
avoir quitté Bicêtre, il hésite entre partir dans le Midi, faire un
noviciat, partir avec une mission du cardinal Lavigerie en Afrique du Nord,
mais finalement reste à Paris, même si on retrouve sa trace à Bruxelles au
début de novembre, sous le nom de Bernard Marie ; il y lit la Bible et
dessine beaucoup ; il quitte Bruxelles pour Londres, où il pense
trouver un emploi de professeur.
En 1892 il est toujours aux environs
de Londres, de plus en plus plongé dans le mysticisme et dans l’imitation
de saint Benoît Labre ; il songe à faire publier à Paris La Doctrine de l’Amour. À la
mi-avril, il revient à Bruxelles puis durant l’été fait à pied le
pèlerinage de Rome et est expulsé d’Italie pour mendicité. Il passe par
Rousset et en décembre, grâce à ses amis du ministère de l’Instruction
publique, reçoit une indemnité de 150 francs.
Durant presque un an, on perd sa
trace, mais en août-septembre 1893 il est à Marseille, d’où il adresse au
ministère une demande de poste en Algérie ou “aux colonies”, car il est
très atteint par des rhumatismes articulaires aux mains et aux pieds, ce
qui est terrible pour un professeur de dessin. Refus. Malgré tout, il part
à Alger, d’où il adresse une lettre à Rimbaud, qu’il croit encore en vie à
Aden, pour lui demander un avis sur son projet de s’y installer comme
peintre décorateur.
En mars 1894, aux frais de l’Académie d’Alger, il est hospitalisé dans une station thermale
et reçoit quelques indemnités du ministère ; il tente, en vain, d’être
réintégré comme professeur et passe l’année 1895 à Alger. En févier 1896 il
est à Marseille et reçoit de temps en temps des aides du ministère, grâce à
ses amis qui y travaillent.
En 1897 il obtient enfin sa
réintégration et est nommé professeur de dessin à Falaise, dans le
Calvados. D’abord il refuse le poste, mais on lui fait comprendre que ce
serait inadmissible. Il y reste une semaine et démissionne car la ville est
trop froide pour ses rhumatismes. Il repart dans le Midi, où il continue de
recevoir de temps en temps des aides du ministère.
À partir de 1898, il mène une vie
errante dans le Midi, avec quelques passages par Paris ; il fait aussi
de longs pèlerinages à pied en Italie et en Espagne. Il s’installe à
Aix-en-Provence qui reste son port d’attache pendant douze ans. Il mendie,
parcourt les routes en faisant des portraits et chante accompagné d’une
guitare qu’il a fabriquée. Il fréquente également la bibliothèque Méjanes
pour se consacrer à des lectures bibliques.
En 1903, il fait une copie de son Marron travesti, probablement écrit
vers 1896-1897 et supposé être une parodie burlesque de la quatrième
églogue de Virgile (Virgilius Maro),
mais qui n’a pas beaucoup de lien avec l’original, contrairement à un long
poème sans titre (Ça, ma Muse,
chantons) qui figure dans Le
Calepin du Mendiant, dont nous parlerons par la suite. Le texte est
plutôt une satire et une diatribe contre les médecins de Bicêtre. Bien que Nouveau ait essayé de
publier cette œuvre en 1910 et en 1918, le texte n’a été édité qu’en 1935,
probablement par Messein, mais sans dépôt légal, sans indication d’éditeur
ni d’achevé d’imprimer, la seule date indiquée étant 1903. En voici un
extrait, la fin du poème, dans lequel nouveau s’amuse en faisant une
“psychanalyse” de l’Hippolyte de Racine.
Le Marron travesti (extrait : vers
284-307)
Vois le fils de Thésée à
cette heure aux Échos
Qu’à Charenton demain on
mettra, j’imagine,
Car voici ce qu’hier il a
dit chez Racine :
HIPPOLYTE
Le dessin* en est pris (kleptomanie) je pars (aliéné migrateur) cher Théramène
Et quitte le séjour de
l’aimable Trézène. (folie affective)
Dans le doute (folie du doute) mortel (lypémanie) dont je suis agité (agité)
Je commence à rougir (alcoolisme) de mon oisiveté (paralysie générale)
Depuis plus de six mois (folie raisonnante) éloigné de mon
père (persécution)
J’ignore le destin d’une
tête si chère. (folie
des coiffeurs)
J’ignore encor les lieux (perversion des odeurs… atrophie des
nerfs olfactifs)
Que si tu t’obstinais
quand mêmes à venir
Et que déjà réduit à son
pot lui tenir,
Tu tombasses un jour en
agoraphobie
Ou dans théomanie ou
mégalomanie,
De l’exaltation en la
dépression,
Ou délire entraînant classification**
Ou folie empruntée au mal
syphilitique
Ou bien au mal étique, ou
bien au mal phtisique
Ou dans folie encor dite
des cuisiniers,
Teinturiers,
chaudronniers, vitriers, plâtriers :
Tout cela se guérit en
acceptant asile
En te mettant au pot d’une
façon civile,
En écoutant ton cul sonner
l’enterrement,
En prenant ton tombeau
philosophiquement.
* Vieille
orthographe.
** Taximanie ou folie scientifique, c’est le cas de
Diafoirus.
En 1904, Nouveau vient régulièrement
à Paris, dormant dans un grenier rue de Verneuil, par terre dans un sac,
bien que Léonce de Larmandie lui ait
successivement fait apporter trois lits, dont les deux premiers sont vendus
aux Puces par Nouveau ; il ne se sert pas du troisième et pour se
nourrir, il fouille dans les poubelles avec un crochet ou fait la queue aux
distributions de vivres aux pauvres, comme l’a constaté de visu Larmandie.
C’est cette même année que, à l’insu de Nouveau, Larmandie
fait publier La Doctrine de l’Amour
sous le titre Savoir aimer de G. N. Humilis, en partie expurgée, en
partie mutilée car Larmandie part d’un texte
qu’il avait dicté après l’avoir mémorisé avant de le rendre à Nouveau, qui
n’aura connaissance de cette publication que plus tard, en 1910, lors d’une
nouvelle édition sous le titre Poèmes
d’Humilis. Il tentera alors une action en justice. En 1924, Delahaye
republiera le livre sous le titre Poésie
d’Humilis et vers inédits.
En 1905, meurt sa sœur Laurence, avec
qui il s’était brouillé.
En juin 1906, il séjourne à
Saint-Ouen puis fait un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.
En septembre 1907 on le trouve à
Paris ; il envoie un texte à la Société des gens de lettres (SGDL) mais on ne sait pas lequel.
Durant l’été 1908, il séjourne à Rome
et à Naples où il se rend à pied. Son cousin Silvy lui envoie parfois des
mandats.
En 1909, de retour d’Italie, il passe
chez son cousin à Saint-Raphaël puis, durant l’été part à Alger, où il vit
six mois ; peut-être fait-il plusieurs traversées comme gardien de
troupeau. En décembre il va en Espagne et tente, sans résultat, de devenir
religieux dans un monastère de la province de Lérida.
En janvier 1910, il est de nouveau à
Alger, d’où il envoie à son cousin Silvy une sorte de testament, dans
lequel il lui demande de s’opposer par tous les moyens à la publication
d’un quelconque de ses vers et de détruire tous ses manuscrits. Il fait une
nouvelle tentative infructueuse de devenir religieux à la Trappe.
En février, il débarque à Marseille
et s’installe à Aix. Il travaille à un Traité
d’orthographe et, en novembre, envoie à son cousin une pièce en trois
actes en prose, ces textes n’ayant pas été retrouvés. Il essaie d’obtenir
d’un oncle quelque argent en vue d’éditer une petite plaquette, que tout
indique serait le texte Ave Maria
Stella, qu’il fera publier à ses frais en 1912 et dont voici un
extrait.
Ave Maria Stella (extrait : vers 1-12
et 100-119)
À genoux sous ma voile,
Je te salue, Étoile.
Étoile de la mer,
Garde-nous d’abîmer.
L’oiseau pêche en eau
basse,
On part, vive
l’espace !
Mais tout beau ! mon
neveu :
Souvent, hors de tout feu,
Le temps trop tôt se gâte.
Et ce fier brick démâte
Si la Vierge n’y luit,
Tout périt cette nuit.
Garde-nous en voyage
Et sur terre et sur
mer ;
S’il faut faire naufrage,
Surtout de male
mort :
Et de rendu plus sage
Conduis la voile au Port.
Louange à Notre-Père,
(Amour à Notre-Mère),
Et gloire à
Jésus-Christ ;
Honneur il sied de faire
Le même au Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
À la fin de 1910, ayant appris la
publication de ses poèmes en 1904 et en 1910, Nouveau est furieux, allant
jusqu’à citer Larmandie en justice et à demander
l’aide juridictionnelle, qui lui est refusée, la plainte ayant été déclarée
sans suite par le parquet d’Aix.
En septembre 1911, il s’installe à
Pourrières ; il est d’abord accueilli par un cousin buraliste puis, à
la fin de novembre, il achète pour 70 francs une tour en fort mauvaise
état, où il vivra jusqu’à sa mort. Il gagne un peu d’argent en faisant
quelques portraits, mais vit surtout de la charité.
En 1911 et 1912, il lance plusieurs
appels aux secours financiers au ministère, par le biais de son ami
Delahaye. Il essaie aussi de mobiliser ce dernier en vue de la publication
d’Ave Maria Stella, que, comme
nous l’avons vu, il finira par faire éditer lui-même.
En 1913, il tente de relancer la
procédure contre Larmandie et la SGDL ; non-lieu. C’est aussi en 1913 qu’il
commence à écrire son « journal
mensuel rédigé sur carte postale » qu’il appellera ensuite La presse du pauvre. Voici trois
exemples de ces très courts poèmes.
I (31.12.1913, à Ernest Delahaye)
Son curieux numéro
du 1er janvier
1914.
Volera tous les mois vers
des lieux différents
Comme tous les matins
journaux petits et grands
À travers, par dessous, et
par-dessus la ville ;
MAIS DES MIENS, SOUS LA
NUE, IL N’EN PLANE QUE MILLE.
II (17.01.1914, à Ernest Delahaye)
Pour monter jusqu’aux
Dieux, ou piquer une tête,
Qui pourrait, dans les
airs égaler un poète ?
III (entre janvier et mars 1914, à M. et
Mme Moutte ; fragment, le reste ayant été perdu)
Allo ! Allo ! Vu
donc la Concurrence,
Allo, Allo ! ne nous
oyez-vous pas ?
Que s’entre-font dedans le
genre bas
Tant de rimeurs que nous
sommes en France
Nous ferons des
rabais ! et nous aurons un prix
Unique pour tous nos
articles !
— Ne chaussez déjà vos
bicycles
Tous les précédents y compris.
Ce ne sont Nouveautés de
Haute Fantaisie !
Plutôt petits objects de poésie [...]
Nous ne savons pas grand-chose de la
vie de Nouveau pendant la Première Guerre mondiale. Il continue de vivoter
à Pourrières, mais en décembre 1918, il achève un projet datant de 1906, le
Placet rimé au Grand Maître de
l’Université, cette fois-ci remanié pour remercier le ministre de lui
avoir accordé, le 26 mars 1918, une indemnité de 100 francs « à titre éventuel sur le crédit
des encouragements aux sciences et aux lettres ». L’original est
daté 1917-1918. Cet ensemble, très hétéroclite, a été publié dans Le Calepin du Mendiant, dont nous
parlerons bientôt.
Placet rimé au Grand
Maître de l’Université (extrait : vers 1-12)
Le soussigné : poëte fou,
(Rimant assez à loup-garou,)
Qui fut commis d’Ordre, à
vos ordres,
(Rimant trop bien à grands désordres)
Professeur plus tard à
Agen,
(Pour rimer avec Pérugin,)
Et plus tard, en
« pays de Voge »,
Couvant Poussins dessous
sa toge ;
Et, beau jour, de grand’fièvre plein,
(Or, c’était, sans toque,
à Rollin,)
De danser, chanter, dans
sa classe,
À grands gestes de
contrebasse :
La complainte du
professeur de dessin (extrait : vers 49-73)
(Sans oublier la politesse
De vous inviter, chez
Phébus,
À tirer, aux bords du
Permesse,
Le lapin appelé :
rébus.
À pêcher, dans le vert
Permesse,
Sur fond de culotte à
l’envers,
Ce qu’on nomme « de
jolis vers »,
À bâiller avec nos...
Déesses ;
À fumer l’air, quand il
est froid;
À déjeuner de ce qu’on
voit ;
À dîner de ce que l’on
croit ;
À souper de ce que l’on
doit ;
À jouer à jeu qu’on
conçoit.)
Mais le bon dieu de
Médecine
Vous baille toujours bonne
mine,
Et vous préserve de tous
maux
Des laids, aussi bien que
des beaux,
Et d’avoir « un
chancre superbe » (sic !)
Et de vous gratter dessus
l’herbe.
Tout au bas de quoi j’ai
signé
Pour ce malade
condamné :
(Car le DÉLIRE POÉTIQUE,
Comme son frère
alcoolique,
Ne guérit qu’au monde
meilleur,)
Poète fou, grand
rimailleur.
Chanson
Ma bougie est morte
Je n’ai pas de feu
Qu’à la lune, en sorte
Que j’en ai fort peu.
J’ai pour toute escorte
Les rats, les souris…
Si ma Muse avorte,
Je n’en sois repris ;
Puces et punaises,
Araignées, cafards...
Je ne suis à l’aise,
Logé aux Beaux-Arts ;
Le vent sur la face,
À travers le mur,
Quand, de guerre lasse,
Je dors sur le dur ;
Et la pluie qui tombe
À travers mon toit,
Me met dans la tombe,
Plus d’à quatre doigts.
Ma bougie est morte ;
Que pour rire un peu,
Mandat, l’on me porte
Pour l’amour de Dieu
…Novembre
1918
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur
(Hélas ! c’est tout ce que j’ai) de vous remercier des 1 200
deniers dont vous avez bien voulu me gratifier ; mais comment avec
aussi peu de sesterces, car aujourd’hui cent livres, c’est à peine cent
sols, en comparaison d’hier, comment dis-je, avec quatre cents liards (soit
dit pour l’Encouragement aux Sciences) aller à Paris pour prolonger vos
jours, et ceux de Mon Médecin. (Il ne plaisante pas. Vous savez que
généralement ceux de ce genre sont empiriques, plus ou moins.) Toutefois,
j’y vais tâcher, car il n’est rien que je ne sois prêt à faire pour vous
autres. Et puisque, vous nous empruntez volontiers nos formules surannées,
je dirai comme vous diriez, en terminant : Veuillez agréer, Monsieur
le Ministre, la nouvelle assurance (hélas! en fait
d’assurance, prime d’assurance, je n’ai guère d’autre assurance) de mon
entier dévouement.
Oh ! pour cela, vous
pouvez y compter.
Il semblerait que la SGDL ait aussi versé quelques modestes subsides à
Nouveau en 1918. Il vit comme un ascète, prie, lit des textes religieux,
s’applique “la discipline” au moyen d’une ceinture de cuir et va prendre la
soupe à l’hôpital, se chauffant avec le petit bois qu’il ramasse dans les
collines du coin. La famille s’est éloignée du poète, car il lui fait
honte, Nouveau ne craignant pas de dire dans le village « dans les ordures ménagères, il y
a de quoi nourrir des familles entières ».
Il jeûne de façon exagérée et, après
40 jours sans manger, il meurt d’inanition entre le vendredi saint et le
dimanche de Pâques en avril 1920. Il est enterré dans la fosse commune, la
famille se refusant à s’occuper des obsèques. Ce n’est qu’en 1925 que, sous
la pression des amis, la famille a accepté de transférer ses restes dans le
caveau familial, le corps ayant pu être identifié grâce à la ceinture en
cuir dont il se servait pour s’appliquer “la discipline”.
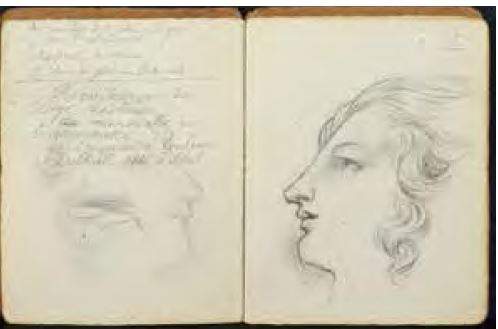
Carnet de notes et de
dessins de
Germain Nouveau, vers 1908-1910, similaire au fameux Calepin du mendiant,
carnet dont la trace a été perdue (reproduit d’après le site Cité du
livre-Aix-en-Provence dédié au poète : Le
Calepin du mendiant - Germain Nouveau (citedulivre-aix.com)).
On connaît d’autres poèmes de Germain
Nouveau, inédits ou publiés à titre posthume, écrits entre 1886 et 1903.
Parmi ces poèmes :
Memorare (date inconnue, in Valentines et autres vers en 1922 ; extrait : vers
71-80, qui font penser à la fin
du poète
Je ferai Quatre-Temps,
Vigiles,
Tout le Carême en sa
rigueur ;
Comme un chrétien des
Évangiles,
J’enchaînerai mes yeux
agiles,
Ne levant au Ciel que mon
cœur.
Je m’infligerai des
supplices
Avec ma corde au nœud
serré,
Ma discipline et mes
cilices ;
Je dois faire aussi mes
délices
Des rires que j’exciterai.
En 1949, Jules Mouquet
a publié, sous un titre de son invention, Le Calepin du Mendiant, des inédits de Nouveau datant de la
période 1886-1903, figurant dans un carnet du poète, soit écrits
directement, soit copiés par l’auteur sur ce support. On y trouve le texte Ca, ma muse, chantons, dont nous avons
déjà parlé et dont voici un extrait.
Ça, ma Muse (extrait : vers
1-17)
Çà, ma Muse, chantons,
pour fort qu’il t’en ennuie ;
Il faut au bout du pont
que je gagne ma vie ;
Les passants de nos vers
fassent donc bon marché.
Prends ta viole et
chantons jusqu’à soleil couché.
Une araignée en fer s’est
emparée des villes,
Des champs, des continents
et de toutes les îles.
On n’entend plus sonner
dans tous les ports de mer
Que le mugissement d’une
vache de fer...
Quel vacarme à minuit
frappe encor mon oreille ?
C’est la bête de fer qui
travaille et qui veille.
Ah ! que de bras aura
son travail étonné !
Que de doigts son travail
au vice détourné !
Il lui sied bien vraiment
d’excuser ma paresse.
Nous vivons pour des fers
qu’on polit et qu’on graisse,
Nous vivons dans les fers
que partout on suspend,
Nous voyageons aux fers
d’un rapide serpent,
Nous nous mettons aux fers
sur le cheval du singe ;
Dans ce “recueil” il y aussi d’autres
poèmes, ainsi que des Bribes et des
Fragments, deuxième partie du livre. En voici quelques exemples.
À J.-A. R… (poème non daté, sans doute postérieur
à 1898, publié dans Les lettres
françaises du 7.X.1948), J.-A. R étant Jean-Arthur Rimbaud.
Et moi, je vois aussi
toute chose autrement,
Et je dis comme vous que
nous sommes un poëte.
De notre père Hugo nous
avons la cravate,
Nous rimons du Phébus dans
le haut allemand.
Tous vos jolis brillants
ne valent par leur boîte,
Ni votre imagerie un
peintre d’ornement.
Quel « absurde »
écolier ! le « ridicule » amant !
Tiens ! « dégoûtant » chanteur de la note inexacte !
Vous qui coiffez les gens,
vous voilà bien coiffé.
Je n’aurai qu’un petit le
bonnet étoffé.
Déjà, s’en mord un doigt
votre grande niaise.
Mais sur elle du goût remportez donc le prix ;
Ou tâche que tes vers,
cirés par antithèse,
Reluisent pour longtemps sous
tes justes mépris !
Rappelons que, à un moment de sa vie,
Rimbaud aimait à se qualifier d’absurde,
de ridicule et de dégoûtant…
Sans
amis, (non daté, paru dans Les lettres françaises du 7.X.1948)
Sans amis, sans parents,
sans emploi, sans fortune,
Je n’ai que la prison pour
y passer la nuit.
Je n’ai rien à manger que
du gâteau mal cuit,
Et rien pour me vêtir que
déjeuners de lune.
Personne je ne suis,
personne ne me suit,
Que la grosse tsé-tsé, ma
foi ! fort importune ;
Et si je veux chanter sur
les bords de la Tune
Un ami vient me
dire : Il ne faut pas de bruit !
Nous regardons vos mains
qui sont pures et nettes,
Car on sait, troun de l’air ! que vous êtes honnêtes,
De peur que quelque don ne
me vienne guérir.
Mais je ne suis icy pour y Faire d’envie,
Mais bien pour y mourir,
disons pour y pourrir ;
Et la mort que j’attends
n’ôte rien que la vie !
La chanson de mon Adonis (non daté, paru dans Les lettres françaises, 7.X.1948)
À quinze ans, un jeun’ de mon âge
Vint me dire un jour :
Aime-moi !
Ce fut là tout notre
mariage
À peu près comme dans les
bois.
Ah ! hi ! hi ! hi ! hi !
hi ! ho ! ho !
Adonis, c’était l’ nom d’ mon homme ;
Quant à moi, l’on
m’appelle Écho,
Le plus fort, c’est qu’au
bar d’ la somme
Il n’
payait jamais son écot.
Après quatre mois de
ménage,
Un beau jour, près de
l’Opéra,
Il me dit : Je pars
en voyage ;
Promets-moi que tu
m’écriras.
Son adresse, ell’ n’arriv’ pas vite :
Elle s’est égarée, je
vois.
Le plus dur, c’est que
dans sa fuite
II ne m’a laissé que la voix.
Tous mes bijoux ont pris
le coche ;
De ma montre j’ai fait mon
deuil ;
Et pas même un mouchoir de
poche
Pour essuyer mon petit
ciel !...
Sans doute, ce poème est un souvenir de
la période de la vie en compagnie de Rimbaud.
Ravaudeuse (non daté, paru dans Les lettres françaises du 7.X.1948)
Ravaudeuse de mes linceuls,
Où la postérité demain me
voudra mettre,
À personne du moins nous
n’aurons dit : Mon Maître,
Comme ces beaux phénix qui
font leurs vers tout seuls.
Dans la correspondance de Germain
Nouveau, qui fut tour à tour monarchiste et républicain, nous trouvons
quelques passages qui relèvent de considérations théoriques :
I. sur la littérature, 2.10.1889, à Léonce de Larmandie
Tous les livres sont
placés vis-à-vis du lecteur dans la même expectative. Toutes les lectures
ne sont pas de tout âge, et chaque auteur a ses âmes d’élection, qui pour
le goûter doivent un peu être faites à l’image de la sienne. C’est ce que
Péladan appelle : la semblabilité du
lecteur. L’expression paraîtrait un peu forte, toutefois il y a beaucoup de
vrai. Mais on est aussi gagné, conquis, dompté. Et le lecteur peut se
trouver compris dans l’un de ces trois termes, et voir s’éclairer une
œuvre, sans qu’il y ait semblabilité.
II. sur le mode de vie et la
religiosité, 25.11.1891, à sa sœur Laurence
Tu me demandes comment je
passe mon temps. Je me couche de bonne heure, et me lève de même. Je
m’arrange pour faire une visite à l’Église, sinon pour la messe entière. Je
finis de dire mes prières, qui sont assez longues, dont j’ai composé
quelques-unes. Si je n’ai pas de courses à faire, et si je ne dessine pas,
(mais je dessine beaucoup) je lis toujours les mêmes livres, (ni journaux ni
rien) que la Bible et l’Évangile. On peut les relire continuellement, c’est
comme si on les lisait pour la première fois, tant il y a de choses qu’on
n’avait pas remarquées. En as-tu un d’Évangile ? Si en as un tu as tout ce
qu’il te faut, et si tu ne le lis pas, tu es privée de toute espèce de
choses sur cette terre.
III. sur la société et la pauvreté, 21.04.1892, à sa sœur
Laurence
Tout mon désir est d’entrer
en religion, ne serait-ce que comme frère lai, si je ne suis pas trop vieux
et si l’on veut de moi.
Continue à demander à Dieu
sa protection pour moi. Les temps sont très difficiles pour les pauvres. La
pauvreté, cette vertu du chrétien, cet état de Notre-Seigneur, cette
vocation de Saint Labre, sont aujourd’hui punies de la prison en Europe. Pauvre malheureuse Europe !
IV. sur la société et les besoins, 14.10.1909, à Ernest
Delahaye
Donc, pour ne pas perdre
le fil de mon sujet, Nature ne nous a donné qu’un seul besoin véritable,
qui est de manger. Mais le Pacte social, pour parler le langage actuel,
l’état social si tu veux, de besoins, oh ! combien, (comme dirait
Verlaine, d’après nos vieux chroniqueurs !...)
oh ! de combien de besoins ne nous a-t-il pas
encombrés, comme celui de faire empeser un faux col, acheter des souliers,
des chaussettes, des caleçons, deux douzaines de chemises, deux pantalons
de fantaisie, avec veston, et casquette ; et trois pantalons habillés
avec jaquette et chapeaux ronds ; trois gilets de 1uxe, deux de
soirée, redingote, chapeau de haute forme, costume de chasse, costumes de
chauffeur, de cycliste, de touriste, etc... gants de luxe, canne de luxe,
etc…

Germain Nouveau, Le
Repas du pauvre. Huile sur isorel, 1909 ? (reproduit
d’après le site Cité du livre-Aix-en-Provence dédié au poète : Aix-Pourrières
- Germain Nouveau (citedulivre-aix.com)).
Enfin, rappelons que Nouveau était un
amateur de pseudonymes : P. Néouvielle, Duc de la Mésopotamie, Jean de
Noves, Gardéniac, Bernard Marie avec ou sans trait
d’union, B.-M. Nouveau, François Bernard,
François La Guerrière, La Guerrière en un ou deux mots, Guerrière, Le
Guerrier, Imbert Dupuis, Bénédict et probablement aussi Largillière, Largellière, Jean de la Noce, Sansay.
Pour conclure, je rappelle qu’en 1953-1955
Jacques Brenner et Jules Mouquet ont publié chez
Gallimard les Œuvres poétiques de
Germain Nouveau, un livre aujourd’hui épuisé, et que les éditions Seghers,
en janvier 1971, ont consacré à Germain Nouveau le numéro 203 de la
collection Poètes d’aujourd’hui.
Nous espérons ne pas vous avoir trop
ennuyé et surtout vous avoir donné envie de lire ou de relire Germain
Nouveau.
©Pedro Vianna
Voir le
début dans ce même numéro : 1ère
partie
|