|
Toujours
dans la belle collection « Littérature occitane – Troubadours »(1),
deux ouvrages consacrés respectivement à Guillaume IX d’Aquitaine
(1071-1126) et à Peire Cardenal
(1180-1278) qui ouvre, le premier, et referme, le second, l’âge d’or des
troubadours.
Le
premier fut comte de Poitiers et duc d’Aquitaine, grand-père d’Aliénor
d’Aquitaine connue pour sa cour d’amour. Il prit la croix et se rendit
jusqu’à Jérusalem, fut néanmoins deux fois excommunié, se battit aux côtés
du roi d’Aragon Alphonse le batailleur contre les Almoravides, guerroya
également contre certains de ses vassaux qui contestaient son autorité.
Le
second, natif du Puy en Velay et de bien moindre noblesse, était destiné à
l’Église et suivit le cursus d’un théologien. Il n’entra
pas cependant dans les ordres, cédant à « la vanité du monde » et
se fit troubadour itinérant avant d’entrer au service du comte Raymond VI
de Toulouse comme secrétaire de sa chancellerie. Il joua alors un rôle
politique en tant qu’ambassadeur du comte, rôle qu’il continua auprès de Raymond
VII avant d’achever sa longue vie à Montpellier à la cour de Jacques 1er
d’Aragon.
Guillaume
d’Aquitaine(2)
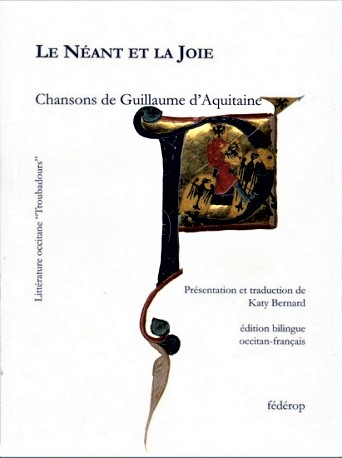
Si
la vie de Guillaume ou plutôt Guillem
d’Aquitaine fut bien occupée à guerroyer et à gouverner ses domaines, il
n’en négligea pas pour autant le beau sexe. Réputé pour le nombre de ses
liaisons, il s’est marié deux fois, a répudié sa première épouse et s’est
remarié à Philippa de Toulouse qu’il délaissa au profit de celle qui devint
durablement sa maîtresse, Dangeirosa (Dangereuse,
sic) de L’Isle-Bouchard, la femme d’un vassal du duc : ainsi allaient
les mœurs chez les grands au Moyen Âge.
Premier
troubadour, il n’inaugure pas vraiment l’amour courtois tel qu’on l’entend
le plus souvent, c’est-à-dire comme une liaison plus spirituelle que
charnelle. Ainsi, dans le poème qui débute par Ben vueil
que sapchon li pluzor
(Je veux que vous connaissiez le plaisir)(3),
n’est-il question que d’amours très incarnées :
Je
m’amigu’anueg no m’aura
Que
no.m vueill’aver l’endema ;
Qu’ieu soi be d’est mester, so.m va ;
Tant
ensenhatz
Que
ben sai gazanhar mon pa
En
totz mercatz.
Jamais
mon amie ne m’aura / Sans me vouloir le lendemain : / Car en ce
métier, je m’en vante, / J’en connais tant / Que je sais gagner mon pain /
En tout marché.
Témoignage
de la virtuosité du poète, cette canso
(chant) comporte huit coblas (strophes) de sept vers (quatre
octosyllabes, un demi-octosyllabe, un octosyllabe, un demi-octosyllabe)
suivies d’une tornada (envoi) de six vers.
Les rimes changent toutes les deux strophes sauf pour les vers de quatre
pieds qui conservent leur rime en « atz ».
Guillaume
a su pourtant exprimer la jois (joie) du
poète en proie à un amour idéalisé ou non.
Anc
mais no poc hom faissonar
Cors,
en voler ni en dezir
Ni
en pensar ni en consir ;
Aitals
jois non pot par trobar,
E
qui be.l volria lauzar
D’un
an n’i poiri’avenir.
Jamais
nul ne put concevoir / Ce corps, par vœu ni par désir / Ni par pensée ni
par esprit ; / Cette joie-là est sans pareille ; / À
qui voudrait bien la louer / Un an ne lui pourrait suffire.
Si
l’œuvre qui nous reste de Guillem est peu abondante,
elle est néanmoins suffisamment variée, contenant par exemple un conte où
il s’imagine jouant le rôle d’un muet dans le but de séduire deux amantes à
la fois et où celles-ci, pour vérifier qu’il ne ment pas, le forcent à
se déshabiller et le font griffer par leur chat :
Quant
aguem begut e manjat,
Despulley-m’a
lur voluntat ;
Derreire m’aportero.l cat,
Mal
e fello ;
Et
escogeron-me del cap
Tro
al talo.
Après
avoir bu et mangé, / Je me dévêtis à leur gré ; / Sur le dos m’accrochant
le chat, / Traître et méchant, / Elles m’écorchent de la tête / Jusqu’aux
talons.
Le
recueil se clôt sur un chant de « pur néant », un non-portrait du
duc désormais vieillissant, exercice de style qui va ici bien au-delà de la
simple prouesse formelle.
Farai
un vers de dreit nien :
Non
er de mi ni d’autra gen,
Non
er d’amor ni de joven,
Ni
de ren au,
Qu’enans fo trobatz
en dormen
Sus
un chivau.
Je
fais un chant de pur néant : / Il n’est de moi ni de nul autre, / Il
n’est d’amour ni de jeunesse, / Ni de rien d’autre, / Puisqu’il fut
trouvé en dormant / Sur un cheval.
À
noter que ce chant du néant ou plus précisément du rien eut une certaine
postérité, même si l’on ne saurait affirmer que les auteurs concernés
furent influencés de près ou de loin par Guilhem. Citons par exemple
Éloge de rien attribué à Louis Coquelet (1676-1754) et publié
anonymement en 1730 ou, plus proche de nous, Éloge du rien (1990) de
Christian Bobin.
° °
°
Peire
Cardenal (4)
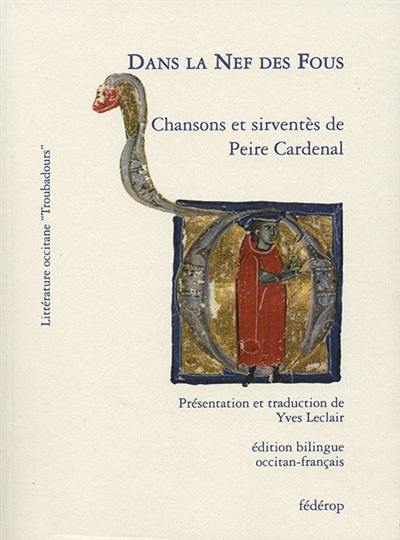
Peire Cardenal commença sa carrière de troubadour par des cansos à nature religieuse et des chants d’amour
courtois, parfois très brefs comme celui commençant par Desirat
Ai(5), une seule cobla (verset) de huit vers qui
débute par le quatrain suivant :
Desirat
ai, enquer desir,
E
voil ades mais desirar
Que
tener ma dona et baisar
E
luec on m’en pogues jausir !
J’ai
désiré, encor désire, / Préfère à jamais désirer / Que tenir et baiser ma dame / En un lieu où j’en pourrais jouir.
Toutes les cansos ne sont pas aussi respectueuses du beau
sexe. Ainsi le poème qui s’ouvre par ce quintet :
Ben
teinh per fol e per muzart
Cel qu’ab amor se lia,
Quar en amor pren peior
part
Aquel que plus s’i fia :
Tals se cuida calfar que s’art.
Vraiment
je tiens pour fou et un musard / Celui qui à l’amour se lie / Car en amour
prend la pire des parts / Celui qui d’autant plus s’y fie, / Comme on se
brûle en croyant se chauffer.
La suite n’arrange
rien qui engage à trahir autant qu’on est trahi :
De
leial ami cove
Qu’om
leials amics sia
Mais
de leis estaria be
Qu’en
galar se fia
Qu’om
galies, quan sap de que.
Il
convient, d’une amie qui est loyale, / Qu’on lui soit un ami loyal. / Quant
à celle qui se plaît et complaît / Dans le jeu de la tromperie / Il faut la
tromper, quand on sait comment.
De
fait, Cardenal est surtout connu pour la verve
sarcastique qu’il exerce à l’égard des femmes et plus encore à l’égard des
riches et des puissants. Renonçant aux cansos,
le troubadour cultive alors le sirventès, poème à caractère
historique (comme chez Bertran de Born) ou, en
l’occurrence, satirique et moral :
S’us
paubres homs a emblat un lensol,
Laire es clamatz ez ananra cap cli,
E
s’us rics homs a emblat mercuriol,
Ira
cap dreg en la cort Costanti ;
E
si.l paubres
a embla una veta,
Pendra
lo tals q’a emblat un ronci.
Si
un pauvre homme a dérobé un drap de lit, / Proclamé voleur, il s’en ira
tête basse, / Mais l’homme riche qui a volé la boutique / Ira tête haute en
la cour de Constantin. / Et le pauvre qui n’aura volé qu’une bride / Sera
pendu par qui a volé un cheval.
« Suivant
que vous serez puissant ou misérable / Les jugements de cour vous rendront
blanc ou noir » écrira La Fontaine dans Les Animaux malades de
la peste…
Les
nobles ne sont pas davantage épargnés, ceux du moins qui prirent le parti
des Français lors de la croisade des Albigeois. Car Peire
Cardenal, au service des comtes de Toulouse qui
résistèrent autant qu’ils purent à l’envahisseur, puis d’un roi d’Aragon
hostile à l’inquisition, n’a cessé de dénoncer les exactions des
conquérants qui sapaient la culture d’oc tout en défigurant la religion
chrétienne.
Ricks homs quan fai
calendas
E
sas cortz e sas bevendas,
De
toutas et de rozendas
Fai
sos dons e sas esmendas
E
sos lums e sas offrendas,
E
de raubaria.
Quand
un homme puissant donne ses fêtes / Et ses assemblées et ses beuveries, /
Ce sont de rapines et de rançons / Qu’il tire ses dons et réparations. / Et
ses luminaires et ses offrandes / viennent de ses pillages.
C’est
néanmoins à l’égard des gens d’Église que Cardenal
se montrera le plus impitoyable. Ainsi dans un poème qu’il qualifie
lui-même d’estribot, soit ici un poème
satirique boitant sur une seule rime, dans lequel il dénonce les abus des
clercs et plus précisément les péchés de chair des bénédictins (« les
moines noirs »).
Si
avetz bela femna o es homs molheratz,
El
seran cobertor, si.eus pez o si.eus platz ;
E
can el son desus e.l
cons es sagelatz
Ab
las bolas redondas que pendon al matratz,
[…]
Aiso fon monge negre en loc de caritatz.
S’il
se trouve une belle mariée à un homme, / Ils seront ses couvertures (qu’il
vous plaise / Ou pèse) ; et quand ils sont sur elle, son con est / Scellé
à leurs boules rondes pendant au dard, / […] / Ainsi font les moines noirs
la charité.
Si
Cardenal n’a jamais professé ni rejoint l’hérésie
cathare, il en était plus proche par l’esprit que de l’Église des
« Français », celle des inquisiteurs, des riches prélats et des
moines lubriques qu’il attaque sans retenue.
Cardenal n’est pas le
plus raffiné des troubadours. Il préfère l’efficacité aux contorsions de
certains de ses collègues qui privilégiaient la forme au détriment du sens.
Il n’en était pas moins capable d’élaborer de savantes constructions comme, par exemple, dans le sirventès débutant
par Ab votz d’angel
(Une voix d’ange) qui enchaîne sept coblas unisonans
(quatre rimes identiques dans toutes les coblas) de huit vers
chacune, soit quatre décasyllabes suivis de deux octosyllabes et à nouveau
deux décasyllabes. Ici, et pour conclure ce compte rendu, la cinquième
strophe :
Esperitals
non es la lur paubreza :
Gardan
lo lor prenon so que mieus es.
Per
mol gonels, tescutz de lan’engleza,
Laisson
selis, car trop aspre lur
es.
Ni
parton ges lur draparia
Aissi com saints
Martins fazia :
Mas
almorans, de c’om sol sostener
La
paura gent, volon totas aver.
Non,
leur esprit n’est pas de pauvreté / Car ils gardent leur bien et prennent
le mien. / Pour de molles robes tissées de laine anglaise, / Ils laissent
le cilice qui leur est trop âpre, / Ils ne partagent pas leur vêtement / De
la façon de Saint Martin. / Les aumônes par quoi d’habitude on soutient /
Les pauvres gens, ils veulent toutes les avoir.
La messe est
dite !
Notes
©Michel Herland
|