|
On ne saurait assez remercier
Jeanne pour ce passionnant témoignage mettant en lumière une
historiographie gravitant autour d’un grand personnage de notre « île
point ». C’est la métaphore qu’employait souvent Jeanne lors de nos
conversations pour désigner notre petitesse géographique… L’île point.
Point sur lequel
Malcolm n’aura pas été d’accord, car ce dernier voyait grand et avait une
vision tectonique du site de ses mythologisations
et de la scénographie de son invention d’un imaginaire fondateur.
Le livre de
Jeanne Gerval ARouff : Pour Malcolm de Chazal, L’essentiel monolithe
est involontairement une fresque à la dérobée des dernières heures de la colonialité triomphante et des prémices de la décolonialité balbutiante. Malcolm, tout comme Jeanne
d’ailleurs, peut être considéré comme un parangon de cette alternance
sociétale et civilisationnelle enchâssée dans une géopolitique de la
sensibilité et du savoir.
Le titre de l’ouvrage
semble gentiment contredire Jean-Marie Le Clézio qui a affirmé dans une
conférence à l’auditorium Octave Wiehe de
l’université de Maurice le 20 septembre 2002 (et que Jeanne rapporte dans
son ouvrage p.91) que « l’œuvre de Chazal n’est pas monolithique. »
Et il ajoute une réflexion explicative qui résume en trois courtes phrases
mon propre ressenti parfois en lisant du Chazal : « Sa logique est
celle du mouvement. Il procède par retouches. Le terme de repentir en
peinture, s’applique encore mieux. » Son écriture serait selon Le
Clézio une « littérature-peinture ».
*
L’Essentiel Monolithe de Jeanne est un vibrant hommage à Malcolm
de Chazal, monument emblématique de notre histoire culturelle récente, que
dis-je, le point d’orgue de notre fin de siècle colonial, génie
auto-proclamé, disaient en son temps ses détracteurs dans le vase clos de
la colonie, car l’île se trouvait encore sous le joug britannique, mais
consacré génie quand même, ailleurs, en métropole où cela comptait encore,
auréolé dans le milieu littéraire parisien au cœur d’un chassé-croisé de
prestigieux stars qui tenaient alors le haut du pavé : Jean Paulhan, Jean
Dubuffet, de Lacretelle, André Breton, Francis Ponge…
L’œuvre de Malcolm de Chazal
avait beau suscité un certain remous dans l’avant-garde parisienne avide
d’idées novatrices, à Maurice elle ne provoquait que dérision et
incompréhension. Il nageait à contre-courant dans la mentalité et la
bien-pensance des puissants du système colonial. Il était donc leur bête
noire, leur paria. Tel un héraut des temps nouveaux, Chazal s‘est tôt rangé
du bon côté de l’histoire.
Le narratif du dispositif
esthétique chazalien moqué surtout par sa
communauté héréditaire devint au fil du temps un leitmotiv, un genre de
récit mythique qu’il revisitait souvent en écriture dans la presse, dans sa
correspondance et à la radio (le son familier de sa voix résonne encore
dans mes souvenirs de ce temps jadis quand adolescent, j’écoutais ses
causeries à la radio).
Malcolm de Chazal échangeait
beaucoup avec ceux qui appartenaient à sa famille d’esprit. Il aurait été
aujourd’hui sans conteste un fervent défenseur des réseaux sociaux et aurait
été un excellent facebooker. Il avait de très bons rapports avec la presse.
Il publiait régulièrement en éditorial dans Le Mauricien où son ami
André Masson était rédacteur en chef, et dans Advance qui devint son
porte-voix par affinité idéologique. Il connaissait tous nos chroniqueurs
culturels de cette époque des années 1960-1970. René Noyau, adepte de la
séparation des genres, jugeait sa picturalité à l’aune des conventions
traditionnelles de l’art moderne et déplorait ses maladresses techniques. Il était toutefois le seul du petit
groupe d’initiés de la chronique (davantage mondaine que culturelle) à ne
pas céder à l’encensement unanime du talent pictural de Malcolm de Chazal ;
son analyse est circonspecte (Advance 5.7.1958 – « Le cas Malcolm de
Chazal »). Si la recension de Pierre Renaud était en adéquation avec
le Zeitgeist, celle de Marcel Cabon se focalisait
sur la littérature, il sous-estimait l’interdisciplinarité.... Yves Ravat et Max Moutia par contre s’intéressaient davantage à la
singularité du personnage pittoresque et à ses excentricités qu’à la
signification de son iconographie dans l’édifice de son œuvre totale
(philosophico-littéraire et plastique). Cependant, Malcolm, conscient des
carences de la critique locale, ne ratait jamais de répondre avec une
exubérance juvénile à chaque fois qu’on le caressait dans le sens du poil.
La gent féminine par
contre avait une réception totalement différente de l’œuvre chazalienne et Malcolm divulguera les raisons fondamentales
de cette anomalie dès la première lettre de sa correspondance avec Jeanne
Gerval ARouff en réponse à l’article de cette dernière paru le 7 octobre
1959 dans Le Mauricien.
« Chère Mademoiselle,
vous avez été prophétesse. Et n’avez-vous pas été la seule à l’exposition
de Rose Hill à m’acheter un tableau ? » Cette exclamation
emphatique de reconnaissance est à la fois spontanée et sincère.
L’appréciation impulsive et l’enthousiasme de Jeanne le touchent
profondément et exaltent son ego. Par ailleurs l’épithète prophétesse est
appropriée quand on sait que Jeanne compte parmi les premiers
inconditionnels de la secousse tellurique du phénomène Chazal dans le monde
des idées et dans le paysage culturel de Maurice.
Et Chazal renchérît : « Mademoiselle,
vous si compréhensive, permettez-moi maintenant de vous parler à cœur
ouvert : les femmes sentent des choses que leur intelligence n’a
même pas conçues.
L’esprit des femmes sent le
souffle de l’avenir, alors que le reste des hommes est encore à questionner
l’horizon. »
Si ce premier échange
épistolaire ébauche déjà le prototype du récit épique de la révélation esthétique, un condensé qui servira désormais de leitmotiv, tel l’essence
ou le principe directeur d’une œuvre musicale, s’amplifiant crescendo en d’innombrables
articles de presse et de causeries radiophoniques, il nous aura appris
subrepticement que Jeanne a été sans conteste la première à acquérir une
œuvre picturale de Malcolm de Chazal. Elle doit avoir mentionné cette
acquisition hors-micro au cours de nos entretiens en vue de mon livre Visite
D’Atelier (en cours de parution). Dans son Intérieur polyvalent à
l’instar de Magritte peignant dans son living bourgeois bien rangé, je n’ai
vu que ses propres œuvres, hormis ces deux pages du cahier Culture de l’Express
du lundi 9 septembre 2002 qu’elle a créées pour la commémoration du
centenaire de la naissance de Malcolm, pieusement encadrées en diptyque
telles des ex-votos.
Contrairement à quelques autres
protagonistes de mes interviews qui s’appropriaient sans vergogne des
maniérismes de Malcolm, absolument rien dans les travaux de Jeanne ne
trahissait des velléités de référentialité
formelle. Elle évite ce répertoire iconographique unique qui fait les choux
gras des nombreux épigones. En revanche elle semble s’inspirer de la trame
spirituelle reliant toutes ces valeurs épidermiques reflétées par ces motifs fétiches : ananas, dodos, fleurs-fées, chaussures de plage,
palmiers-baobab et j’en passe. La grande diversité des nombreuses œuvres
échelonnant le long parcours de l’autrice documenté dans l’ouvrage en
donnent la démonstration.
Le déracinement du biotope culturel
indianocéanien (fin 60) et le long exil de
presqu’un demi-siècle dans l’univers occidental, matrice civilisationnelle
des colonisés, aliénaient au premier abord mon jugement par un brutal
inversement de perspective, je m’en rendis compte en interviewant Jeanne en
2012, chez elle à Floréal, après avoir dialogué avec une flopée d’artistes
des arts visuels de l’île proposée par le ministère de la Culture. Tous ces artistes du présent se voulaient contemporains, dans le
sens chronologique certes. Cependant, ils ne l’étaient pas dans le sens
générique du terme, à l’instar de Jeanne adepte des axiomes de son maître à
penser Malcolm de Chazal. Bien avant l’avènement du genre Contemporain des
années 60, de ce glissement de paradigme qui prône « l’extension de la
notion de l’art » (Joseph Beuys), Malcolm de Chazal n’était-il pas
déjà connu pour ses postures intellectuelles de transdisciplinarité d’art
total ?
Ce n’est pas par hasard que Jeanne
Gerval ARouff soit la personne à qui notre grand homme confiera en 1976 son
ultime testament, à l’Hôtel National, QG de Malcolm comme chacun sait, dans
des circonstances conspiratrices dignes d’un scénario de polar, et dont
Jeanne Gerval ARouff nous fait part dans la «
Lettre à Malcolm » qui préface la publication de L’Autobiographie
Spirituelle en 2008 chez L’Harmattan. Elle a
déjà publié ce document sous le titre de Le Pré-Natal
dans le magazine 5Plus en 1991, et il est intégré dans la trame de
L’Essentiel Monolithe.
Cette publication de l’Autobiographie
Spirituelle à L’Harmattan, figurait parmi les
références consultées peu avant de venir à Maurice pour rencontrer les
protagonistes de Visite d’atelier. Hormis quelques reproductions
visionnées sur ordinateur à Düsseldorf, j’ignorais toutes les activités
annexes de Jeanne Gerval ARouff, bref
l'essentiel, voire la dimension interdisciplinaire de la démarche de la
plasticienne. Je misais donc sur le dialogue pour rectifier le tir...
Jeanne Gerval ARouff
est peut-être très touche-à-tout, mais ses multiples centres d’intérêt sont
abordés en profondeur. Elle m’a montré lors de nos entretiens une masse de
témoignages soigneusement archivés qui dévoilent, outre les affinités
évidentes avec Chazal, une rétrospective exhaustive des différentes étapes
de l’ensemble de son œuvre.
Certains textes de Jeanne (lettres
privées, lettres ouvertes et échanges fictifs d’outre-tombe inclus)
évoquent une connexion spirituelle qui transcende le plan terrestre.
L’œuvre de Chazal exerce sur Jeanne un puissant ascendant ésotérique, une Seelenverwandschaft dirait-on en
allemand.
Pour Malcolm de Chazal, L’Essentiel
Monolithe est certes un
tour de force de documentaliste au service du rayonnement de la tête de
proue de notre contemporanéité postcoloniale, mais se distingue par un
genre de duo-selfie avec le génie Chazal et l’auteure pluridisciplinaire
qui démontre ses facultés de passer avec aisance d’un médium à un autre. Elle est journaliste, écrivaine,
essayiste, poétesse, plasticienne, chroniqueuse commentant à chaud
l’historiographie culturelle, critique d’art, pasionaria de la mémoire
collective occultée de l’icône Chazal, elle est tout ça simultanément ou
successivement. Elle assume surtout son rôle de disciple, fan
inconditionnel de l’incontestable superstar Malcolm de Chazal. Et l’on ne
peut que compatir à sa détresse et à son incompréhension à l’égard de
l’indifférence de nos compatriotes à honorer dignement le souvenir de ce
grand homme dans l’espace public, même pas une pierre d’achoppement devant
sa maison natale.
*
2002 a été une année faste pour ce mode de
chronique personnalisée qu’invente Jeanne pour s’adresser au génie disparu,
car persuadée « qu’il demeure à jamais », elle a retenu
l’usage de la lettre pour tout partager avec Malcolm. Cette
communication à sens unique débute en fanfare avec la lettre commentant la
conférence de Jean-Marie Le Clézio le 20 septembre à l’auditorium
Octave Wiehe et s’étend à toutes les
manifestations « au fil des événements » ayant un lien de près ou de
loin avec le souvenir de Malcolm.
Elle déambule les pistes empruntées
par les intellectuels d’antan pour se rencontrer dans des endroits jadis
légendaires du vieux Port-Louis, mais aujourd’hui disparus ou délabrés en
attente de faire place à une douteuse modernité. Elle évoque par des
épisodes et des anecdotes, qui faisaient parfois le tour de l’île,
l’ambiance culturelle et le débat d’idées à l’étroit dans la colonie à la
veille de l’émancipation politique, puis traversant la transition, abordant
l’indépendance… Ces esquisses sont imbues par l’empreinte et le
charisme du mage. Elles ébauchent pour la postérité les
éléments d’une historiographie plausible de la vie culturelle à une époque
charnière de notre patrie.
On imagine, comme à rebours, le
temps de lire ces brèves chroniques, des gens que l’on a côtoyés,
que l’on a connus vaguement, des amis aussi et des ombres familières
esquissant le décor social de cette avant-indépendance insouciante,
et des bouleversements qui s’ensuivirent…
Toutes ces réminiscences du
temps de l’insouciance, pêle-mêle, suivant à la piste l'aura du mage dans
l’espace et dans le temps nous font rêver. On a plein la tête des
senteurs de la légèreté de cette époque pas si lointaine…
et des odeurs de la ville portuaire si présentes dans les tableaux de
Fabien Cango.
On dirait bien oui à
cette invitation au rêve d’une île apaisée, d’un éden se
rapprochant de l'utopie chazalienne.
*
Jeanne est sculptrice et l’élégante
facilité à s’adapter aux contraintes de matériaux réfractaires surprend.
Elle impose au basalte des formes élémentaires que l’on associe aux
propriétés structurelles de cette matière et n’intervient qu’avec des
inscriptions sur les surfaces planes de figures cubiques. Le respect de la
matière prime sur la forme. Les sculptures en basalte, matière qu’elle
nomme « notre pierre identitaire », ont toujours, même en modèle réduit,
l’aura de monumentalité de vestiges archaïques : dolmens, menhirs…
Et le titre de cet ultime hommage
de Jeanne envers Malcolm : l’essentiel monolithe, évoque les forces
tectoniques et spirituelles à la base de la monumentalité sculpturale et
archaïque de son sujet, le mégalithe Chazal.
Serge Gérard
Selvon
Plasticien et théoricien
de l’art
40217
Düsseldorf, Allemagne
serge.selvon@mac.com
https://www.sergeselvon.de
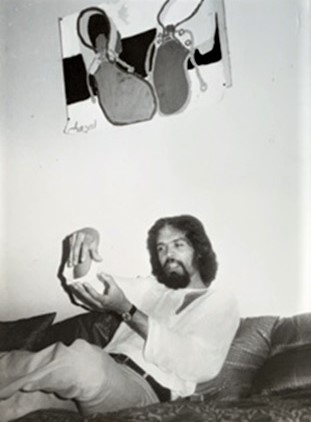
C’est l’unique photo de moi en 1969
dans mon atelier à Rose Hill où l’on peut voir un de mes deux
gouaches de Malcolm fraîchement acquises à mon arrivée à Maurice après 5
années d’études à l’académie des beaux-arts de Düsseldorf. Les
couleurs du Chazal sont beaucoup plus vives que sur la photo jaunie…
et la gouache est sommairement épinglée au mur, o sacrilège
! Plus grave encore, la gouache peinte sur du papier fait main que
Chazal employait a été un peu amochée pendant un dramatique
déménagement. J´ai trouvé un expert de la restauration de papier pour
me défroisser ce coin gauche qui n’est heureusement pas déchiré, et cela va
me coûter, je ne sais combien de fois plus que j’ai payé pour l’œuvre en
1969…

S. G. S.
|