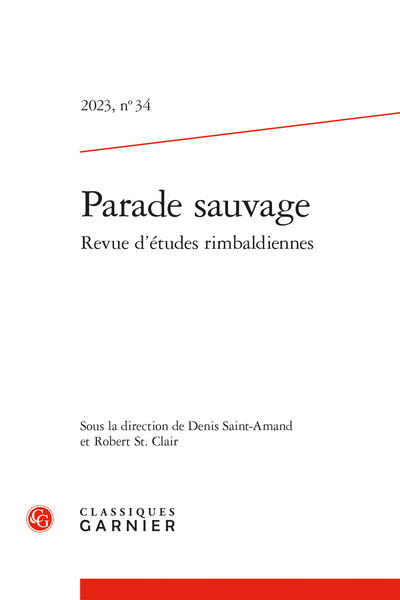|
LECTURE - CHRONIQUE Revues papier ou
électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |
|
|
LECTURES – CHRONIQUES – ESSAIS Été 2024 Lectures érotiques
de Rimbaud : Parade sauvage n° 34 Chronique par
Michel Herland (*) Parade
sauvage – Revue d’études rimbaldiennes, sous la
direction de Denis Saint-Amand et Robert St. Clair. N°
34, Classiques Garnier, 474 p., 42 €. |
|
Rimbaud,
l’idole de la jeunesse qui s’affiche sur les murs de nos villes (moins
aujourd’hui, il est vrai, que naguère et l’on ne peut que le regretter si
l’on voit là un signe de la ruine d’une culture jeuniste qui préfère
désormais les rimes faciles du rap), ce Rimbaud, donc, n’a pas toujours été
lu comme le font les spécialistes d’aujourd’hui qui décryptent sous les mots
apparemment innocents du poète une verve gauloise pour ne pas dire
scatologique et pornographique. Les
articles réunis dans le premier dossier de la revue font hommage à Marc
Ascione, fin herméneute, qui a « démontré la présence et importance
d’une polyphonie diastratique dans l’entièreté du corpus poétique et dans la
correspondance rimbaldienne, mais aussi engagé un mouvement d’exploration des
usages et effets de la langue verte dans les textes des poèmes ». C’est
de ce second aspect qu’il sera surtout question dans ce dossier. Certaines
clés du sous-texte (au sens du texte caché) rimbaldien sont déjà connues mais
les ressources des exégètes semblent sans limite et ils nous convainquent que
les significations d’un mot a priori anodin peuvent être multiples et
qu’il suffit de les chercher. Confronter un poème ou un texte (comment
qualifier Une saison en enfer de poème ?) entre eux peut d’ailleurs
aider à déceler de nouvelles interprétations. Il
est impossible de rendre compte de toutes ces trouvailles ou de toutes ces
hypothèses qui sont pour la plupart, ainsi que l’écrit l’un des
contributeurs, à strictement parler indémontrables. Certaines, néanmoins, ne
laissent pas place au doute car directement empruntées à la langue argotique,
comme la stance conclusive du poème « L’Aube » (Les
Illuminations), « Au réveil il était midi » : il est midi
se dit en effet d’un homme qui connaît une puissante érection. Même sens pour
l’expression « quand le clocher sonnait douze » de « Nuit de l’enfer »
(Une saison en enfer), l’aiguille pointée vers le chiffre douze
symbolisant l’érection. Le sens est d’ailleurs conforté, dans ce cas, par la
notation qui suit : « le diable est au clocher, à cette
heure ». Notons qu’Alain Bardel, l’auteur de l’article en question, l’a
intitulé « ‘Being Beauteous’ ou les ‘zolismes tardifs’ » en
référence à l’article « fondateur » de Marc Ascione et Jean-Pierre
Chambon, « Les zolismes de Rimbaud » (Europe, mars-juin
1973). Le terme « zolisme » fut créé par Verlaine au sens de
« grossièreté », Zola étant considéré par une partie de la critique
de son temps comme un auteur ordurier ! Dans
un autre registre, on peut signaler l’article qui revient sur le poème
« Les chercheuses de poux », ces « deux grandes sœurs
charmantes » qui « font crépiter […] sous leurs ongles royaux la
mort des petits poux » dans les « lourds cheveux [de l’enfant] où
tombe la rosée ». Ces deux sœurs ont été identifiées par l’ex-professeur
et ami de Rimbaud, Georges Izambard, aux demoiselles Gindre de Charleville.
L’auteur, Benoît de Cornulier, propose d’y voir plutôt deux « bonnes
sœurs » (catholiques). Parmi les indices, ces « ongles
royaux » puisque les sœurs de charité sont les épouses du Christ, le roi
des rois. Autre indice, « leurs haleines craintives » et les
« désirs de baiser », deux notations pouvant sous-entendre un désir
sexuel interdit. On vérifie sur cet exemple combien les éléments qui
supportent les diverses interprétations du sens caché derrière le poème sont
ténus. Il n’en demeure pas moins que la plongée dans l’ésotérisme enrichit
notre compréhension. Parmi
les varia, un autre article d’Alain Bardel revient, à l’occasion du
cent-cinquantenaire d’Une saison en enfer, sur le sens qu’il convient
de lui accorder, repentir sincère ou ironie, tandis qu’un article de
François-René Swennen, intitulé « La Pitié de Rimbaud », revient en
détail sur « l’affaire de Bruxelles », le coup de revolver tiré par
Verlaine qui blessa Rimbaud au poignet. Pour mémoire, après avoir dénoncé
Verlaine, Rimbaud retira sa plainte, évitant ainsi à son ami d’être traduit
en Cour d’assises. Notre
brève plongée dans la trente-quatrième édition de Parade sauvage,
riche de dix-huit articles plus quelques recensions, entend seulement
rappeler tout l’intérêt d’une revue, certes écrite par des spécialistes dans
un style de spécialistes, pour tous les rimbaldiens, savants ou non. ©Michel Herland (*) Voir, du même auteur, la chronique
à la précédente édition de cette revue, dans notre numéro de novembre-décembre
2023 (à cette même rubrique). |
Michel Herland
Francopolis - Été 2024
Recherche Dana Shishmanian
Créé le 1 mars 2002