|
La
poésie bâtarde de Monchoachi
Monchoachi (André
Pierre-Louis, né en 1946) est un poète martiniquais auteur chez Obsidiane de trois recueils dont le premier, L’Espère-Geste
(2002), a été récompensé par le prix Max Jacob. Militant engagé en faveur
d’une Martinique libérée de ses chaînes (celles de la France et plus
généralement celles d’un capitalisme destructeur), il a créé un mouvement
éphémère, Lakouzémi (la cour des amis)
accompagné d’une revue du même nom et tout aussi éphémère (un seul numéro
en 2007). Défenseur du créole (il a traduit En Attendant Godot et Fin
de Partie), il écrit désormais sa poésie dans une langue française que
l’on peut dire bâtarde, avec des inserts de vocabulaire et de syntaxe
directement empruntés au créole. Sa langue est donc doublement
personnelle : non seulement par son rythme, ses images, tout ce qui
peut distinguer un poète d’un autre parlant la même langue, mais encore par
sa langue elle-même à nulle autre pareille.
Voici
par exemple comment il évoque les « ravètes
l’église » (ravet = cafard) celles que, en
Français de France, on appelle les grenouilles de bénitier :
Sitôt
sitôt de l’angélus du soir l’âme aspergée
/ Landi pè, lédi fis / Et di Saint / Tèsprit
/ Si soit-il (les mains jointes )
coiffées sinon / tête-marée sinon chapeau paille sinon mouchouè-tête / Grand bonne-heure débarquant Ravêtes-léglise
ravêtes-délice / Ravêtes-malice
Les Dites une à une / Chacune
collé-serré contre son corps une tite cahier toute flapi / Leur corps serré l’un contre
l’autre sur les chaises paille flapies (Lémistè
[Les Mystères], 2012, p. 28).
Monchoachi peut tout aussi
bien créer des sortes de syntagmes où deux mots se télescopent, comme, dans
cette évocation de la couleur rouge, le verbe « bruitaliser ».
Rouge les cirouelliers
/ et les coqs bigarrés servis aux carrefours // Rouge du roucou le riz de
l’offrande / Et les cassaves // Rouge la sève du calebassier du milieu du
jeu de paume / qui bruitalise tant les entrailles
des vestales (p. 39).
Le
créole peut se manifester par une simple tournure, comme ci-après
« là-même », laquelle, apparemment, n’ajoute rien au niveau
strictement sémantique, mais qui en réalité contribue à renforcer le
réalisme de l’image.
Allait devant un nègre hiératique
campé vieille redingote / Et haut
de forme noirs / Venaient là-même derrière femmes en caracos de calicot
noir / Un godet attaché à la taille (p. 32).
Le
poète peut aussi inventer des mots, par exemple en partant d’un mot créole
(merveil = merveille) auquel il adjoint la
terminaison adverbiale française : « Mèveillement »
ci-dessous.
Là-bas là-bas sent
bon l’odeur des fleurs // Avec des nuages et la nouvelle lune / et l’étoile
du soir // Traversé de jeunes filles
belles belles meîme,
/ Mèveillement peintes le corps et le visage (p.
91).
Après
Lémistè, Liber America, une plongée dans
l’univers antillais creuset d’influences multiples, Monchoachi
a effectué un retour à ses sources spécifiquement africaines dans Lémistè 2, Partition noire et bleue (2015).
On y retrouve ce même lyrisme qui mêle à la quête de ce qu’il y a
d’essentiel dans l’humanité, un humour toujours sous-jacent et la
préciosité d’une langue inimitable.
Monchoachi ne se cache pas
sa détestation pour le monde moderne. Dans le précédent recueil, il n’avait
pas de mots assez durs pour décrire les ravages de la société de
consommation, la régression qu’elle induit en détruisant les identités
particulières, le matérialisme qui abolit l’indispensable dimension du
sacré. Dans Lémistè 2, il affirme
plus précisément sa position dans l’introduction en prose d’une partie du
texte. Il y dénonce en des termes on ne peut plus explicites « la
rationalité rapetissante, standardisante,
nivelante, le fatalisme morne généré par un culte
obtus rendu à l’évolutionnisme, et une vision historisante calamiteuse du
temps, l’engloutissement dans une vie privée de ‘monde’, l’horizon borné de
mièvres jouissances, l’assujettissement à des réjouissances mesquines, à
des plaisirs pitoyables, le pullulement de langages abjects, les rets sans
cesse resserrés d’un mode artificieux, fabriqué, bref la dégradation et
l’impuissance absolues fantasmagoriquement converties en progrès exaltant
et en liberté souveraine » (p. 84).
La
poésie de Monchoachi se nourrit d’un double
mouvement de révolte contre le
monde moderne et de nostalgie
d’un passé révolu : « qui sait encore écouter [les] histoires
[des] vieilles femmes au bord de l’eau ? » (p. 155).
Cependant Lémistè 2 se présente d’abord comme un
fabuleux hommage à l’Afrique éternelle, primordiale, tellurique, une
Afrique où hommes et femmes ne font qu’un avec la nature qui nourrit leurs
rites mystérieux et qu’ils égratignent à peine.
L’Afrique
des rites et des danses :
Et les filles qui émergent une à une
à la lune / Mettent leurs corps à danser // Se posent sur le corps avec les
rêves / Filles belles comme feuilles d’égbési /
peau lisse lisse saupoudrée d’osun
(p. 39 - « egbesi »
ou « gbesi » est un terme ajagbe (Sud Bénin) désignant le chat sauvage, « Osun » est le nom d’une déesse du Nigeria, « osun » celui d’un savon noir utilisé dans ce même
pays).
L’Afrique
immémoriale, l’Afrique des masques :
Nouveau masque aux yeux ardents, /
masque aux yeux d’antilope / enchatonné de triangles noirs et rouges /
peint oseille et sang sacrificiel (p. 47).
Femmes
et hommes, chacun à sa place :
Fimelle le coquillage nacré, le poulpe //
rai de lumière // dans les cavernes de la mer // Mâle « la fureur
sacrée », l’esprit vengeur qui le premier // posa son pied sur la boue
// et assécha la terre (p. 52).
Ou
encore :
Nord,
direction néfaste, demeure vieilles femmes, / Sud, bons vents, porteurs de
pluie // jeunes épousées aux hanches
souples // Guerriers derechef dansant en cercle // passant de croissant au
cercle, / bercent enfant qui grandit (p. 63).
Bien
que le créole soit moins présent dans ce texte qui n’est pas directement
inspiré par la Martinique, il apporte ici ou là une touche d’exotisme avec
son supplément de poésie : Comparé à « Corps allégé du lãnmisè bésoin bisoin » (p. 38), la traduction en bon
français (« le corps allégé de la misère et du besoin ») paraît
bien plate.
Au-delà
du recours au créole, il y a chez Monchoachi un
vrai bonheur de jouer avec les mots, en toute liberté … maîtrisée, comme
dans ce tableau des lions arrêtés près d’un point d’eau.
Y font des choses (toutes sortes) //
se lèvent et se couchent, / se couchent et se soient, / se couchent et
s’assisent, / vont et viennent, / disposent eau (et) air, // Font toutes
sortes (p. 24).
Ou
dans le passage suivant, méditation baroque sur le mystère de l’univers et
de la vie.
Toutes les ninivers
qui or bitent // et toute la
chose qui s’offre / les limbes qui tripotent les nuages / les vents qui
broutent arbres / les graines qui clapotent colportent // monde invisible (p.
145).
Il
faudrait encore parler de la typographie, particulièrement travaillée,
impossible à reproduire ici. Les décalages successifs qui scandent la page
éclairent le discours tout en ajoutant au propos une dimension proprement
picturale. Parfois, une « fantaisie » typographique – qui n’en
est pas vraiment une – signale l’importance d’un mot sur lequel le lecteur
risquerait de passer top rapidement.
Pieds maïs-bois // fourrés d o u c e
m e n t / deux par deux dans la terre (p. 48).
©Michel
Herland
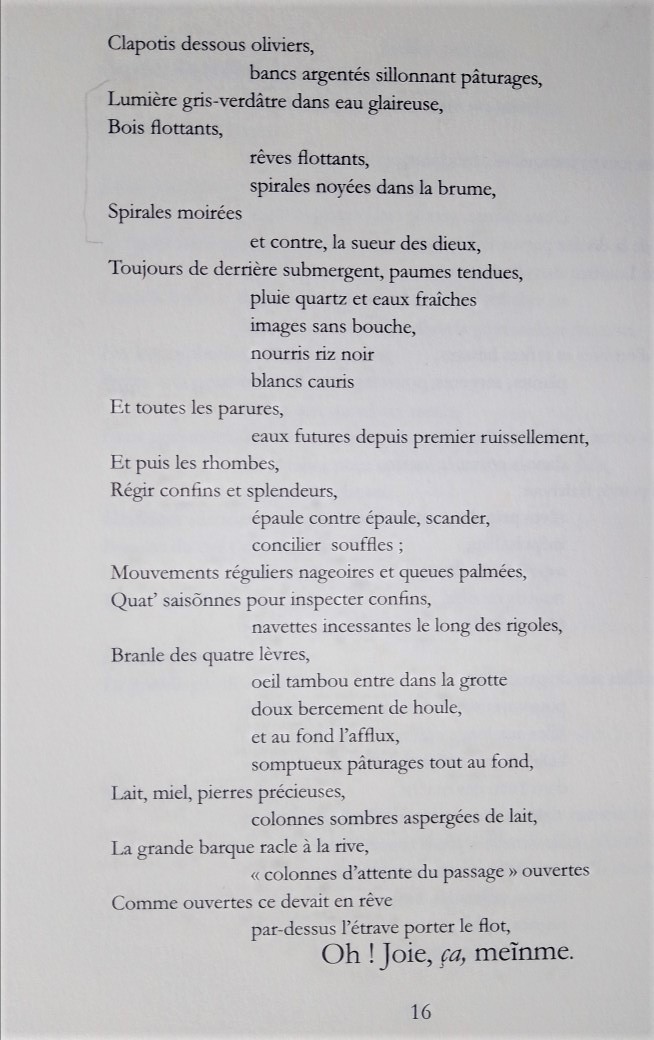
|