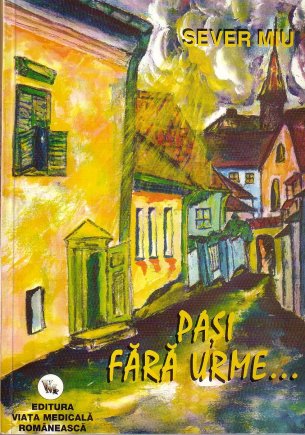Chaque mois, comme à la grande époque du
roman-feuilleton, nous vous présenterons un chapitre
du roman de l'auteur roumain Sever Miu, Des pas sans traces.
Une invitation
à découvrir ou rédécouvrir cette
moitié d'Europe dont nous avons été longtemps
privés et dont nous pouvons désormais réentendre
la voix.
"Des pas sans traces" est un roman-poème sur le
monde de l'enfance après la deuxieme guerre
mondiale dans un
faubourg de Bucarest. La Roumanie était sous l'occupation des
Russes et
dans une période de la dictature totalitaire.
Commencé en 1986, puis revu, complété, il est
terminé en 2003.
La poésie de l'âme d'un enfant protégé par
ses parents se tisse avec les événements réels,
comme veut le dire l'édifiante prière de l'enfant du
début :"Mon Dieu ,aide moi à porter
pendant toute ma vie
mon âme d'enfant".
Dans ce livre,vous découvrirez des traditions,toutes les
coutumes des gens pauvres,
ceux qui formaient une mosaïque
ethnique -Grecs, Italiens, Tziganes, Juifs, Bulgares .
L'école élémentaire, le collège et la
faculté sont trois sortes de harnais qui recouvrent et
dirigent
l'esprit de l'enfant. L'épilogue essaye de déchiffrer le
sens de l'existence.
Chapitre 10
CHEZ NOS PARENTS, CHEZ NOS
VOISINS
Vis-à vis de nous, à côté de l'église Balaneanu, habitait la cousine de
ma mère,tante Gica. La visite chez elle était, pour maman, l'un des
amusements journaliers. Comme papa passait la plus grande partie de son
temps le nez fourré dans ses théorèmes, opaque à toute conversation,
maman trouvait dans la maison de la tante une vrai soupape quotidienne.
Elle était semblable à tanteGica: bavarde et gaie, toujours disposée à
plaisanter, elle maintenait autour d'elle une auréole d'enjouement.
Pendant ces visites je l'accompagnais souvent, c'est ainsi qu'une part
de mon enfance est liée a cet endroit...
Les locataires de ma tante, avec lesquels j'avais parfois contact
m'offraient beaucoup de matériel d'étude typologique.
Vers la rue, dans une maisonnette, vivait Roganca, mère de trois
filles:Duduta, Bibica et Marga, artistes de variété dans les cinémas du
quartier.
À "Matasari,"Ileana","Florida", avant le commencement du film, on
présentait un programme de couplets ou de mélodies à la mode.Ainsi,une
incursion dans le monde des artistes devenait une chose terriblement
tentante pour un gamin... Duduta, maigre comme un clou, la voix voilée;
elle fumait cigarette après cigarette en provoquant autour d'elle un
nuage suffocant.
Je ne sais pas pourquoi, mais je la considérais comme la marâtre de
"Blanche-Neige ".Si celle-la ne pouvait pas s'éloigner de son miroir,
celle-ci ne renonçait pas à sa cigarette...
Marga était mariée et visitait rarement sa mère.
Bibica,une brunette aux yeux grands, ombrés de cils en soie, les lèvres
de feu,que l'on ne pouvait pas regarder avec indifférence.Bénie par
la nature de formes rubensiennes, gardait sur ses lèvres, au lieu de
la cigarette,un éternel sourire. Elle était, évidemment, plus belle
que Gioconda,quoique le sourire était le même...Du mystère, de la
tristesse. Elle nous chantait de petits couplets en racontant les
cancans de la variété de laquelle,elle aussi, n'était pas étrangère.
Elle a été , je crois, la première femme de laquelle, étant enfant,
je suis tombé amoureux.
Comme il est étrange maintenant d'avouer un amour après cinquante années!
Le souvenir de la passion devient plutôt un sourire et la feuille de
papier l'accueille, bienveillante...
Préparé,maintenant, par "les lectures du grenier" je regardais tout
avec d'autres yeux.
Quand elle apparaissait, je m'animais comme par enchantement,
le monde gagnait pour moi de la couleur et du sens. Bien que j'eusse
peur des réactions de ceux autour de moi, je ne réussissais pas à
détacher mon regard d'elle.
Une sorte de trappe se trouvait dans le voisinage de cette maison.
En bas, dans une cave, s'était réfugié un vagabond, les cheveux longs,
sales, la barbe poivre et sel, surnommé par tous-"Père".Je ne sais pas
s'il payait le loyer à ma tante, mais tous le toléraient, en l' évitant.
Il était habillé dans une robe de chambre noire, ceinturé avec une corde.
Quoiqu'il ressemblât à un moine, je ne le voyais jamais aux environs de
l'église, et dans sa cave, comme je regardais du coin de l'oeil, je
n'avais aperçu aucune icône. Je l'évitais avec crainte; il paraissait
une sorte de sorcier sorti de mes contes
Après la cave, vivaient quelques Tziganes grecs; ils flânaient toujours
dans les rues, portant sur leurs épaules comme des manteaux effleurés,
des tas de tapis.
Ils criaient, infatigables, leur marchandise, mais ils n'avaient pas
de succès. Ces "magasins ambulants", excepté le payement des taxes et
du loyer, ont disparu depuis longtemps des rues de Bucarest.
Ils se sont anéantis, suivant les maraîchers, les porteurs d'eau, les
vendeurs de "braga" et de limonade, les vendeurs de poisson et les
laitiers ambulants sur lesquels ma grand-mère racontait si bellement.
À côté de ces vendeurs de tapis j'ai "surpris"dans les rues :
des vitriers ambulants, des charretiers qui criaient:"
de la terre pour des fleurs",
des ramoneurs, des Tziganes "je badigeonne des casserolles en cuivre",
des tonneliers" je répare des tonneaux", des courtiers"vêtements vieux,
j'achète "tous ceux-là qui vendaient dans une foire pareille à
l'ancien"Taica Lazar".
La polyphonie de leurs cris donnait un charme distinctif au faubourg
bucarestois.
Les tapis "persans"-de vrais sérails du monde des "Mille et une Nuits'
n'étaient plus appréciés.
Les gens étaient devenus trop pauvres après la guerre.
Les aliments étaient chers et rationnés.
Tout cela se distribuait à l'aide des cartes de rationnement: farine,
farine de maïs,marmelade ou macaroni, mais aussi de gros souliers,
lodens, métrage de toile type "Amérique" maintenant devenu
"le Travailleur".
Les planchers des chambres étaient couverts par des tapis faits de
bandes de haillons, tissus au métier Jacquard, tapis en jute et plus
rarement,pour ceux avec des parents en Oltenie- des tapis "turcs".
Beaucoup de temps s'écoulera jusqu'à ce que l'on voie de nouveau les
tapis "persans".Alors les gens feront la queue longue, depuis le début
de la nuit, devant les magasins, en dressant des listes d'attente et
faisant grand plaisir aux vendeurs pour avoir"le persan".
Mes vendeurs ambulants avaient une petite fille, Libitza.
Nous grimpions ensemble dans beaucoup d'arbres. Et cette fillette
avait une agilité de chat, que j'enviais en secret. Ainsi, elle arrivait
au sommet avant moi et mangeait les fruits les meilleurs,les cerises les
plus mûres, pendant que j'étais agacé par les fruits acides des orées.
Avec sa famille, j'ai fait la première visite à l'église grecque,
située en voisinage de la statue de Pache.
Un jour, Libitza n'a plus répondu à mes appels: ses parents avaient
liquidé l'affaire, obtenant le visa pour la Grèce.
Au bout de la cour vivait une vieille femme voûtée, le visage sec et
triste. Toujours habillée en grisâtre, cet être délicat passait doucement
de crainte de déplacer quelque chose par son mouvement.
Elle vivait seule dans une chambre obscure, avec un long hall qu'elle
utilisait comme cuisine.
La maison était pleine de toute sorte de reliques de son frère,
le Docteur Chiari, quinze ans auparavant. J'étais intrigué par
son appellation "mademoiselle" parce que je ne pouvais pas le dissocier,
alors, d'une personne jeune.
Ma tante racontait que pendant sa nuit de noces, les cheveux de la
"mademoiselle" Chiari s'étaient allumés. Le gendre, ne résistant pas à
cette situation, s'en était allé.
Avec la flamme son destin s'était éteint.
L'avenir avait fermé la porte devant elle. Les couleurs avaient été
avalées de grisâtre.
La mariée est devenue une perpétuelle mademoiselle
La vie avait encore écrasé un être.
Peut-être je n'aurais pas dû me remémorer tout ça si, pendant le lycée,
je n'avais pas lu "Les grandes espérances" et son image n'avait pas donné
"chair" à l'inconsolée mariée dickensienne.
La cour de ma tante se prolongeait dans le jardin. Il y avait des
printemps doux, caressants. Je glissais ici parmi des vagues de fleurs
blanches ou roses,bercées par les couronnes vertes.
J'étais couché sur le dos parmi les herbes délicates, plongeant mes
yeux au firmament bleu, imperturbable à l'agitation des nuages..
Mon Dieu, comme j'étais 'accablé par l'abîme du bleu!
C'était trop..
Je sentais le besoin de mendier un moment d'indulgence à mon âme..
Quand je m'en évadais ,libérant mes paupières autour de moi, il pleuvait
déjà du blanc..
J'étais reconnaissant aux abeilles qui, avec leur bourdonnement laborieux,
fondaient le silence.
Je courais sur l'allée, par le labyrinthe vert de la vigne, en tracassant
son feuillage, grignotant ses moustaches aigres, de raisin vert.
Les rubis, les opales ou les améthystes lourds d'arômes frappaient la
verdure des arbres, m'invitant aux ascensions malaisées.
Les protestations de ma tante et la déchirure des pantalons en étaient
des conséquences naturelles.
Grondé et menacé avec l'éloignement de l'Eden, je laissais tomber quelques
larmes, baume pour l'apaisement de n'importe quelle protestation.
Les jour suivants-pas trop, c'est vrai- je me retirais "assagi" au milieu
du verger, sous un vieux noyer -le patriarche des fruits secs.
Les abricotiers, le cerisiers et les griottiers soupiraient allégés,
avec le feuillage ébouriffé..
Et sous la voûte ombreuse ,m'adoucissant la solitude,les livres me
surveillaient.
Je peignais mes pensées bouleversées, en écoutant les chuchotements
des rameaux, étonnés de ma sagesse.
Se faufilant drôlement, des rayons délicats de lumière rompaient
la rangée noire des paroles.
Je soulevais la tête et je regardais le ciel parmi les déchirures de
la voûte végétale.
J'écoutais immobile, dans un raidissement torturant, en découvrant
que je n'étais pas solitaire comme je croyais.
Aux fenêtres du palais en émeraude murmuraient les boules duveteuses
des pigeons, les sauterelles vertes aiguisaient leurs outils à tintement
métallique, et quelque fourmi s'égarait de la troupe des amies ascendant
la page blanche, se mêlant parmi les lettres.
J'avais envie, alors, de la poudre enchantée du calife Al-Rachid,
pour comprendre, moi aussi, le Mystère.
Le soir, fatigué à cause de l'immensité des beautés vécues, je me retirais
dans la maison de ma tante. Ici, c'était corvée. On tournait la laine
sur le dévidoir, on faisait des écheveaux, on tricotait des bas,
des pull-overs et on déchirait des..cancans du faubourg.!
Deux personnages, en apparence sans importance, étaient surveillés
rigoureusement.
Soso-le chat de l'amphitryonne -qui en son enthousiasme de chat aurait pu
entortiller les fils d'écheveau- et moi,le gamin -l'auteur des sottises.
Je prêtais l'oreille à tous ceux autour de moi et quand la vigilance
de tante Vasilica, la mère de tante Gica, une petite femme le dos
envoûté à cause de la vieillesse, les cheveux blancs, criait à maman:
-Va voir, Dorina, quelle autre bêtise fait le petit !
Elles avaient trouvaient une solution simple, mais efficace.
Elle m'arrachait du "théâtre des opérations", introduisant mes mains dans
l'écheveau en laine que ma maman tirait en pelote.
Parfois, ma cousine, plus âgée que moi, faisait ses devoirs dans la même
chambre, avec nous. Alors rêgnait silence; tous travaillaient
tranquillement. On n'entendait que le grincement de la plume, glissant sur
les feuilles du cahier. Tante Vasilica-la grand-mère de Mariana,
la voix imbibée d'ironie, rompait d'un coup le silence:
-Écris,écris sur le papier et attends lëargent venir.Voilà le mois
est venu et l'argent n'est pas arrivé!
C'était cette certitude de l'homme ancien ,qui n'attendait pas que
l'argent prenne sa source du point du crayon, mais plutôt d'une activité
laborieuse. Par sa voix aux inflexions joviales j'entendais la voix
du père de Nica Creanga:
"Chancelier, "fromage-sur-clou"/"Du lait aigre dans l'encrier"/Rien dans
tespoches.
Pourquoi cette croyance n'aurait -elle pas pu se perpétuer, quand dans
ces temps-là, les poètes mouraient à cause de la phtysie et les copistes
étaient sans un sou.?
Cette grand -mère, sévère en apparence, avait un esprit joyeux, prête à
plaisanter. Je considérais ses bêtises comme agréables j'oubliais ses
grondements.Une fois, quand Mariana avait attrapé un rhume, tante
Vasilica lui a mis dans le nez une gomme arabique au lieu de Gomenol.
La mésaventure produite à cause de raison "médicale" me porte avec
la pensée, après quelques décennies
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
Une nuit d'hiver, avec un ciel vitreux et la neige jusqu'au pommeau ,
étant de garde aux Urgences, j'avais été appelé par un patient à la
périphérie de Bucarest. La voiture avec laquelle j'étais parti,
est restée quelque part, dans le chemin. Je devais ainsi,
me frayer un chemin tout seul par la neige amassée..
Je nageais à peine parmi les congères et, peu après, je me suis
arrêté haletant ,par là, à côté d'une palissade édentée par le temps
et l'indifférence. Par la fenêtre couverte d'un drap, traversait
une lumière faible. Un chien aboyait rauquement, dans l'obscurité.
Après avoir mêlé mes cris avec l'aboiement du chien, la porte s'est
ouverte un peu. Dans la fente de lumière a apparu la tête de
l'amphitryon , les yeux à demi-ouverts à cause du sommeil et un
bonnet de fourrure glissé sur l'une oreille.
Voyant ma trousse médicale ,il a compris quel était mon but et
balbutiant quelques paroles diluées par le sifflement du vent, a
ouvert un peu plus la porte me laissant passer le seuil.
Dedans il faisait chaud. Il sentait le gaz, le vinaigre et le basilic.
Par la lumière misérable d'une ampoule pendue au plafond, j'ai aperçu
une femme. Elle était couchée dans le lit , sous un édredon sale.
Son visage était brûlé de fièvre, les yeux rouges. Elle gémissait de
temps en temps. Je me suis dégourdi un moment et, soulevant ceux
quelques bouteilles d'eau chaude qui l'entouraient, je commençai
la consultation. presque à la fin, j'ai pensé lui contrôler aussi
le pharynx et j'ai prié son mari de m'apporter une cuillère.
Comme dans de telles occasions, on offre une
cuillère à café, j'ai été plus prévoyant:
- Une cuillère à soupe, je vous prie.
L'homme a disparu, obéissant.
Le temps passait à peine.
Je serrai les instruments, j'examinais les murs misérables avec la
peinture écaillée. Je promenai mes regards par les coins couverts
d'araignées, j'étudiais le tableau de noce des amphitryons-une
"peinture" à la Rousseau le Douanier mais le mari ne revenait plus..
J'avais commencé à m'impatienter,
changeant de place sur un siège qui grinçait menaçant.
Je pensais qu'il s'était passé quelque chose de mal avec le mari.
Finalement il apparut.
Lentement, gardant ses pas, il avançait vers moi, serrant dans la main
une louche pleine avec de la soupe aigre
-Excusez-moi, m'sieur Docteur, elle était froide et j'ai dû
la chauffer un peu.
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
Comme j'étais généreux, désirant provoquer la joie chez mes semblables,
j'acceptais de chanter pour eux. Toutefois, puisque je n'avais pas une
bonne voix et je chantais faux, je produisais seulement de la gaieté.
Je me rappelle une strophe. Quand j'attaquais le passage:
"Poulet, poulet, poulet viens te mettre dans la cage"
tous étaient à terre; quant à moi, congestionné, je faisais des efforts
pour sortir de la cascade des éclats, tout comme les ténors qui font
des efforts pour que leur voix passe au -delà du choeur.
Maman chantait parfois. Elle avait une voix merveilleuse.
Quoi que j'eusse fait, je m'arrêtais pou l'entendre, enchanté.
Elle interprétait des airs d'opéra mais aussi des romances et des
chants vieux avec lesquels elle avait passé son enfance ; elle les
avait écrits dans un cahier réglé. Je regrettais qu'elle ne
chantât pas à la radio pour que tous entendent cette mère-merveille
que j'avais.
La maison de ma tante était ouverte à touts les parents et les
connaissances, ainsi on avait de quoi entendre..
Des recettes culinaires et médicales jusqu'aux derniers événements de
la rue, mode et films, tout était présent dans ce salon sui generis-une
vraie encyclopédie populaire.
On ne faisait pas de politique. Peut-être elles se méfiaient de moi
ou d'un autre "visiteur"..À n'importe quelle tentative de ce genre,
l' hôtesse changeait, prévoyante, de sujet. .Une seule fois,je me
rappelle comme tante Gica a embrassé un broc en céramique avec
l'effigie de Roi Michel, en s'exclamant:
-C'est notre petit Michel ..
Parmi les parents plus éloignés,nous rendait visite une femme avec
un adénome thyroidien géant.Ma tante,avec sa manie de trouver à
tous des surnoms, l'avait "baptisée",pour la boule de sous son menton"
le Petit Jabot".
Dans la maison, Mariana organisait des soirées dansantes.
On mettait des disques et c'était moi qui avais la mission de tourner
la manivelle de l'appareil. On dansait des tangos et des fox-trots,
on mangeait des tartines beurrées, du salami. Je m'égarais parmi
leurs pieds contaminés par la maladie du rythme sans tenir
compte de moi.
Le bairam avait lieu dans la salle à manger; maman et la grand -mère
de ma cousine espionnaient fortement, par la vitre qui donnait dans
le couloir.
Les commentaires étaient portés démocratiquement mais les conclusions
devaient être tirées seulement de grand-mère.
À la veille de telles soirées, tante Gica m'instruisait sévèrement,
longtemps, m'enseignant les pas de tango, pour que je ne reste plus
comme une momie.
Plutôt à cause de la timidité que des préoccupations pratiques
je préférais quand meme.. la manivelle du gramophone!
Cette timidité,découverte alors, me suivra dans la vie comme une ombre.
(À suivre, à vivre, rendez-vous dans notre prochaine
édition pour le Chapitre 11)