|
Trobairitz
(1)
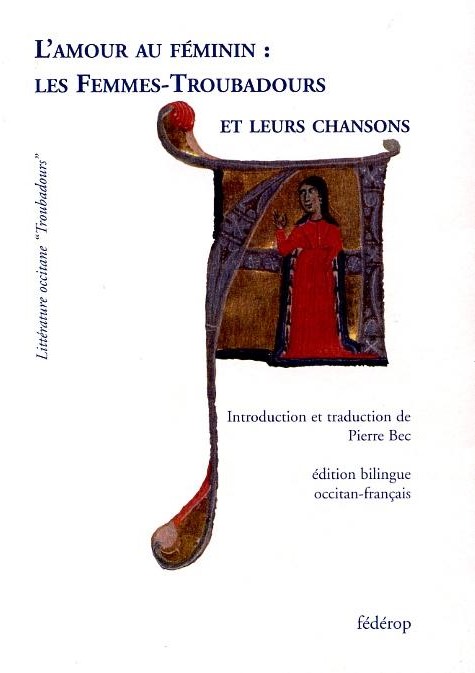
Un ouvrage de la belle collection
« Littérature occitane - Troubadours » de Fédérop est consacré
aux femmes pratiquant le trobar, un livre et un seul car elles ont
bien moins écrit que les hommes, conformément à la tradition bien ancrée
jusqu’à nos jours qui veut l’homme séducteur et la femme séduite. Mais les
rôles s’inversent parfois et c’est ici la dame de haute lignée, la dòmna,
qui déclare sa flamme envers son « chevalier », son ami (amic).
Car – contrairement aux mœurs d’aujourd’hui – bien qu’extraconjugal l’amour
dit « courtois » s’affiche au grand jour.
Alors que nous possédons des
biographies (vidas) relativement détaillées pour certains
troubadours, les renseignements concernant les trobairitz sont
inexistants ou très limités, ne dépassant jamais quelques lignes. Certaines
d’entre elles sont connues seulement par leur nom, d’autres sont restées
anonymes. Encore faut-il ajouter que sur les vingt trobairitz
recensées dans l’ouvrage et pour lesquelles on possède donc une trace de
leur écriture, la moitié seulement sont dites « autonomes », les
autres apparaissent dans une pièce à deux voix, un dialogue (tenson)
soit avec une autre femme, soit, le plus souvent avec un homme. Par ailleurs,
seules quelques rares mélodies ont été conservées, mais c’est également le
cas pour les trobadors.
Même si leur corpus est bien plus
limité, les trobairitz cultivent un art tout aussi raffiné et
diversifié que leurs homologues masculins. Trois d’entre elles ont écrit
des pièces sans autre équivalent dans l’ouvrage. Azalaïs d’Altier a laissé
un long salut (épître) de 101 vers, Tantz salutz et tantas
amors (Autant de saluts et d’amour), dans lequel elle plaide auprès
d’une noble dame (peut-être Clara d’Anduza ?) la cause d’un amant négligé
(Uc de Saint-Cirq ?).
Bieiris de Romans est l’auteure d’un
chant d’amour lesbien, Na Maria, prètz et fina valors (Dame Marie,
prix et fine valeur) ce qui la rend particulièrement unique :
Car en vos
ai mon cor e mon talan
E per vos ai
tot çò qu’ai d’alegrança.
Car en vous
est mon cœur et mon désir / Et c’est de vous que je tire ma joie.
Gormonde de Montpellier (peut-être
une dominicaine) a écrit pour sa part un sirventes en faveur de
l’Église de Rome et des Français au temps de l’hérésie cathare. Outre sa
teneur politique, ce poème a la particularité de répondre à celui d’un
troubadour du camp opposé, Guilhem Figueiras, en en respectant la structure
particulièrement savante, soit vingt coblas de 7 vers (4
hendécasyllabes et 3 pentasyllabes) enrichis de rimes intérieures, comme on
peut l’observer sur cette cobla proclamant la perfection de
Rome :
En Roma es
complitz totz bes, e qui’ls pana,
Sos sens l’es
falhitz, car si meteis
engana :
Qu’el n’èrtz
sebelitz, don perdrà sa ufana.
Dieus auja mos prècs :
Que celhs qu’an mals bècs,
Joven e
senècs, contra la lei romana,
Cajon dels bavecs.
À Rome est parfait, tout bien et qui
le nie / Perd tout son bon sens car lui-même il se trompe : / Mais une
fois mort, il perdra son orgueil. / Et que dieu m’exauce ! / Que les
méchants becs / Jeunes comme vieux qui nient le loi de Rome / tombent en
enfer ! (?)
La comtesse de Die est avec Na
Castelosa la plus célèbre des trobairitz. Mais contrairement à la
seconde dont les cansos disent la peine de celle qui ne se sent pas
aimée, la comtesse développe dans les quatre pièces qu’on a conservé d’elle
(des coblas de 8 vers unisonans) une philosophie amoureuse
singulièrement audacieuse. Ainsi dans la canso Ab joi et ab joven
m’apais (Joie et jeunesse me nourrissent), affirme-t-elle le droit
d’aimer ouvertement :
E dòmna qu’en
bon pretz s’enten
Deu ben pausar s’entendença
En un pro
cavalièr valen,
Pòis qu’ilh conois sa valença,
Que l’aus amar a presença ;
Que dòmna, pòis am’ a presen,
Ja pòis li
pro ni l’avinen
No’i diràn mas avinença.
Une dame de haut mérite / Devra placer
son amour / En un chevalier valeureux / Et si elle sait sa valeur, /
Qu’elle l’aime ouvertement, / Et de dame qui ose ainsi, / Les nobles et les
courtois / Ne diront que des louanges.
Dans Estat ai
en grèu cossirièr (J’ai été en grave souci), elle invite son
« chevalier » à pratiquer avec elle la modalité la plus charnelle
de l’amour courtois, l’assag (essai).
Ben volria
mon cavalièr
Tener un ser
en mos bratz nut
[…]
Bel amics,
avinenz e bos,
Quora’us
tenrai en mon poder,
Et que jagués
ab vos un ser,
Et que’us dès
un bais amoròs ?
Sapchatz,
gran talan n’auria
Que’us
tengués en luòc des marit,
Ab çò que
m’aguessetz plevit
De far tot ço
qu’eu volria.
Je voudrais
bien tenir un soir / Mon chevalier nu dans mes bras […] Doux ami, charmant
et courtois, / Quand vous tiendrai-je en mon pouvoir, / Couchée un soir
auprès de vous / Pour vous donner baiser d’amour ? / De vous serrer
j’ai grande envie / À la place de mon mari / Pourvu que vous m’eussiez
promis / De faire tout à mon désir.
Contrairement au mari, plus préoccupé
du souci de sa descendance que des envies de son épouse, le troubadour est
au service de sa dame. Celle-ci entend qu’il la charme, le plus souvent par
son chant mais elle peut aussi exiger de lui davantage. Dans l’assag,
la dame et son amant sont couchés nus dans un lit. L’amant est tenu de
procurer un plaisir physique à sa dame sans lui-même se laisser aller
jusqu’à l’orgasme ; celui qui rate l’épreuve est répudié : c’est
ainsi qu’on présente une pratique – exceptionnelle ou non – censée être
acceptée par les époux, certains d’entre eux au moins.
Cet ouvrage sur les trobairitz
se distingue des autres de la collection par la présence, déjà notée, de
chansons dialoguées. Dialogues entre deux femmes ou plus souvent entre une
femme et un homme. L’identité de la trobairitz est le plus souvent
indécise. Même quand un nom lui est attribué, il est difficile,
aujourd’hui, de savoir de qui il s’agissait exactement. Il n’est donc pas
exclu que telle ou telle tenson ne soit qu’une fiction inventée par
un trobador. Certaines mettent en scène un homme mal aimé qui prie
une femme d’intercéder pour lui auprès de la femme aimée. Les autres
soulèvent des problèmes de casuistique amoureuse et apportent donc des
renseignements précieux sur l’amour chez les nobles au XIIIe siècle. Parmi
les problèmes soulevés : la dòmna qui s’estime offensée
doit-elle pardonner face au repentir sincère de son amant (N’Almucs de Castelnòu
et N’iseut de Capton) ; l’amoureux doit-il sacrifier une rencontre
avec sa dame pour secourir une personne en grand danger ? (Guilhelma
de Rosers et Lanfranc Cigala) ; l’amour crée-t-il l’égalité entre les
deux amants ou la dame reste-t-elle supérieure quoi qu’il arrive ?
(Maria de Ventadorn et Gui d’Ussel).
Autre question posée par deux
trobairitz, N’Alaisina Iselda et Na Carenza : est-il préférable de se
marier et de supporter les inconvénients de la maternité ou de rester
vierge ?
Mas far infans cuit
qu’es gran peniteça,
Que las tetinas pendon
aval jos
E lo ventrillo es ruar
e’nojós.
Mais enfanter est une pénitence :
Car les tétons vous pendent par dessous / Et le bas-ventre est dolent et
ridé. Comme on voit, le Moyen Âge n’était pas prude ; poétiser
n’empêchait pas d’user de mots crus.
Jusqu’où l’amant doit-il se montrer
entreprenant ? Dans la tenson entre la comtesse de Provence et
Gui de Cavaillon (datée de la première décennie du XIIIe siècle), c’est
l’homme qui prône la modération et le respect, la femme qui incite son
amant à la hardiesse.
Ez avètz dam en vòstre
vulpilhatge,
Quar no’us ausatz de
prjar enardir ;
E faitz a vos ez a mi
gran damnatge,
Que ges dômna non ausa
descobrir
Tot çò qu’ilh vòl per
paor de falhir.
Ce qui vous nuit c’est
votre couardise / Vous n’êtes pas hardi pour me prier / Et le dommage est à
vous comme à moi / Car nulle dame n’ose dévoiler / Ce qu’elle sent, par
crainte de faillir.
À l’inverse, dans la tenson entre
Dame Lombarde et Bernard Arnault, c’est l’homme qui reproche à la dame de
ne pas lui accorder assez vite ses faveurs, alors que celle-ci lui reproche
d’hésiter, malgré ses dires, entres plusieurs dames.
Vòlh que’m digatz
Quals mais vos platz
Ses cuberta celada,
E’l miralh on miratz.
Mais quelle est donc /
La mieux aimée ? / Dites sans mots couverts / Dans quoi vous
mirez-vous ?
Dans le débat entre un mystérieuse
dame H (2) et un certain Rosin tout aussi mystérieux, au point qu’on pense
plutôt à une fausse tenson – il est, quoi qu’il en soit, et comme le
précédent plus tardif que la tenson entre la comtesse de Provence et
Gui de Cavaillon – si l’on retrouve
les rôles inversés par rapport à ceux que l’on attribue traditionnellement
à la femme et à l’homme, on n’est plus maintenant dans l’évocation d’un
amour « courtois » qui ne devrait pas s’aventurer au-delà de
quelques baisers ; c’est à nouveau de l’assag qu’il est question.
Soit la situation suivante : une femme prend ses deux amants dans son
lit, leur faisant promettre de se contenter de la tenir et de l’embrasser (que
plus mas tener e baisar). L’un se plie à la règle posée par la dame,
l’autre « oubliant son serment se dépêche d’aller au fait ».
Rosin défend la conception « courtoise » de l’amour alors que la
Dame H prend parti pour l’amant qui est allé au bout de son désir :
Qu’als jazer et ab
remirar
L’amors corals recaliva
Tan fòrt que non au ni
non ve
Non conois quan fai mal
o be.
Car dans un lit avec sa
dame / L’amour sincère le réchauffe / Si fort qu’il ne voit ni n’entend /
Et ne sait s’il fait mal ou bien.
Dame H ne se contente pas de
l’excuser, elle le félicite de « prendre son bien ».
Mas l’arditz on prètz
s’aviva
Saup gen sa valor
enansar,
Quant pres tot cò
que’lh fon plus car,
Mentre’lh fon l’amors
aisiva.
Mais le hardi au grand mérite
/ Sut bien accroître sa valeur / En prenant son bien le plus cher / Quand
l’amour lui était propice.
Une dame a-t-elle vraiment écrit
cela, même sous le couvert de l’anonymat ? C’est pour le moins
douteux. Que ce dialogue soit réel ou fantasmé, il n’est pas moins
remarquable de voir surgir l’éloge d’un érotisme aussi poussé dans un texte
en occitan du XIIIe siècle.
***
Le Moine de Montaudon (1)
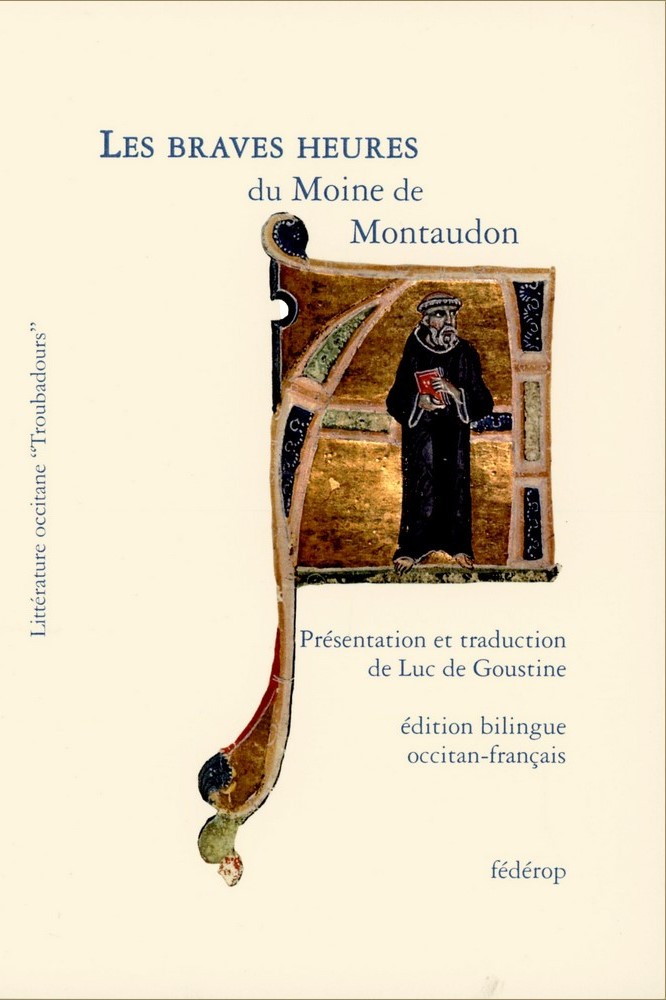
On s’étonnera peut-être de voir
associé dans cette chronique un moine à des dames, les clercs, a priori,
n’ayant rien à voir avec elles. Sauf que nous sommes au Moyen Âge où l’on
considérait ces choses-là différemment d’aujourd’hui. Or le troubadour
resté dans l’histoire comme « le Moine de Montaudon » n’a pas
commis que des chansons d’amour ; il a évoqué dans certaines tensons
la physiologie féminine dans des termes encore plus crus que la dame H (si
« dame » il y a bien) à propos du désir.
Bien qu’on demeure dans l’ignorance
de son nom de baptême, on connaît assez bien, par sa vida et par une
tenson, le parcours de ce cadet de famille, né dans le Cantal, fait
moine à Aurillac, puis prieur de Montaudon (lieu non identifié). Il
écrivait, étant moine, des cansos et des sirventès qui lui
apportèrent les faveurs des nobles seigneurs et barrons, contribuant ainsi
à la prospérité de sa maison : el portavat tot a montaudon, al sieu
priorat (il apportait tout à Montadon, à son prieuré). Il obtint de son
abbé la permission de quitter la bure et de suivre les préceptes du roi
Alphonse II d’Aragon, seigneur du Carladès, dans le Massif Central, où se
trouvait vraisemblablement Montaudon. Le règne d’Alphonse d’Aragon dit
Alphonse le Chaste ou encore le Troubadour, s’étend de 1164 à 1196. Selon
la vida, ce roi commanda à notre moine qu’el manjes carne et
domnejes e cantes trobes (qu’il mange de la viande, courtise les dames
et chante et compose des vers). À l’apogée de sa carrière, notre monge
fut fait « seigneur du Puy Sainte-Marie » (Le Puy en Velay),
chargé de « donner l’épervier », c’est-à-dire de récompenser le
vainqueur des épreuves en vogue à la cour du Puy, qui demandaient de
faire preuve autant de sa force, de son adresse que de son talent poétique.
Rentré dans les ordres, il acheva sa vie dans un autre prieuré dépendant
toujours de l’abbaye d’Aurillac, probablement près de
Villefranche-de-Conflent : un priorat en Espaingna, que a nom Vilafranca,
qu’es de l’abaia d’Orlac.
Le moine de Montaudon a laissé
quatorze pièces. Parmi les onze qui sont reproduites dans l’ouvrage de Fédérop,
les quatre premières s’inscrivent dans la tradition du fin’ amor et
démontrent une virtuosité qui explique sans doute la faveur dont il
jouissait auprès des connaisseurs. Ainsi dans Era pot ma domna saber
(Enfin ma dame peut savoir) qui contient des formules poétiques bien
choisies, comme celle-ci :
mon cor, l’autrier,
que.m laisser en durmen
ab vos remas, domna, et
ab vos es
de bon loc moc – mal en
meillor s’es mes.
mon cœur, l’autre soir endormi
me quittant / alla chez vous, dame, et chez vous demeure ; / d’un bon
lieu pris, s’est mis en un meilleur.
Cette canso unisonnans de six
couplets commençant par un octosyllabe et suivi par huit décasyllabes, plus
une tornade de quatre vers est adressée, comme celle d’où sont extraits les
vers suivants – qui débute par Aissi cum cel q’a estat ses segnor
(Comme celui qui était sans seigneur) – à Marie de Ventadour, une dame
chantée par maints poètes, trobairitz elle-même comme on l’a vu plus
haut. Le moine en était-il vraiment amoureux ou jouait-il simplement le fin’amor
pour obéir aux conventions du temps ? Il se confirme en tout cas qu’il
savait tourner un compliment :
Bella domna, de vostra
gran valor
no sai tan dir que vos
mais non aiatz
[…]
Mas de bon cor vos am
tan finamen
[…]
totz temps, dona, vos
anera siguen
ses cor que ia re no
vos en disses
Belle Dame de haute
valeur / je ne sais rien dire que vous n’ayez. […] Mais de bon cœur vous
aime si parfaitement […] toujours, dame, j’irai vous suivant / sans vouloir
vous l’avouer.
Dans le chant Mos sens e ma
conoissensa (Mon âme et ma conscience), le moine évoque en des termes
on ne peut plus courtois sa rencontre avec une dame à laquelle il a cédé
son cheval !
qu’ans li fatz lige
homenatge
e.il refier grat e
merce
per amor del palafre
don si.m laisset
devallar
car je lui rends
hommage lige / et grâce et merci je lui dois / pour l’amour du palefroi /
d’où sauter elle me permit.
Ayant fait ses preuves dans le fin’amor,
le moine put donner libre cours à sa verve satirique, comme dans le sirventes
Be m’ennuia, ici traduit par « M’insupporte ».
Exemple :
Ennuia me longa
tempradura,
e carne quant es mal
cuech’e dura,
e prestre qui ment ni.s
perjura,
e veilha puta que trop
dur.
M’insupporte abstinence
qui dure, / et viande mal cuite et dure, / et prêtre qui ment et parjure, /
et veille pute qui perdure.
À la suite de Peire d’Alvernhe qui
avait dressé une galerie satirique et en vers des troubadours, le monge
a drossé de brefs portraits humoristiques de seize de ses compagnons de trobar,
parmi lesquels deux, Arnaut Daniel et Peire Vidal, figurent au catalogue de
la collection « Troubadours ».
Dans un autre genre encore, deux tensons
considèrent la question du maquillage des dames. Dans la première, le poète
plaide à sa façon auprès de Dieu la cause des femmes :
s’elshas se genson no
vos tir ;
abanz lur o devetz
grazir,
si.s podon ses vos
bellas far.
qu’elle s’embellissent
ne vous gêne pas / remerciez les plutôt pour ça / que sans vous belles elle
se fassent.
Cette tenson contient des notations
physiologiques – les dames recherchent un fard épais que per pissar no-s
pert leumen : qui ne se perde pas en pissant (2) – voire
paillarde, des sécrétions trop abondantes faisant obstacle, selon lui, à
une bonne copulation.
Senher, fuecs las
pueoscas cremar,
qu’ieu non lur puesc
lur traucs omplir
ans quan cug a riba
venir
adoncs me cove a nadar.
Seigneur que le feu les
dévore / car je ne peux leur trou emplir / et quand je sens la rive venir /
il faut que je nage encore (sic!).
Une deuxième tenson amplifie le
propos en mettant aux prises successivement les statues saintes (qui
revendiquent leur antériorité en matière de peinture), les femmes, Dieu et
ses saints. S’en suit un marchandage au terme duquel les femmes n’auraient
le droit de se maquiller que pendant quinze années de leur vie...
Plus sérieux, mais guère, le dialogue
entre le moine et Dieu, L’autrier fuy en paradis (Tantôt j’étais au
paradis), contrairement à Manens e fraires foron companion (Manant
et frère en compagnons), lequel met face à face un « manant » (un
paysan, riche en l’occurrence) et un frère (un clerc) désargenté. Un conte
qui nous rappelle pour commencer la fable de la cigale et de la
fourmi :
So ditz lo
manens : Frairi dechazei,
tant avetz joguat,
no.us laissetz esplei
mas gabs avetz be ad
egual d’un rei,
ja us vers no sia.
Lors dit le
manant : Pauvre déclassé / vous avez tant joué, rien ne vous est resté
/ mais en vanteries vous êtes l’égal d’un roi / quoiqu’aucune n’est vraie.
Mais qui se termine comme un sermon
car si le frère est prêt à confesser ses fautes – greu veiretz prohome
qu’a temps no folei (il n’est prud’homme qui parfois ne « foleye »)
– il ne manque pas de rappeler la malédiction du Christ contre les
riches :
So dis lo
frairis : Aisso vos plevis,
qu’aver ajostar non es
paradis ;
ans comandet Dieus
qu’om lo departis
tot per cofrairia.
Lors dit le
frère : Ça, je vous garantis / qu’amasser l’avoir n’est pas le paradis
/ car Dieu commande qu’on se partage / tout par fraternité.
Contrairement à d’autres et à la
différence de ses propres cansos, le monge ne cherchait pas
un grand raffinement stylistique dans ses tensons. On le voit dans
celle-ci où la rime des décasyllabes change à chaque quatrain, seul le
pentasyllabe conclusif conservant la même rime en « ia ».
Notes
(1) Dans la
belle collection « Littérature occitane – Troubadours » :
- L’Amour au
féminin : les Femmes-troubadours et leurs chansons. Édition bilingue
occitan-français. Introduction et traduction de Pierre Bec. Fédérop,
Le-Pont-du-Rôle, 24860-Gardonne, 2013, 192 p., 15 € ;
- Les Braves Heures du
Moine de Montaudon.
Édition bilingue occitan-français. Présentation et traduction de Luc de
Goustine. Fédérop, Le-Pont-du-Rôle, 24860-Gardonne, 2020, 152 p., 15 €.
(2) Curieux
rapprochement à travers les siècles : Au mystère de cette « dame
H » du XIIIe siècle semble répondre l’énigme du poème des Illuminations
intitulé « H ».
(3) Formule
énigmatique. Il est avéré néanmoins que l’urine était appréciée au Moyen
Âge pour ses vertus purifiantes et qu’elle a pu servir de produit
démaquillant. Cf. dans l’encyclopédie du XIVe siècle Elucidari de la
proprietaz de totas res naturals, l’article « Urina ».
©Michel Herland
|