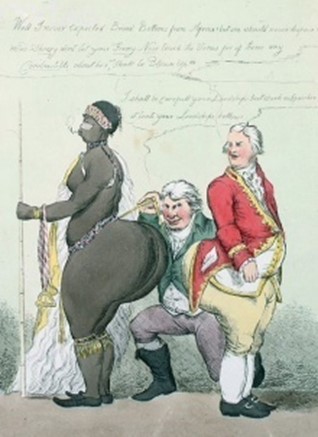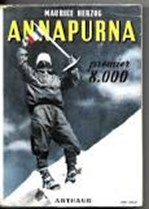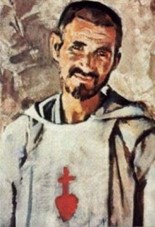|
HUMEUR
Paris en pointillé
(suite, 7)
par J. Fleuret
Je me souviens de ses rues, ses
monuments, squares et impasses, ses lieux où vécurent des hommes et des
femmes connus dans l’histoire, je me souviens…
|
65
|
|
Je me souviens du Mur des fédérés du cimetière du
Père-Lachaise.
|
|
|
Le mur des Fédérés est une
partie de l’enceinte du cimetière du Père-Lachaise, à Paris, devant
laquelle 147 fédérés, combattants de la Commune, ont été
fusillés par l’armée versaillaise (sous les ordres de Thiers), à la fin de
la Semaine sanglante, en mai 1871 et jetés dans une fosse commune ouverte
au pied du mur.
|
|
66
|
|
|
Je me souviens de la salle Gaveau, au 45, rue La Boétie, 8e arrondissement et
d’un concert mémorable du grand pianiste Wilhelm Kempff (une vie dédiée à Beethoven, dit-on) où la
salle, debout pendant plus de vingt minutes n’a cessé de l’applaudir.
Frénétiquement.
|
|
La salle Gaveau est une salle de concert d’environ
1 000 places, construite en 1906-1907 par l’architecte Jacques Hermant, et
principalement vouée au piano et à la musique de chambre.
|
|
67
|
|
|
Je me souviens de la Vénus de Hottentote, au Musée de l’Homme, à Paris dans les
années soixante. Dans un kiosque en verre. De son vrai nom de Sarah Baartman, née en 1789 au Cap décédée à Paris en 1915 (à
26 ans). Son physique difforme avec un fessier proéminent en a fait une
attraction de cirque en Angleterre d’abord puis en France ensuite. Son
squelette a été rendu au Cap seulement en 2002, la France ayant pendant des années refusé de restituer son corps
|
|
68
|
|
Je me souviens de la Danse sur le parvis de l'Opéra dans le IIe arrondissement.
|
|
|
Le
groupe de La Danse est constitué d’un jeune homme,
souriant, dressé debout jouant du tambourin et entouré de plusieurs bacchantes
tournant et dansant nu autour de lui.
Découvert
au public, le 27 juillet 1869, le groupe provoqua tout de suite le
scandale, principalement en raison de la nudité des personnages et du
traitement réaliste de la composition. Dans la nuit du 26 au 27 août
1869, une main anonyme lança un encrier rempli d’encre noire sur le groupe,
dont l’original porte la trace.
L’opinion
publique, par voie de presse et diverses pétitions, demanda le retrait de l’œuvre.
Garnier proposa de déplacer la statue et de l’installer au foyer de la
danse, dans l’opéra même, mais les demoiselles du corps de ballet s’y
opposèrent en signant elles aussi une pétition. Napoléon III préféra
commander une nouvelle sculpture, mais la guerre de 1870 sauva l’œuvre.
|
|
Afin
de le protéger de la pollution atmosphérique, le groupe original est
transféré au musée du Louvre en 1964, puis au musée d'Orsay en
1986. Une copie réalisée en 1963 par le sculpteur Jean Juge (1898-1968),
commanditée par l’atelier de Paul Belmondo,
se trouve à sa place sur la façade du palais Garnier.
|
|
69
|
|
Je me souviens
du 7 de la rue la Boétie où siégeait à l’époque le Club Alpin Français.
|
|
|
Le 3
juin 1950 l’Annapurna est conquis
par Herzog et Lachenal. Pour la première fois un sommet dans l’Himalaya de
8000 mètres est vaincu par la cordée Herzog-Lachenal. L’exploit de l’ascension
de l’Annapurna est une victoire de l’alpinisme français.
Les lumières
brûlaient jusque tard dans la nuit, car la préparation a été minutieuse,
dans les moindres détails, le but était d’avoir tout prévu, matériel et
sanitaire. Ce fut une réussite bien que Maurice Herzog ait été durement
touché en sa chair et a dû être amputé des doigts de la main.
|
|
70
|
|
|
Je me souviens de l’hôtel de la Paiva, un hôtel
particulier parisien construit entre 1856 et 1865,
sur l’avenue des Champs-Élysées, au n° 25, par la Païva, née Esther Lachman
(1819-1884), aventurière russe d’origine polonaise très modeste, devenue
marquise portugaise, puis comtesse prussienne. Dans cet hôtel particulier,
elle y donna des fêtes restées célèbres.
En
1903, le Travellers Club s’installa dans cette
ancienne demeure luxueuse dont ce gentlemen's club est
propriétaire depuis 1923. L’hôtel de la Païva a
été classé au titre des monuments historiques en 1980.
|
|
71
|
|
Je me souviens
de l’église Saint-Augustin dans
le 8e arrondissement et du Père Charles de Foucauld qui y trouva
la foi.
|
|
|
Construite
par Victor Baltard (architecte des Halles de
Paris), cette église trouve son originalité dans sa structure plus que dans
son style éclectique inspiré des arts roman et byzantin.
En effet, elle est le premier édifice religieux d’une telle ampleur à
utiliser le fer et la fonte. Elle mesure près de
100 mètres de long et la hauteur de sa coupole s’élève à
plus de 80 mètres. Grâce à la structure métallique, les contreforts
habituels n’existent pas. Le terrain n’étant pas rectangulaire, le plan est
original : façade étroite, chœur très vaste. À mesure que l’on s’approche
de celui-ci, les chapelles adjacentes deviennent de plus en plus imposantes.
ICI Charles
de FOUCAULD s’est converti en se confessant à l’abbé Huvelin
en octobre 1886. Devenu prêtre le 9 juin 1901, il a célébré plusieurs fois
la messe dans cette église.
Il
était né à Strasbourg en 1858 et décédé à Tamanrasset (Agérie)
le 1er décembre 1916, à 58 ans.
Le jour
de sa conversion, Charles de Foucauld entra dans l’église pour discuter avec
l’abbé Huvelin, mais celui-ci refusa, et l’invita
à se confesser, puis lui donna la communion. Ce fut l’instant décisif de la
conversion. Le confessionnal est toujours là, précieusement conservé, et
orné d’une photo du Père Huvelin.
|
|
72
|
|
Je me souviens de la station de métro
Le Louvre
|
|
|
Elle
doit sa dénomination initiale de Louvre par sa proximité
avec la rue du Louvre d’une part et l’entrée du palais du Louvre d’autre
part, laquelle s’effectuait alors par la colonnade Mansart à l’est. Du fait
de cette proximité, une décoration culturelle spécifique est mise en place
en septembre 1968, à l’initiative d'André Malraux, alors ministre de la Culture,
afin de transformer la station en antichambre du musée.
|
©J. Fleuret – novembre-décembre 2020
1ère partie :
novembre 2017
2ème partie : décembre 2017
3ème partie : janvier-février 2018
4ème partie : mars-avril 2018
5ème partie : mai-juin 2018
6ème partie : sept.-oct. 2018
Vous voulez nous envoyer des
billets d'humeur ?
Vous pouvez soumettre vos articles
à Francopolis par courrier électronique à l’adresse
suivante :
contact@francopolis.net
|