|
La collection bilingue « Littérature
occitane – Troubadours dans laquelle sont publiés tous les recueils
des troubadours dont nous avons rendu compte jusqu’ici a été abritée depuis
son origine en 2011 par les éditions Fédérop,
créées par l’occitaniste Bernard Lesfargues en 1975 et reprises en 1999 par Bernadette Paringaux et Jean-Paul Blot. Ses collections sont
désormais sous la houlette des Éditions Pierre Mainard qui viennent de nous
offrir un nouvel opus consacré à Cercamon, dans
la même très belle maquette(1),
présenté et traduit par Yves Leclair. Il est tentant de rapprocher ce livre
de celui consacré à Jaufre Rudel,
non seulement parce qu’il est également introduit et traduit par Yves
Leclair mais encore parce que les deux sont à peu près contemporains,
appartenant donc à la deuxième génération troubadour, celle qui suit
Guillaume (IX) d’Aquitaine. Ajoutons qu’Yves Leclair est lui-même poète et
qu’il traduit les troubadours en vers réguliers et rimés, au risque de
s’éloigner parfois quelque peu du sens littéral.
Cherche
Monde – Chansons de Cercamon.
Édition bilingue occitan-français. Présentation et adaptation d’Yves
Leclair, collection Littérature occitane « Troubadours », Pierre
Mainard (collection Fédérop), 2023, 118 p., 15 €.
Jaufre Rudel, Chansons
pour un amour lointain. Édition bilingue occitan-français.
Présentation de Roy Rosenstein, préface et
adaptation d’Yves Leclair, collection Littérature occitane
« Troubadours », Fédérop, 2011, 88 p.,
12 €.
Cercamon / Cherche-monde
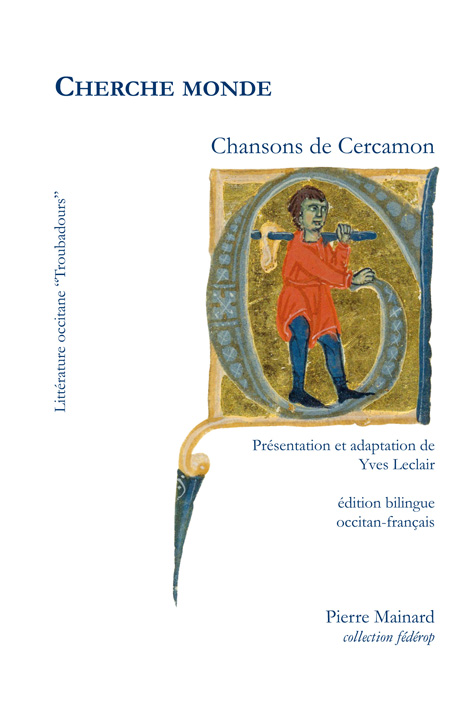
E cerquet tot lo mon, lai on el
poc anar, et per so fez
se dire Cercamon.
Et
il chercha à travers le monde entier partout où il put aller, et pour cela
se fit appeler « Cherche-monde »
La vida du poète se résume à deux petites
phrases. La seconde, que l’on vient de lire, nous apprend son surnom. On ne
sait rien de précis sur ce troubadour. La lecture des poèmes permet tout au
plus de conclure qu’il était actif sous les règnes de Guillaume X
d’Aquitaine (1099-1137) – le successeur de Guillaume IX, le
prince-troubadour – et d’Alphonse VII d’Aragon (1126-1157) qui furent sans
doute ses protecteurs, puis sous le règne de Louis VII le Pieux
(1120-1180), roi des Francs, qui épousa d’Aliénor d’Aquitaine, récupérant
ainsi les domaines de Guillaume X. Tout le reste est conjecture mais l’une
d’elle est particulièrement intéressante. Cercamon
a dédié à un certain « Eble » son planh
(poème de déploration) consacré à la mort de Guillaume X. Il n’est pas
interdit de penser qu’il s’agit d’Eble II,
seigneur de Ventadour, troubadour réputé et considéré même comme le chef
d’une école (l’École d’Eble) mais dont,
curieusement, il ne reste aucune chanson. De là à penser que le mystérieux Cercamon n’est peut-être que le pseudonyme d’Eble II, il n’y a qu’un pas qu’on est d’autant plus
tenté de franchir que Cercamon est un maître du fin’amor comme le fut, de réputation, Eble. Rien de concret ne vient étayer, malheureusement,
cette hypothèse qui aurait pourtant l’avantage de lever le secret sur la
renommée du seigneur d’Eble.
On ne parlait pas encore de canso
à l’époque de Cercamon, la vida évoque des
vers (trobat vers : il
trouvait des vers, c.-à-d. qu’il composait des poèmes). Elle
évoque aussi des pastoretas, des
pastourelles, qui auraient disparu à moins qu’elles n’aient été
volontairement écartées par les rédacteurs des manuscrits en raison de leur
caractère grivois.
Il nous reste donc huit chansons attribuées à Cercamon : le planh
déjà mentionné, une tenson et six chansons d’amour. Dans Car vei fenir a tot dia (Puisque je vois chaque jour finir), nous
assistons à la dispute nourrie de quelques allusions érotiques (la
« caille » est une prostituée, le « poulain » une
maîtresse) entre un troubadour et son disciple. Le débat qui commence par une
critique des clercs, un thème que l’on
retrouvera chez d’autres troubadours et de même en langue d’oïl(2),
concerne précisément le mariage de Louis VII et d’Aliénor, présenté – à
condition de lire entre les lignes – comme un risque pour les libertés du
Midi.
La première chanson d’amour, Per fin’amor m’esjauzira (Par
vrai amour serais en joie), est constituée de sept strophes unisonans(3) d’octosyllabes plus deux tornadas (envois). Modèle d’amour courtois,
cette canso s’achève ainsi :
E
si.m fezes tent de placer
Qe.m laisses pres de si jazer
Ja
d’aquest mal non morira.
Si
ce plaisir, elle m’offrait, / De me laisser coucher près d’elle, / Jamais
de ce mal ne mourrais.
Dans Quant la
douch’aura s’amarcis
(Quand la douce brise se fait amère), Cercamon
décline les affres du transi d’amour.
Totz tressaill e bram e fremis
Per
s’amor, dormen e veillan.
Partout
je tremble et chancelle et frémis / Pour son amour, que je dorme ou bien
veille.
Le chant s’achève néanmoins sur une note
ironique :
Cercalmont
ditz : greu er
cortes
Hom
qe d’amor se desesper.
Cercamon dit :
Bien difficile d’être / Courtois quand d’amour on se désespère.
Le pur amour apparaît dans Assatz
es ora oimai q’eu chant (L’heure est venue désormais que je
chante), poème unisonans d’octosyllabes avec
uniquement des rimes masculines.
Ni
no.n soi tan afolatitz
Qe ja re.il qeira ni.l deman,
Petit
ni pro, ni tan ni qant,
Ni
mal ni be, ni re ni qei.
Mais
fou ne le suis pas non plus assez / Pour lui faire requête ou demander / Ni
peu ni prou, ni ceci ni cela, / Ni mal ni bien, et ni quoi que ce soit.
C’est l’amour de loin – qui sera particulièrement
illustré par Jaufre Rudel
– qui transparaît dans le poème suivant. Faute de pouvoir approcher l’aimée
– Car no m’es plus aizinada(4) – il ne reste plus qu’à
désespérer tout en la fantasmant.
Q’eu non puesc lonjamen estar
[De]
sai vius ni de la guerir,
Si
josta mi despoliada
Non
la puesc baizar e tenir
Dinz cambra encortinada.
Car je ne peux vivre plus longtemps, / Ici non
plus que là-bas pour guérir, / Si, à côté de moi, dévêtue, / Je ne la puis
baiser, ni tenir / Dans une chambre ornée de tentures.
Dans un autre poème, un sirventès
moralisateur, Cercamon s’en prend à la femme
infidèle : Non a valor
d’aissi enan / Cela
c’ab dos ni tres jai,
soit, selon le traducteur, « elle n’a pas de valeur, dès ce jour-là, /
celle qui couche avec deux ou trois », littéralement celle qui est
avec deux ou trois « joyeux ».
Le dernier poème, Pus nostre
temps comens’ a brunezir
(Puisque notre temps commence à se rembrunir) démontre que ce n’est pas
d’hier que l’on trouvait que c’était mieux avant. Ce sirventes
qui critique les mœurs du temps renferme une critique inattendue de
certains troubadours :
Ist trobador, entre ver e mentir,
Afollon
drutz e molhers e espos.
Ces
troubadours, entre vérité et mensonge, / Corrompent les amants, les femmes,
les époux.
Quant à la conclusion, dans la dernière tornade
du recueil, elle résume tout un versant de l’amour courtois qui se nourrit
de n’être pas satisfait :
Cercamon
diz : qi vas amor
s’irais,
Meravill’es
com pot l’ira suffrir ;
Q’ira d’amor es paors et esglais,
E
no-n pot hom trop viure
ni murir.
Et
Cercamon dit : qui s’afflige envers amour, /
C’est merveille qu’il puisse un tel chagrin souffrir ; / Peur et
effroi, tel est le chagrin en amour, / On ne peut vraiment en vivre ni en
mourir.
***
Jaufre
Rudel – l’amour de loin
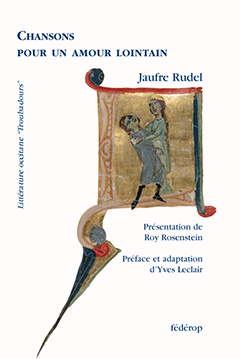
Jaufre
Rudel est de tous les troubadours celui qui a été
le plus traduit (le plus souvent partiellement) et surtout cité tant son
histoire – sa légende vaudrait-il mieux dire – peut faire rêver. Ce
seigneur, prince de Blaye en Gironde, tomba amoureux d’une princesse dont
il avait entendu vanter l’extraordinaire beauté. Hodierna
de Jérusalem vivait à Tripoli, recluse par un mari jaloux. Jaufre la chanta dans ses poèmes avant de s’embarquer
pour la Deuxième croisade (en 1147) à la suite de son seigneur et suzerain
Louis VII et d’Aliénor. Il semble acquis que Jaufre
partit bien pour la croisade et qu’il n’en revint pas mais la tradition
ajoute que, tombé malade pendant la traversée, il fut conduit dans une
auberge à Tripoli où Hodierna se rendit à son
chevet et lui donna « le baiser d’amour ». Alors Jaufre qui avait miraculeusement recouvré l’ouïe et
l’odorat, entendu la Dame et humé son parfum, mourut dans ses bras en
louant le Seigneur. Quant à la belle Dame, après avoir fait ensevelir son
« amant de loin » dans la maison des Templiers, elle prit,
dit-on, « le voile de douleur ». Yves Leclair, qui rapporte la
légende à peu près en ces termes, a donc nouvellement traduit les six
chants (dont deux réellement attestés) de Jaufre Rudel, en réalisant le tour de force non seulement de
nous offrir une traduction en vers rimés mais de s’en tenir de surcroît
d’un bout à l’autre au mètre octosyllabique, celui de Jaufre,
par ailleurs le plus prisé des troubadours.
De ces six chansons, les deux premières dans
l’ordre du livre et dont l’attribution demeure incertaine, illustrent
l’amour courtois de la façon qui deviendra la plus classique, en commençant
par une description de la nature, avant de décrire des sentiments amoureux
le plus souvent malheureux. L’amour pour une femme jamais vue (que anc no vi) apparaît dans le chant III. Dans le
chant suivant Jaufre invoque son « amour de
terre lointaine (Amors de terra lonhana) tandis que l’expression Amor de lonh revient presque à chaque strophe, comme un
leitmotiv, dans la sixième et dernière canso. Ainsi dans le premier verset, avec
l’évocation traditionnelle de la nature.
Lanquan
li jorn son lonc en mai
m’es bels doutz chans d’auzels de lonh.
E
quan me sui partitz de lai,
remembra.m
d’un’amor de lonh :
vau de talan embroncs e clis,
si que chans ni
flors d’albespis
no.m
platz plus que l’iverns
gelatz.
Lorsque le jour s’allonge en mai, / doux me sont
chants d’oiseaux lointains / mais quand loin de là je m’en vais, / me
souviens d’un amour lointain : / j’erre tout triste et je décline, /
n’aime chants ni fleurs d’aubépine, / non, pas plus que l’hiver glacé.
Post-scriptum
Cercamon /
Cherche Monde – Rosemonde / Rose du monde. Correspondance inattendue, au
XXe siècle débutant, un autre fameux poète, Apollinaire, a écrit un poème
intitulé « Rosemonde ». Trois petits quintets d’octosyllabes. Le poème s’achève ainsi :
Je la surnommai Rosemonde
Voulant pouvoir me rappeler
Sa bouche fleurie de Hollande
Puis lentement je m’en allai
Pour quêter la Rose du Monde
(Alcools, 1913)
Notes
(1) Couverture avec
rabats illustrée de la reproduction en couleur d’une lettrine, beau papier.
(2) Voir par exemple « De l’Estat
du Monde » de Rutebeuf.
(3) Les rimes se
répètent d’une strophe à l’autre.
(4) Traduit ainsi par
Y. Leclair : « Moi qui ne peux m’approcher d’elle ». Le mot aizinada paraît absent des dictionnaires
occitans usuels. Aisina existe bien et
signifie entre autres un récipient, un vase. Le vers en question aurait
donc une signification bien plus crue.
©Michel Herland
|