|
D’une langue à l’autre…
Septembre-Octobre
2021
|
|
Atsuko Ogane,
chercheuse flaubertienne… et poète
(II).
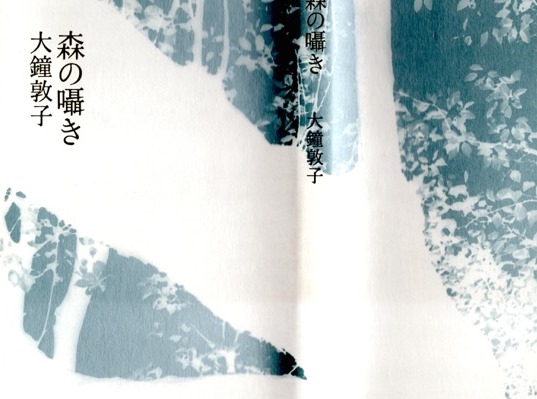
(*)
|
|
Murmures
d’Atsuko Ogane dans Le Murmure de la forêt
Atsuko
Ogane est une universitaire, professeure à l’Université Kanto Gakuin
(Yokohama) au Japon. Elle est spécialiste de Gustave Flaubert. Elle lui a
consacré plusieurs articles et livres et a adopté constamment une attitude
scientifique dans le choix des objets de ses recherches (le mythe de
Salomé, la femme fatale et la fatalité dans les manuscrits de Flaubert,
les plans, les scénarios, les réécritures de Salammbô, etc.)
ainsi que dans la démarche qui est mise en œuvre et qui se caractérise
par une grande rigueur. Comment une telle écrivaine peut-elle échapper à
l’impersonnalité et à l’objectivité flaubertiennes et nous plonger dans
un univers poétique marqué par la subjectivité, la spontanéité et par les
multiples sentiments d’un être sensible ? Peut-on être en même temps
flaubertien et anti-flaubertien ? Oui, nous dit Flaubert lui-même
dans sa lettre à Louise Colet le 16 janvier 1852 : « Il
y a en moi, littérairement parlant, deux bonshommes distincts : un
qui est épris de gueulades, de lyrisme, de grands vols d’aigle, de toutes
les sonorités de la phrase et des sommets de l’idée ; un autre qui
fouille et creuse le vrai tant qu’il peut, qui aime à accuser le petit
fait aussi puissamment que le grand. »
Ces deux dimensions se retrouvent apparemment
chez Atsuko Ogane.
Son œuvre, Le Murmure de la forêt est un recueil de 16
magnifiques poèmes qui sont animés par un même amour de la vie et un
grand attachement à la nature. Écrits en japonais et parus à Tokyo, ces
textes ont été repris et réécrits en français par la poétesse qui cherche
à nous présenter plus que des textes traduits, mais une véritable œuvre
littéraire francophone. Il n’est pas donc étonnant que nous retrouvions
dans la version japonaise en troisième de couverture, le titre du recueil
en français qui occupe toute la page. De même, la table des matières
comporte une double numération : en japonais et en français. Tous
ces éléments para-textuels montrent qu’il ne faut pas lire la version
française du recueil comme une simple traduction mais comme une nouvelle
création qui échappe à son œuvre d’origine.
Le
Murmure de la forêt est en fait constitué d’une succession de poèmes
dont chacun condense un thème, une impression, un souvenir ou une
expérience intensément vécue. Atsuko Ogane arrive à capter les aspects
magiques du monde, une sensation insaisissable, un rêve (« Le
départ », p. 80-81), un murmure (« Le
Murmure de la forêt », p. 16-17), une toile de peinture nocturne (« La Nuit
sur la terre primitive », p. 28-29), un conte merveilleux (« Le
conte du crépuscule », p. 12-13).
Tous ces poèmes, si éloignés soient-ils les uns
des autres, semblent hantés par une tentative d’unification. Ils se
succèdent et se répondent comme dans des miroirs ; leurs rapports
reposent en premier lieu sur une continuité énonciative : Atsuko
Ogane exprime son émerveillement et son bonheur devant la beauté des
spectacles du monde. Les adjectifs utilisés sont « des marqueurs de
subjectivité »(1). Ils traduisent la réaction de la
poétesse à l’égard de ce qu’elle décrit et manifestent son émotion :
« ondoyante », « étincelants »,
« éblouissantes » (« un conte du crépuscule », p.
12-13), « éblouissante », « transparente » (« Le
Murmure de la forêt », p. 16-17). Les adverbes sont également
porteurs de connotations positives : « splendidement »
(« un conte du crépuscule », p. 12-13) « tranquillement »,
« doucement », « calmement » (« Le Murmure de la
forêt », p. 16-17).
La relation entre les poèmes du recueil repose
en second lieu sur une continuité thématique qui se fonde sur divers
parcours isotopiques actualisé dans toute l’œuvre. Nous notons ainsi le
champ lexical de « la nuit » : nous le retrouvons dans les
titres de certains poèmes comme « Le conte de crépuscule » (p.
12-13), « La Nuit transperçante », « Une Nuit de la terre
primitive » (p.28-29) et « La Lune à Caracalla » (p.
68-69). Atsuko Ogane fait rimer les titres en instaurant un jeu d’échos
entre les intitulés des poèmes qui se reflètent réciproquement. Un tel
dispositif spéculaire implique au niveau macro-textuel un dialogue entre
les différents poèmes. Ce même champ lexical du nocturne traverse
certains poèmes mais à travers ses antonymes incarnés par la lumière.
Nous citerons à titre d’exemple « un conte du crépuscule » (p.
12-13) : « un rayon de lueur », « étincelants »,
« le jour ».
Cependant,
quand le nocturne domine, les yeux ne peuvent rien percevoir. Du coup,
c’est l’oreille qui remplit la fonction d’alerte et de
communication : « L’oreille est alors, selon Bachelard, le sens
de la nuit, et surtout le sens de la plus sensible des nuits : la nuit
souterraine, nuit enclose, nuit de la profondeur, nuit de la mort. »(2) C’est pourquoi les sensations
auditives constituent un parcours isotopique important. Le titre du
recueil évoque déjà un « murmure ». Les poèmes sont reliés en
une texture miroitante grâce à un rapport de continuité thématique :
« une voix lointaine », « résonnantes », « les
échos de la plaine au pied d’une montagne »,
« décryptement » (« un conte du crépuscule », p.
12-13), « au murmure de la forêt suffoqué de verdure »,
« le son de la corde » (« Le Murmure de la forêt »,
p. 16-17). Atsuko Ogane utilise également les propriétés sonores des mots
pour établir un jeu d’échos entre eux : « ondoyante »
« résonnantes », « éblouissante » (« un conte du
crépuscule », p. 12-13).
Les rapports entre les poèmes du Murmure de
la forêt repose en troisième lieu sur une continuité discursive. Le
narratif semble intervenir dans les poèmes de Atsuko Ogane. Le poème
« le Murmure de la forêt » (p. 16-17), par exemple, se
construit comme un récit ; il narre un voyage, un passage dans le
temps et l’espace : le poète « glisse tranquillement » d’un
monde terrestre où tout est limité vers un autre, céleste, où l’amour et
l’harmonie dominent. Il s’agit d’une traversée imaginaire dont le support
fondamental est la métaphore filée de la mer qui symbolise le voyage mais
aussi la rencontre avec l’idéal tant recherché : « on part en
voyage sur la mer du cœur », « pardonne tout et traverse sur
les rides de la mer ». Il est donc clair qu’en recourant à des
métaphores filées, Atsuko Ogane cherche moins à effacer le réel qu’à le
doubler afin de faire surgir les lignes, les couleurs, les formes et les
mouvements qui le constituent. La poétesse va encore plus loin dans
« Invitation » (p. 24-25). Le voyage prend, dans ce poème, la forme du récit d’une
errance représentée à travers deux métaphores frappantes :
« c’est une impatience bleuâtre » et « le frissonnement
glorieux / d’une métempsychose inconnue ». Les éléments évoqués
apparaissent ainsi plus colorés, plus saisissants, parce qu’ils sont
peints non pas à travers d’autres éléments du réel mais à travers un irréel
inconnu et inaccessible.
Cependant,
ce voyage se métamorphose en une errance cosmique dans « La Nuit sur
la terre primitive » (p. 28-29). Il se fait dans l’espace grandiose
de l’univers. Atsuko Ogane éprouve une ivresse
inouïe en quittant l’univers étroit de la terre et en accomplissant un
voyage nocturne dans « le ciel immense » étant invitée par la
lune : « dans la nuit le rocher de la lune m’invite », et
si la poétesse éprouve un plaisir si intense c’est que cette errance lui
permet de surmonter toutes les formes de distance et de franchir les
frontières tant géographiques que culturelles. Elle est investie d’une
dimension esthétique et devient le support de l’élaboration de sa
poétique. Le but de ce
« voyage-errance » est de retrouver l’être idéal ou plutôt
l’idéal qui est sans lien avec les êtres humains. Il est « seul
debout » et il incarne la beauté et l’impassibilité :
« Tellement rigide / Tellement beau » et cette impersonnalité,
cette neutralisation de tout jugement préalable, cette impassibilité sont symbolisées par la
rigidité du « rocher rouge », de « la pierre
irisée », « la pierre », « le rocher de la
lune ».
Une telle esthétique esquissée dans
« La Nuit sur la terre primitive »
(p. 28-29) est flaubertienne. Il est donc évident que nous pouvons
établir un jeu d’échos intertextuel entre la deuxième strophe de ce
poème et le point de vue de Gustave Flaubert sur la création de
l’œuvre littéraire :
« Flottant dans le cosmos
La pierre sur rien,
Indépendante »
(« La Nuit sur la terre primitive », p. 28-29)
« Ce
qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un
livre sans attache extérieure, qui se tiendrait en lui-même par la force
interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en
l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet
serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles
sont celles où il y a le moins de matière… » (lettre à Louise
Colet, 16 janvier 1852).
En
conclusion, nous pensons que Atsuko Ogane a pu échapper à son statut de
simple traductrice en inventant une œuvre hybride qui répond à l’horizon
culturel et poétique français et japonais. L’un alimente l’autre et
permet son déploiement. Dans son recueil Le Murmure de la forêt,
Atsuko Ogane chante les splendeurs du monde et appelle à une harmonie
permanente entre l’homme et le cosmos. Sa poésie est également un
véritable espace de réflexion sur la création littéraire et une source
inépuisable qui permet aux lecteurs de se lire en lisant et de se
découvrir et de se construire au fil de sa lecture du Murmure de la
forêt.
(1) C. Fromilhague et A. Sancier, Introduction à l’analyse stylistique,
Bordas, 1991, p. 90.
(2)
Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries du repos, édition de Daniel
Boulagnon en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de
l'Université du Québec à Chicoutimi, 1982, p. 168.
Arselène
Ben Farhat
Maître-assistant et membre de LARIDIAME à
l’Université de Gabès et de Sfax (Tunisie). Il a publié : La
structure de l'enchâssement dans les contes et nouvelles de Guy de
Maupassant (Imprimerie Reliure d’Art, 2006), « Du
métalinguistique au métadiscours : une esthétique en élaboration chez
Maupassant » (dans Le métadiscours, sous la direction d’A. Ben
Farhat, Mohamed Ali Editions, 2020), « Réécrire les œuvres de
Gustave Flaubert pour les jeunes arabes » (dans D’après Flaubert,
sous la direction d’Eric Dayre et Florence Godeau, Kimé, 2021).
|
|
Lire
le « Murmure de la forêt » d’Atsuko Ogane
C’est
l’histoire d’une amitié de quinze ans, qui a commencé en Normandie, dans
un château et sur une plage, sous le signe de Flaubert, et qui s’est poursuivie
à Paris, au Japon, en Bourgogne. Une amitié qui va au-delà des sympathies
littéraires et académiques. Une amitié qui a aussi une dimension
poétique.
J’ai
pris conscience de cette facette cachée, secrète, d’Atsuko, le jour où
elle m’a offert la calligraphie qu’elle avait faite elle-même de quelques
vers de son poème « Murmure de la forêt ». On peut voir une
photographie de cette calligraphie dans la livraison de Francopolis de juin
2017.
En
me l’offrant, l’auteure m’avait patiemment expliqué comment il fallait la
« lire » : de droite à gauche bien sûr, colonne de signes
après colonne de signes, et en partant du bas pour monter vers le haut de
la colonne. La chose se complique du fait que l’ordre des mots est
souvent inversé et bousculé : quand on arrive au groupe central de
la calligraphie, l’impression pour la lectrice occidentale, c’est qu’il
faut construire la phrase en reculant. Certes, l’auteure me traduisait en
français ces signes si mystérieux, mais – ainsi pratiquée in situ – la traduction ne pouvait
aboutir qu’à un texte français déconcertant. Un texte français qui ne
sonnait plus très français.
Je
dois donc à Atsuko une expérience intellectuelle unique en son genre.
Essayer de « lire » cette calligraphie reste pour moi une
véritable expérience d’étrangeté, d’estrangement.
Bien sûr, la thématique de ce poème – comme aussi des autres poèmes
qu’elle a traduits pour Francopolis
– y contribue. On sait que dans une traduction de poème, ce qui passe, ce
qui persiste à coup sûr du texte original, c’est la thématique. La sienne
est une thématique existentielle, qui marie la matérialité sensorielle du
monde à une ouverture plus philosophique sur le cosmos. Atsuko Ogane
écrit une poésie de fragments, elle aligne des évocations disjointes.
C’est pourquoi l’impression générale est floue. Quelques fleurs, des
instruments de musique, une ou deux couleurs, la lune, les ciels, des
paysages de forêt, de mer, de neige, le désert, les îles grecques…
« On embrasse le rien de l’existence. » L’estrangement vient également du contexte culturel, qui ne
peut que nous échapper en grande partie. Toutes ces composantes de
l’opacité font le charme de ce genre de poésie.
Mais
ma laborieuse « lecture » de la calligraphie de « Murmure
de la forêt » me rappelle aussi que l’Occident nous réserve parfois
des expériences semblables. Je pense à la « lecture » que demande
le vitrail médiéval, lorsqu’il propose au spectateur une narration
constituée d’images successives : ne dirait-on pas que le vitrail
nous propose un texte « japonais » ? Je pense encore à la
lecture, tout aussi perturbante, que Mallarmé a imposée aux lecteurs de
son poème « Jamais un coup de dés n’abolira le hasard ». Ceci
pour dire qu’il y a toujours, pour la poésie, des chemins de traverse, et
des rencontres.
Jeanne
Bem
professeure
honoraire de l’Université de la Sarre
Jeanne Bem a édité Madame Bovary dans
le tome III de l'édition des Œuvres complètes de
Flaubert, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2013. Elle a publié
récemment deux essais : Flaubert, un regard contemporain,
Éditions Universitaires de Dijon, 2016 (traduit en japonais par Kayoko Kashiwagi,
Tokyo, Editions Rose des vents-Suiseisha, 2017), et Flaubert aux
prises avec le "genre". De la famille queer à
"la Nouvelle femme", EUD, 2021.
|
|
Les
poèmes d’Atsuko Ogane
Les
poèmes d’Atsuko Ogane sont classiques. Ou il serait peut-être plus exact
de dire qu’ils dépassent le temps. En effet, la robe que porte chaque
époque est toujours éphémère, et le style d’hier n’est plus celui
d’aujourd’hui. Aussi construit-elle ses poèmes, comme s’il lui semblait
bon d’abandonner robe et habit dès le début, en choisissant un minimum de
termes impérissables et en établissant des expressions simples et
intemporelles, pour faire s’envoler son imagination dans l’espace
transparent et tranquille, à l’époque où Sapho vécut par exemple.
Eh
non, ce pourrait être dans le futur plus lointain que notre époque. Le
désert, les vestiges, le champ de neige… les paysages que choisit Ogane,
ils représentent tous un spectacle de « Tabula rasa » :
tout y afflue, y converge et s’achève, mais tout pourrait aussi commencer
à partir de là.
« Le
soleil couchant/ incandescent sur l’horizon, /le Crépuscule des
Dieux commence./ Personne n’a vu le spectacle/ qui remplit l’air d’une
dimension inconnue. » (« Le Crépuscule des Dieux »)
Ou
alors,
« Seule
la nostalgie nous enveloppe/ Doucement dans cette vallée sauvage,/ Nous
qui cherchions la terre promise,/À cette question lancinante,/Le soleil
ardent ne nous répond pas. » (« Le Rêve du Kugo »)
L’image
doit se fonder sur L’Ancien Testament, mais puisque « la
nostalgie » se lie avec « sauvage » et inexploré, c’est
plus significatif que l’évocation de « la terre promise ».
« Prions./ Pour ressusciter,/ Pour rencontrer un
jour le souvenir de cette existence » (« Sapho »)
Visiter
Sapho pour ressusciter « le souvenir de cette existence » vécu
« un jour » dans le futur. Grammaticalement parlant, il s’agit
justement du futur antérieur, d’une perspective désirée, qu’on aurait
souhaité avoir.
Madame
Ogane est une des chercheuses spécialistes de Flaubert, en même temps
qu’elle continue à faire des recherches sur la formation du mythe et de
la légende de Salomé-Hérodias. Dans la littérature, ce sujet a fait
s’épanouir des fleurs inquiétantes du romanesque, mais il s’en dégage
aussi un enjeu mallarméen : une aspiration vers un espace de la
langue pure, vers l’épuration qui ressemble à « la dignité froide de
la femme stérile » (Baudelaire).
Les
poèmes d’Atsuko Ogane se balancent en équilibre merveilleusement, entre
l’inclination vers le romanesque et l’intentionnalité poétique. Oui,
« Dans
son cahier ouvert/ sur ses genoux/ des lettres blanches /
dansent /éternellement. » (« Sur la colline »)
comme
ces lettres qui dansent.
Kiwao Nomura
Poète et critique
littéraire, il a reçu de nombreux prix littéraires au Japon pour ses
recueils de poèmes, ainsi que le prix « Best translated Book Aword
in Poetry » (USA) pour son recueil Spectacle & Pigsty (2012).
Site personnel : http://www.kiwao.com/index2.htm (en
japonais, jusqu’à 2010)
|
|
À propos de « Rêve du Kugo » d’Atsuko Ogane
Bien
que je sois Japonais, je ne connaissais pas l’instrument de musique
appelé Kugo, auquel l’auteure elle-même donne l’explication brièvement en
astérisque [Francopolis de mai-juin 2021].
Mais
je ne serais pas une exception, en ignorant cet instrument. Selon un
dictionnaire japonais, Kugo a disparu à la fin du Japon ancien (IXe
siècle de notre ère).
Ce poème dont le sujet
est un instrument de musique déjà disparu m’a rappelé diverses
descriptions d’instruments de musique dans l’Ancient Testament. Par
exemple, le tambourin, la lyre (tous les deux: Genèse, 31.27), la harpe
(Psaumes, 81.3), le cor (ibid., 81.4) le luth, la lyre et les cymbales (1
Chroniques, 16.5). On peut seulement imaginer ces instruments tels qu’ils
étaient à cette époque, bien que leurs noms ne soient pas étrangers pour
nous, puisque tous ont disparus, juste comme le Kugo.
Ce
qui est intéressant pour moi, c’est que le prophète Amos dit, en
critiquant les
peuples qui pratiquent superficiellement les rites pour le Seigneur :
« Ils (i.e., les peuples d’Israël) improvisent (hâsubû en
hébreu) au son de la harpe, chantant comme David leurs propres
cadences » (Amos, 6.5 ; j’utilise la TOB, c.-à-d. Traduction
Œcuménique de la Bible). Véritablement
l’homme est un animal qui invente une extrême variété d’instruments de
musique, chargeant et en même temps demandant beaucoup de signes à une
mélodie, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.
Le vers du poème
d’Atsuko : « La mélodie qui invite ne nous demande rien »,
est une expression très paradoxale pour moi. Parce qu’elle montre un peu
d’ironie par rapport à un aspect de l’histoire humaine qui a connu
infiniment d’expériences et de tragédies, « des luttes et des
combats ». Je pense réellement à l’Afghanistan où divers genres
d’instruments de musique s’entendaient pendant plus de deux millénaires,
puisqu’elle est la région la plus importante pour la rencontre des
civilisations de l’Occident et de l’Orient, et qui est « la
terre, où les gens se lassent des luttes et des combats » depuis
une quarantaine d’années.
J’ai utilisé le mot
« s’entendaient ». Dans ce poème, par le verbe pronominal
« s’entend », il n’y a aucune allusion au personnage qui joue,
faisant s’entendre « le timbre des vingt-trois corde du Kugo laqué,
incrusté de nacre ». Qui est le joueur (la joueuse)? Ou bien ce
timbre s’entend-il automatiquement grâce à l’Intelligence artificielle
(IA) ?
Peut-être les instruments
de musique sont eux-mêmes le produit du rêve humain.
Junichiro Foujita
Professeur à l'Université
Kanto Gakuin, Junichiro Foujita a comme principaux centres intérêt
l’histoire de la philosophie, la théologie, l’histoire de la pensée
politique. Ouvrages (en japonais) :
La
politique et l’éthique. À la recherche de leurs significations au regard
de l’histoire intellectuelle européenne.
L’existence
et l’ordre. Réflexion philosophique et théologique sur l’homme au regard
de l’histoire intellectuelle européenne.
|
|
(*)
Ces
notes de lecture concernent le recueil Le murmure de la forêt
d’Atsuko Ogane, paru à Tokio en version bilingue japonais/français en
2007 – que nous avons présenté à cette même rubrique dans notre revue de juin 2017, avec la reproduction de 5
poèmes en édition bilingue japonais / français (Le murmure de la
Forêt, La lune à Caracalla, La Création, Un conte du crépuscule,
Invitation) – ainsi que ses poèmes publiés dans Francopolis,
en édition bilingue japonais/français, dans la traduction de l’auteure (aux
numéros de juin 2017, mai-juin 2020, mai-juin 2021).
Voir
aussi à cette même rubrique :
Les
recherches flaubertiennes d’Atsuko Ogane : partie I
Suite des notes de lecture sur ses
poèmes : partie III.
Les notes rédigées en japonais sont
traduites par Atsuko. Les textes originaux en japonais sont fournis dans
un fichier séparé en format .pdf accessible sur le lien suivant :
Atsuko Ogane-Textes en japonais–Francopolis
Sept.oct.2021
Dans
le contexte du bicentenaire Flaubert, mais aussi des tristes nouvelles
concernant le sort des arts et des artistes dans certaines parties du
monde (voir dans cette même rubrique notre groupage sur la poésie
afghane), ces réflexions nous touchent et mettent en avant, une fois de
plus, la valeur de l’engagement poétique.
D.S.
|
|
Notes de lecture sur Atsuko Ogane (II)
(voir partie
I,
partie
III)
Francopolis
septembre-octobre 2021
recherche Dana Shishmanian
|