|
Dans sa « préface
antérieure », placée à la fin du recueil, la poète et traductrice
Marilyne Bertoncini nous tend la main pour nous faire entrer – ou mieux
dit, plonger – dans l’écriture marine d’Eva-Maria Berg, où la perte de
repères nous pousse à des trouvailles au-delà du connu, pourvu qu’on
lâche prise et qu’on se laisse aller « hors du temps ». Qu’il
me soit permis de citer la préfacière :
« Plus qu’un voyage, en
réalité, c’est une dérive sans but défini que nous propose la poète (…)
Dérive d’une langue à l’autre, aussi, me semble-t-il, tandis que le
regard passe du texte allemand à la belle traduction que je lis (…) Sans
doute faut-il s’abstenir de chercher un sens caché, d’interpréter, mais
bien plutôt cela, oui : flotter à la dérive, accepter
l’impermanence, la fluidité du sens, dans une poésie ambulatoire qui est
ce souffle même… et qui nous pousse – comme un esquif – hors du temps,
dans l’analogie, m’empathie, qui fait que ce poème devient notre souffle
court, à lire le rythme volontairement haché, notre souffle de
lecteur-apprenti nageur de texte de haute-mer. »
En effet, alors qu’on a
l’impression d’emblée de se faire embarquer dans une série d’hymnes à la
mer, thématique qui mit au défi poètes et musiciens de tous temps –
« image usée » que la poète se donnerait le but de faire
enfin rentrer « dans le cadre de l’imaginaire des hommes »
(p. 13) –, on s’aperçoit vite que ce n’est guère le cas, et
heureusement ! Cette annonce est plutôt un défi en sens inverse, à
savoir de ce qu’il faut surtout éviter. Car la poète, tout en évoquant,
certes, la beauté du grand bleu, ne manque pas de nous faire sentir les
tragédies humaines qu’il renferme depuis toujours.
Ainsi toute une série de signaux
d’alerte, tissant une trame sous-jacente d’inquiétude, d’angoisse, de
souffrance sourde, traverse le recueil : le « scintillement
métal / des véhicules sur terre » (p. 14), un « navire
de guerre / à l’ancre » qui « bloque / toute la baie »
(p. 20), des « moteurs », des « véhicules / qui
ne jettent pas l’ancre / et tracent leurs rondes / autour de la baie »
(p. 46), des « sirènes » qu’on entend « se
rapprocher / et l’air / devient trop étroit / pour respirer »
(p. 75). Un environnement menaçant, évoquant explicitement les machines
de guerre, pèse sur la contemplation, et fait réfléchir aux « crimes
qui / ont affecté / d’inhumanité / un paysage / sans tache » (p.
69).
Mais justement, c’est là
qu’intervient le poète : il s’élève en esprit et en parole pour
habiter si haut que
l’oiseau soit une
mouette
qui confond la
croisée d’une fenêtre
avec un mât
compter ses plumes
une par une
pour perdre la peur
de la chute libre (p. 26)
Perdre la peur laisse la place à
la « claire contemplation » et libère l’imagination,
maîtresse de l’imprévisible :
seule la ligne
de l’horizon peut
paraître
si lisse la mer
vouée à la claire
contemplation
des vagues apaisées
dans le lointain
même les navires
coulent et les îles
évoquent maintenant
l’Atlantide l’imagination
se prépare
à une vue d’ensemble
pourtant elle
n’a de cesse
de se plonger
dans le désir
de l’imprévisible (p. 41)
S’est alors qu’on voit émerger le
titre du recueil tel un reflet inversé de la plongée contemplative, cette
« brèche dans l’eau » faite par la lumière :
Ainsi se fraye
la lumière
une brèche
dans l’eau
et pourtant
elle ne tombe pas
sur tous les
disparus
dans les océans
du monde (p. 59)
Ainsi l’eau, qui « n’était
/ jamais claire / n’était jamais trouble », à savoir qu’elle était
par nature d’une parfaite neutralité à nos plaisirs comme à nos douleurs,
s’éclaire de notre « lumière », et « coule entre / les
regards noie / l’anxiété » (p. 63). Une
transformation s’opère :
un regard coule
plus tard
ainsi qu’il
reste encore
la lumière
du coucher du
soleil
plus belle et
plus profonde qu’avant
impression de l’essentiel (p. 79)
La beauté n’est donc pas donnée a
priori, elle est un don acquis par la contemplation, et devient elle-même
source de vie :
immensité de beauté
lumière pure l’eau
porte encore
toujours la source
de la vie même privée d’hommes
immensité de froideur
lumière pure l’eau
avale non seulement le soleil
mais aussi le mouvement
immensité d’éblouissement
lumière pure l’eau
attire les yeux
et les laisse sombrer (p. 87)
Une onde de compassion s’étale à
la fin du recueil, pour, on dirait, réconcilier la beauté acquise et la
souffrance subie :
on dirait
de l’argent
dans la lumière
éblouissante
l’eau n’a pas
l’air trouble
et la vague
semble douce comme si
elle berçait tous ceux
qui ont quitté le rivage (p. 99)
Pour
la lumière dans l’espace…
ou
« une brèche dans la fenêtre »
(**)
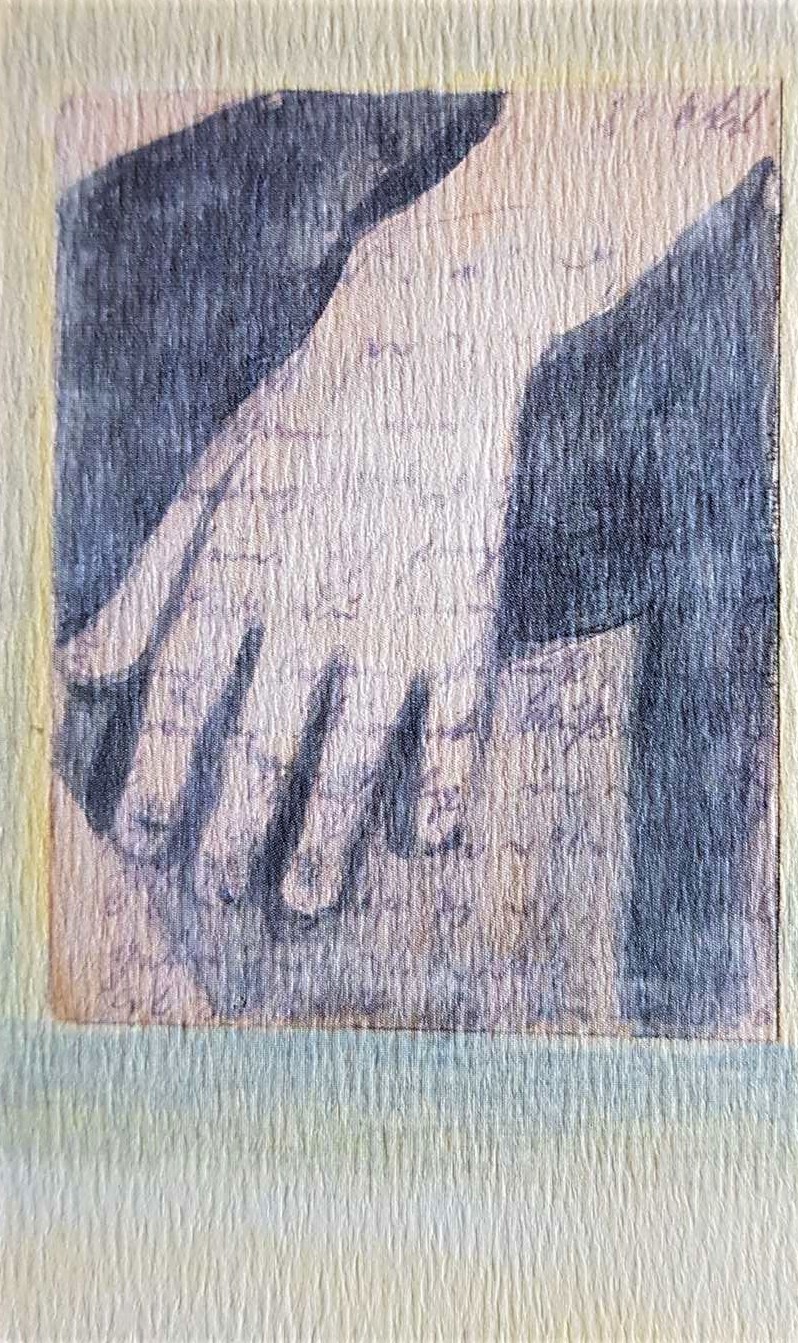
Peinture de Matthieu Louvrier (la dernière du recueil, fragment)
La « lumière dans l’espace », parue
pratiquement en même temps que la « brèche dans l’eau »,
pourrait, me semble-t-il, être vue comme la « jumelle » de
cette dernière. J’aimerais bien en retenir quelques éclats, pour leur
beauté et leur plénitude de sens issue justement du renversement du sens
commun. Car il est question ici d’ouvrir l’espace par la pensée, de ne
pas fermer les fenêtres en restant confiné dans son cachot, de voir
au-delà du visible, de se délester des bagages en montant plus haut,
d’écouter le silence d’un espace « rempli du son de
la disparition », et somme toutes, de faire respirer le poème à
travers… « une brèche dans la fenêtre » :
La
pensée appartient
à
l’espace
mais
celui qui sait
résister
à la pression
abat
les murs
et
ouvre de lui-même
un
univers
***
Trop
de lumière
brouille
les yeux mais
celui
qui els ferme
ressent
ce
qu’il
ne voit pas
***
Ils
montent l’escalier
marche
après marche
leur
cœur bat
plus
légèrement ils
laissent
derrière eux
de
plus en plus
***
Il
est plus facile
de
fermer les fenêtres
que
d’exclure
ce
qui est autour
***
Un
jour
à
demi un bout
du
chemin un
morceau
d’espace
une
brèche dans la
fenêtre
une vue
qui
manque
à
l’ensemble du texte
***
Pour
la lumière
dans
l’espace
que
la nuit
enferme
pour
l’écoute
du
silence
qui
emplit
l’espace
pour
l’autre
côté
du jour
et
dans le bruit
absolument
préserver
regard
et
voix
***
Une
voix
se
perd
dans
l’espace
désormais
rempli
du
son de la disparition
***
Le
temps s’est mis
à
neiger dans
la
maison et
à
s’entasser
jusqu’en
haut du toit
il
cherchait
l’espace
et le silence
Combien de bleu
ou « regarde par la fenêtre »
(***)

Et
pour dresser comme un trait d’union entre les deux recueils précédemment commentés,
j’aimerais juste évoquer un troisième – un livre d’artiste, paru dans des
conditions graphiques exceptionnelles, comme Pour la lumière dans
l’espace : il s’intitule Combien de bleu (wieviel
blau).
Dans
une grande cohérence avec soi-même, la poète nous fait, ici, cet aveu
révélateur, qui nous laisse comprendre le lien secret entre lumière et
eau, fenêtre et bateau sur mer :
Toutes
les fois que quelqu’un
regarde
par la fenêtre
à
l’instant un bateau
est
en vue
et
s’approche
du
rivage
dès
qu’il ferme
les
yeux
il
est à bord
au
lieu de porter
son
regard
au
loin
On
a envie d’embarquer, merci, Eva-Maria, pour tes brèches de lumière !
©Dana Shishmanian
|