|
Ultime recension d’un ouvrage de la
belle collection « Littérature occitane - Troubadours » de
Fédérop, les chansons de Rigaud de Barbezieux, un poète qui joue volontiers
avec les métaphores animalières. Lui sera jointe la recension du conte d’un
certain Arnaut de Carcassés qui a la particularité de mettre un perroquet
au premier plan. Certes, les animaux ne sont pas totalement absents chez
les autres troubadours, que l’on pense par exemple au rossignol et à
l’alouette chez Bernard de Ventadour ou au loup chez Peire Vidal, mais
c’est un bestiaire bien plus exotique qui est mobilisé ici.
La
Dame-Graal – Chansons de Rigaud de Barbezieux. Présentation
et traduction de Kary Bernard, édition bilingue occitan-français, Fédérop,
Coll. « Littérature occitane - Troubadours », Gardonne, 2017, 13
p., 14 €.
Arnaut
de Carcassés, Las Novas del Papagai. Présentation et
traduction (en prose) de Pierre Bec, Fédérop, Coll. « Fédéroc »,
Mussidan, 1988, 52 p. (toujours disponible chez Pierre Mainard, éditeur).
Rigaud de Barbezieux
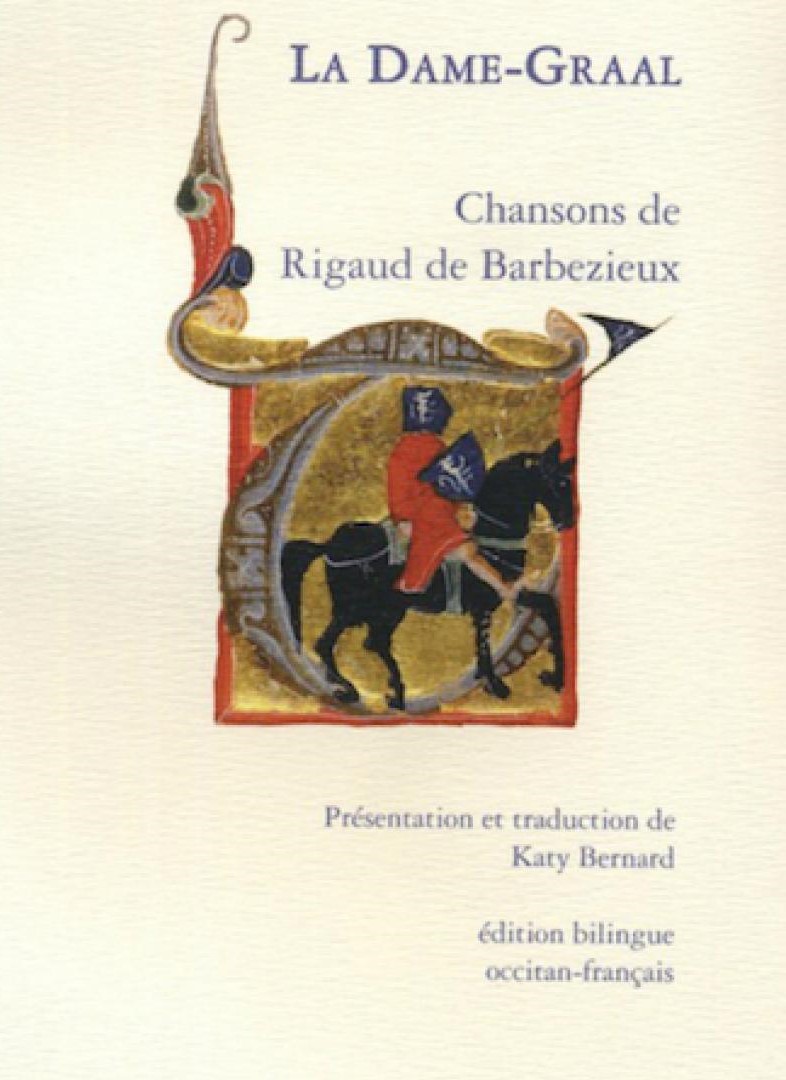
Aissi co.l sers, que, cant a faig son cors,
Torna morir al crit dels cassadors,
Aissi torn eu, Domn’, en vostre merce,
Mas vos non cal, si d’Amor no.us sove.
Tel le cerf qui, à la fin de sa
course, / Reviens mourir sous les cris des chasseurs, / Moi je reviens,
Dame, en votre merci, / Mais que vous chaut si Amour oubliez ?
Ici,
le troubadour est cerf. Ailleurs, il sera tigre et même éléphant.
Contrairement à l’ours, il n’est pas sans honneur et il voudrait être comme
Phénix pour pouvoir souffrir et souffrir encore. Quant à la dame, ou
l’amour, ils sont tour à tour lion, vautour, faucon. Cette mise en valeur
du bestiaire est incontestablement la marque de Rigaud de Barbezieux,
identifié au Rigaudus de Berbezillo qui apparaît dans des actes établis
entre 1140 et 1157 conservés aux Archives de la Saintonge et de l’Aunis.
D’après
sa vida, la dame de son cœur, qu’il appelle Mielhs-de-Domna
(Mieux-que-Dame) dans ses chansons serait l’épouse de Jaufre de Tonnay et
la fille de Jaufre Rudel dont nous avons parlé dans notre précédente
chronique. Sa razo (traduite ici par « Discours
poétique ») raconte comment il aurait voulu rompre avec sa dame qui se
refusait à lui avec trop de constance, attiré au demeurant par une autre
dame qui lui aurait laissé faussement entrevoir qu’elle se donnerait à lui.
Détrompé, il voulut se rapatrier mais Mieux-que-Dame aurait alors exigé que
« cent dames et chevaliers, qui s’aimassent tous d’amour, vinssent
tous devant elle, à genoux, lui demander grâce ». C’est après cet
épisode qu’il écrivit la canso (la même que celle de la citation
précédente) qui commence par ce verset :
Atresi con l’olifanz,
Que quant chai no.s pot levar
Tro li autre, ab lor cridar,
De lor voz lo levon sus,
Et eu voill segre aquel us,
Que mos mesfaitz es tan greus e pezans
Que si la cortz del Puoi e lo bobanz
E l’adreitz pretz dels lials arnadors
No.m relevon, jamais non serai sors,
Que deingnesson per mi clamar merce
Lai on prejars ni merces no.m val re
De même que l’éléphant, / Quand il
tombe, reste à terre / Jusqu’à ce que tous les autres, / Grâce à leurs
cris, le relèvent, / Moi je suivrai cet usage, / Car ma forfaiture est si
grave et lourde / Que si le faste de la Cour du Puy / Et les justes valeurs
des amants / Ne me lèvent, jamais ne le pourrai ; / Qu’ils daignent
pour moi demander / Là où prières ni merci ne servent.
Toutes
les cansos de Rigaud sont unisonans et obéissent à des
contraintes raffinées. Atresi con l’olifanz compte cinq coblas
de onze vers, soit cinq heptasyllabes puis six décasyllabes. Le mot merce
(merci) revient à la rime au dixième vers de chaque verset. À noter que la
traduction de Katy Bernard respecte le mètre de Rigaud. Ce dernier est
capable d’exploits encore plus raffinés : ainsi dans Pauc sap d’amor qui
merce non aten (D’amour il sait peu qui merci n’attend), une chanson de
cinq couplets de huit vers de respectivement 10, 4, 6, 10, 10, 10, 10, 10
syllabes (avec la présence éventuelle d’une syllabe surnuméraire aux vers 3
et 4), il utilise les mots rimes aten, consen, atenda, esmenda, suffrir,
murir, jauzen, primeiramen dont les places alternent d’une strophe à
l’autre (sans changer l’ordre des rimes a a b b c c a a) et retrouvent leur
place initiale dans la dernière strophe. On peut difficilement faire plus
compliqué ; l’Oulipo peut toujours s’aligner !
Rigaud
de Barbezieux a une autre particularité marquante. On attribue généralement
à Chrétien de Troyes le mérite d’être l’auteur du premier témoignage écrit
du mythe du Graal dans son roman Perceval ou le conte du Graal, daté
du début des années 1180. Si l’on admet que la production poétique de
Rigaud se situe dans les années 1140-1150, c’est donc à lui qu’en
reviendrait le mérite dans la canso qui commence ainsi :
Atressi con Persavans
El temps que vivia,
Que s’esbait d’esgardar
Tant qu’anc no saup demandar
De que servia
La lansa ni.l Grazaus,
Et eu sui atretaus,
Mieil-de-Domna, quan vei vostre cors gen [...]
Je suis comme Perceval / Qui, du
temps qu’il vivait, / Fut bouche bée en voyant / La Lance et le Graal au
point / Qu’il ne sut jamais / En demander le rôle, / Je suis tout comme
lui, Mieux-que-Dame, quand je vois votre corps [...]
On
a bien peu de certitudes à propos des troubadours. Dans ce cas cependant,
il est raisonnable de rendre à Rigaud l’honneur d’être le premier à avoir
laissé une référence écrite à Perceval et au Graal. On sait en effet que
les légendes arthuriennes étaient déjà connues à la cour de Guillaume IX († 1126)
par l’intermédiaire d’un certain Bleheri. Quoi qu’il en soit, cette canso
dans laquelle la dame paraît identifiée au Graal explique le sur-titre
choisi par K. Bernard pour ce recueil.
***
Arnaut de Carcassés
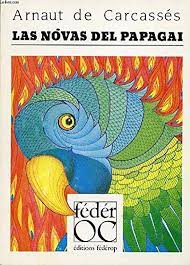
On
en sait bien moins sur Arnaut de Carcassés que sur Rigaud de Barbezieux.
Est-il d’ailleurs l’auteur de Las Novas
del Papagai ou simplement son remanieur ?
Concernant sa biographie, on ne peut que supposer qu’il fut apparenté d’une
manière ou l’autre aux seigneurs de Carcassés (actuellement un hameau sur
la commune de la Roque-de-Fa en pays cathare). Et concernant la datation de
la nouvelle, tout au plus peut-on affirmer qu’elle a été rédigée au XIIIe
siècle.
Ce
long poème de 310 octosyllabes à rimes plates, traduit ici en prose par
Pierre Bec, est l’une des très rares novas en occitan qui nous
soient parvenues. Celle-là comme les autres est en vers rimés ce qui peut
expliquer qu’on ait voulu en conserver la trace. Le personnage principal
est un perroquet qui fait office d’entremetteur au profit du seigneur
Antiphanor. Cependant le récit apparaît original sur plusieurs points.
D’abord s’il est clair que le perroquet persuade une dame d’accorder ses
dernières faveurs à Antiphanor, la manière dont l’histoire est racontée
laisse planer un doute sur le rôle de ce dernier : est-il celui qui a
envoyé l’oiseau auprès de la dame ou n’est-ce pas l’oiseau qui a pris
l’initiative de la séduction et qui, dans un second temps, après avoir
obtenu l’accord de la dame, la présente à son seigneur.
Dreg a son
senhor es vengutz
E contra.l
com s’es captengutz :
Premeiramen
l’a comensat
Lo gran
pretz e la gran beutat
De la domna
[…]
Ab ses
cordo ab aur obrat,
Que.ls
prendatz per sa amistat
E prendetz
los per su’amor
Que Dieus
vo.n do be et honor.
Il
va tout droit à son maître et lui raconte comment il s’est conduit :
il commence par les grands mérites et la beauté de la dame […] Je vous
apporte cette bague, avec ce cordon d’or ouvré. Acceptez-la par pitié pour
elle. Prenez-la au nom de son amour et que Dieu vous accorde bien et
honneur
Étonnante
formulation, en effet, comme s’il fallait supplier l’amant de « se
rendre » à la dame et non l’inverse !
Autre
bizarrerie, l’attitude de la dame. Elle commence par refuser la proposition
du perroquet. Elle aime son mari et n’a nul besoin d’amant.
« Papagai,
be vuelh que saplatz
Qu’eu am
del mon le pus aibit. »
« E vos
cal, dona ? » « Mo marit. »
-
Perroquet, je veux que vous sachiez que j’aime l’homme le plus parfait du
monde.
-
Qui est-ce, dame ?
-
Mon mari.
Elle
réitère cette affirmation et, pourtant, ne tarde pas à changer d’avis sans
qu’on sache pourquoi, sinon que le perroquet a su se montrer
éloquent :
« Papagai,
si Dieus m’accosselh,
Encara.us
dic que.m meravelh,
Car vos tan
gen sabetz parlar. »
-
Perroquet, avec l’aide de Dieu, je vous répète que je suis émerveillée de
vous entendre parler si courtoisement.
Si
l’on se demande, au passage, ce que le Bon Dieu vient faire à ce moment-là,
on ne peut manquer d’être surpris par le comportement de cette dame qui
accepte une aventure extra-matrimoniale sans lendemain (elle n’est possible
que grâce à l’incendie du château qui éloigne les gardes du verger où les
amants se rencontreront une seule et unique fois), « un coup d’un
soir » en quelque sorte, sans cesser d’aimer son mari. On sait par les
troubadours que les « dames » n’étaient pas toujours exemplaires,
qu’il y avait bien des entorses au fin’amor. Mais la fable du
perroquet met en scène une femme libérée comme on en imaginerait peu, a
priori, au Moyen Âge (1).
L’histoire
se termine par la séparation des amants, sans chagrin démonstratif.
Antiphanor a seulement le cœur serré (ab cor marrit). Quant à la
dame, elle le renvoie après lui avoir donné trois baisers (baiza.l tres
vetz) et recommandé de se comporter en homme « propre »
autant qu’il le pourra (de far que pros tan can poiretz). Enfin l’un
des deux manuscrits restants ajoute une morale (dont il manque quelques
mots) destinée aux maris jaloux :
So dis
n’Arnautz de Carcasses
Que precx a
faitz per mantas res
E per los
maritz castïar,
Que volo
los molhers garar,
Que.ls
laisso a lor pes anar,
…………… que
may valra ;
E ja degus
no.y falhira.
Telle
est l’histoire que raconte Arnaut de Carcassés, qui a fait des prières en
maintes occasions. Et pour châtier les maris qui veulent garder leurs
femmes. Qu’ils les laissent aller à leur fantaisie ……. Cela vaudra mieux et
alors personne ne sera en faute.
Outre
que l’interprétation du second vers apparaît difficile (2), cette morale
digne des libertins du XVIIIe siècle trouve ici une illustration
matérialiste : vouloir restreindre une femme volage peut coûter bien
plus cher qu’une entorse à la dignité du mari, soit ici l’incendie de son
château, quoique dans ce cas précis le feu mis au donjon par le perroquet
ait été vite maîtrisé « grâce au vinaigre » (ab vinagre) !
Notes
(1) Ces deux points, curieusement, ne
sont pas relevés par Pierre Bec dans son introduction.
(2) Nous reprenons ici celle de P. Bec
qui s’en explique dans une note.
©Michel Herland
|