|
À
première vue, on a affaire, avec les binômes photos-haïkus qui composent
ce nouveau livre de Jeanne Gerval AFRouff*, à des paréidolies, de celles
dont l’artiste-écrivaine mauricienne nous a déjà régalés dans Francopolis
(voir ses « boules
de Noël 2021 & 2022 » ou
les extraits de son livre Éloge de l’émerveillement, novembre-décembre
2018 et mars-avril
2019).
Il
y en a pourtant bien plus. Car, loin de seulement nous faire
« voir » des images figuratives dans des matières brutes,
supposées par définition non-figuratives, la découverte par l’œil de
l’artiste de ces « icônes » cachées (alors même que le jeu de
cache-cache n’est pas toujours évident pour tout spectateur) nous amène à
une perception fondamentale de l’unité de l’univers et d’une sorte de
téléologie structurelle, qu’il porte et qui le porte. Elle est implicite
et non apparente mais parfois, justement, elle se dévoile de manière
aussi spontanée et inattendue qu’évidente, non dissimulée. C’est ce qu’on
appelle le principe anthropique. Et c’est dirait-on en vertu de ce
principe qu’on peut « voir » des visages cachés dans les
choses… qui nous regardent avant même qu’on les ait vues, peut-être même
arrive-t-on à les voir parce qu’ils nous ont regardés d’abord, et qu’ils
nous inculquent ainsi leurs propres reflets en nous en guise de vision…
On
se rappellera la réflexion de Nietzsche : « Plonge ton
regard dans l’abîme et l’abîme te regardera aussi ». Ce qui nous
amène à l’esprit aussi, bien entendu, la révélation fondatrice qu’eut le
grand Malcolm de Chazal de l’azalée qui le regardait…
D’ailleurs,
l’expérience artistique et spirituelle de Jeanne
Gerval ARouff est peut-être au plus près de celle du Mage
Mutant mauricien, comme elle l’appelle (voir ses articles dans Francopolis
à la rubrique Une vie, un poète de septembre
2014 et
septembre-octobre 2021, et surtout, son livre Pour
Malcolm de Chazal, l’essentiel monolithe, paru en 2022, présenté et
recensé à cette même rubrique en septembre-octobre 2022
par Dana Shishmanian, Serge Gérard Selvon, Patricia Laranco).
Voici
à titre d’exemple une des nombreuses expressions du credo de Malcolm
de Chazal : « Toute ma philosophie,
dans ce livre, part de ce principe qu'il n'y a pas de solution de continuité
entre la nature et l'homme, et que toutes les formes du corps humain,
toutes les expressions du visage de l'homme, et jusqu'à ses sentiments
sont inscrits dans les plantes, les fleurs et les fruits, et avec encore
plus de force chez cet autre nous-même qu'est l'animal. Le règne minéral
même qui est considéré mort par certains tend dans ses formes – et
surtout lorsque mis en mouvement — vers cette synthèse des synthèses
qu'est le corps humain. "L'homme a été fait à l'image de
Dieu". Oui, mais j'ajoute : "La nature a été faite à l'image de
l'homme" – et je cherche à le prouver. » (dans Sens
Plastique, Gallimard 1948).
Pour
être accomplie, cette expérience doit s’associer un double reflet :
celui, primordial, de l’observateur et de l’objet, rapport réversible au
pont de jonction de l’existence et de la conscience – qui, elle, est tout
aussi universelle ; et celui, second mais indispensable, qui
s’institue entre l’expression de cette même révélation et sa
réception par un autre. Car la transmissibilité est nécessaire pour
que la vision cognitive soit complète et puisse se clore sur elle-même,
en tant que sujet, tout en englobant entièrement son objet.
C’est
alors que les réflexions d’un autre penseur nous viennent en mémoire, qui
nous éclairent le processus de communication artistique, en nous donnant
sa mesure ontologique ; il s’agit de l’anthropologue Atmane Bissani :
« Visage,
le même affiche son être, regard, l’autre le saisit comme structure
signifiante. C’est pratiquement dans la rencontre de l’autre comme regard
que commence la réalité anthropologique, socioculturelle, psychologique,
et existentielle d’un visage. Ne pas être regardé c’est se réduire au
néant, c’est disparaître comme trace sémantiquement possible. Le
fondement ontologique d’un visage, voire d’un être vient donc de
l’extérieur, par le truchement du regard de l’autre. »
(Atmane Bissani, De la rencontre, essai sur le possible,
éd. Imagerie-Pub, Fès, 2009, p. 64 ; cité d’après :
Khadija Outoulount, Visage
et Regard : de l’ontologique au poétique, dans
Francopolis, à la rubrique Vue de Francophonie, octobre
2009).
Nous
pouvons comprendre, dès lors, pourquoi Jeanne nous dit, avec la flamme
d’une foi indéfectible en la Poésie et en l’Homme, malgré tout et contre
tout ce qui nous oppresse et tend à nous réduire à néant :
« Non,
pas de rêve ! Ni d’élucubrations de poète… Tu es là, en
images : nuage, feuillage, légume, écume…, pierre, bois… toi,
l’Omniprésent. »
Et
tout en retrouvant l’innocence du regard de l’enfant :
Couchée dans
l’azur
Petite Fille
yeux grands ouverts
contemple
Bleu-Paix
Petite fille au grand pas
Œil ouvert
sourire aux lèvres
Dana Shishmanian
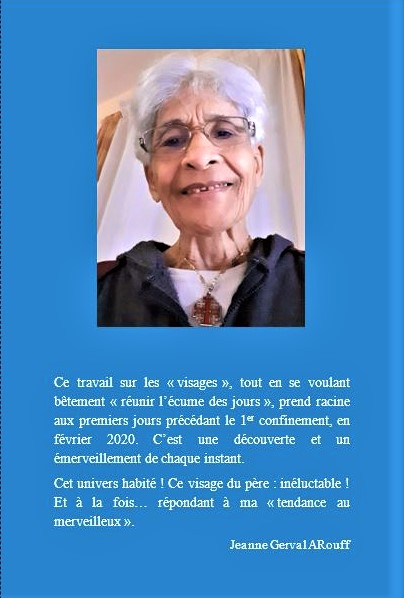
* J’ai
eu le privilège d’assister, presque au jour le jour, à la gestation et à la
croissance, tel d’un organisme vivant, de ce livre (comme aux trois
précédents d’ailleurs : Éloge
de l’émerveillement, En
confinement, et Pour
Malcolm, l’essentiel monolithe) – qui s’est nourri, depuis fin
2021 à mi-mars 2023, des épiphanies quasi-quotidiennes que Jeanne a le
secret de découvrir et d’accueillir, par et dans sa créativité, en
empathie permanente avec l’Universel...
Je
suis grandement reconnaissante à l’autrice pour nos échanges (par email)
incessants, enrichissants pour l’âme, le cœur et l’esprit. (D. S.)
|